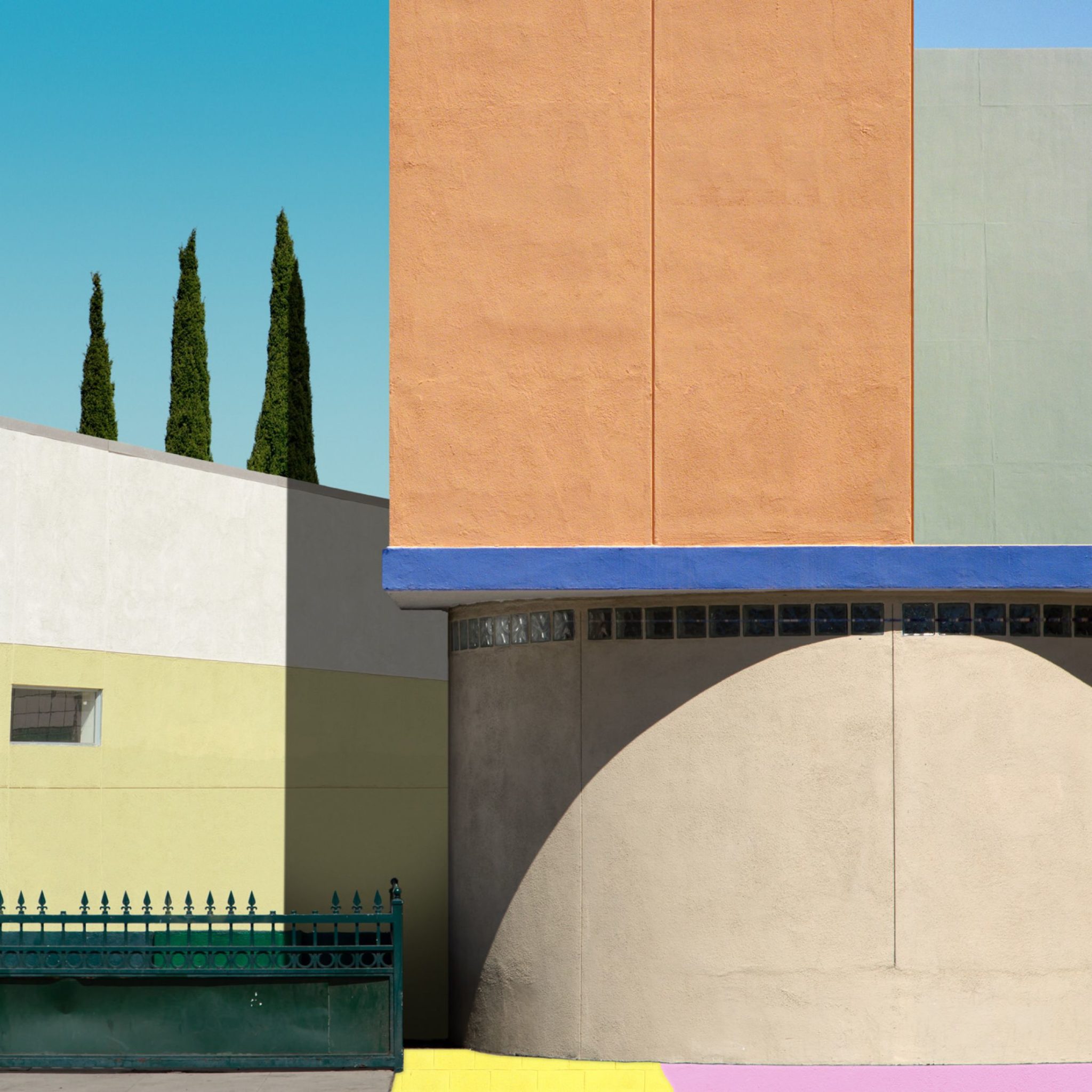PARTIE II
« Les corps amoureux »
CHAPITRE XIII
Qui, quoi, comment ?
Mes châteaux en Espagne, je les construis autour de moi. Emmuré que je suis à vouloir me protéger, me rassurer et entretenir l’image du doute et du mystère.
Lorsque vous avez vécu une adolescence ingrate – je parle du physique que vous vous trimbalez comme d’autres se baladent avec des casseroles accrochées à la ceinture – vous ne savez pas vraiment ce que vous suscitez, en termes d’attirance comme d’envie pour les autres.
Je prends donc conscience que je n’aurai jamais un physique terrible. Je sais que je suis en sursis et que ce laps de temps prévu entre 20 et 35 ans me permettra de faire bonne figure. Mon côté frais et poupin, à la peau lisse et au corps glabre, fera illusion un temps, mais passée la quarantaine, ce sera fichu.
Alors je reste irréprochable partout où je me montre, un dandy toujours tiré à quatre épingles qui ne sourit jamais mais qui essaie d’être remarqué dès son arrivée. J’occupe aussi bien le bar que la piste de danse. A mon corps défendant, il faut dire que je ne danse pas trop mal. Mon sens de l’observation, du rythme et ce fameux déhanchement vont me permettre de rencontrer de jolis succès.
Et un beau petit trou du cul, surtout !
Cette arrogance que l’on affiche de toute façon à cet âge, cette manière de se conduire avec autrui, finissent toujours par payer. Et puis on a la jeunesse pour nous. Alors on se croit invincible. On porte des vêtements de marques prestigieuses. On écoute de la musique classique. On écrit des poèmes. On va beaucoup au cinéma et on lit énormément. On se croit donc vraiment au-dessus de la mêlée. Bref, on rêve sa vie, on la sublime. Tous les jours, on y met de jolis bouquets de fleurs. En substance, on est vraiment devenu un petit parvenu dans toute sa splendeur.
C’est également à cette période que mes parents traversent de sales moments. Ils sont en train de perdre leur magasin de fleurs. Mais moi, je m’en fous complètement. Je ne m’en rends pas vraiment compte, en fait. Je ne pense qu’à mes virées nocturnes en boucle. Il faut dire que je sors tous les soirs. Boîte de nuit, bars et autres, sept jours sur sept. Je ne dors presque plus. C’est une obsession. Je suis devenu un cochon d’Inde qui tourne sans répit dans sa roue.
J’aime tellement cette nouvelle musique que je peux me trémousser des heures durant, sans vraiment m’occuper de la gent masculine qui m’entoure ou qui pourrait m’observer. Je laisse d’ailleurs le rôle du dragueur aux autres. On m’accoste, on essaye de me séduire. Je m’amuse de cela, pour tout dire… Je suis bien entendu flatté, mais je dois avouer que je trouve la plupart de ces rôdeurs un peu cons. En fait, je les vois tous avec un gros sexe gonflé à l’hélium qui pend au milieu du front.
Je suis une vraie petite connasse qui commence à comprendre l’attrait qu’elle représente pour tous ces prédateurs actifs et autres fans de la pénétration sans équivoque. Je viens de trouver où se cachaient la boîte de chocolat et les pots de confiture…
Même si ma toute première expérience sexuelle s’est révélée plus que médiocre, voire complètement nulle, je veux y retourner.
Mais contre toute attente, la plupart de ces amants d’un soir baisent extrêmement mal. Après un kiss ou deux, ils agissent systématiquement de la même manière. La main sur ma tête pour la forcer à se baisser jusqu’à leur sexe. Ensuite, c’est toujours un « tu as un préservatif ? » suivi d’un « et du gel ? ». Ils veulent m’enculer, éjaculer et on n’en parle plus. Jamais ils ne vont se soucier de savoir si, moi aussi, j’ai joui. Autant dire que tout ce sempiternel cérémonial ne me convient pas du tout.
Cette obsession de l’anus, comme unique option, me donne parfois l’impression que je ne suis qu’un sac à foutre, un ustensile de vidange. Je n’irais pas jusqu’à parler de viol à répétition, mais avec le recul, c’est pourtant bien d’abus dont il s’agit. En tout cas, chacune de ces expériences me laisse un goût amer. Je me sens seul et sale.
Et puis je relativise, en me disant que tout cela fait partie de mon apprentissage et que je dois forcément en passer par là.
Je réitère donc l’expérience dès que je le peux, en espérant à un moment donné tomber sur le bon et pouvoir moi aussi participer à cette petite fête des sens. Ce dont je me rends compte également, c’est qu’il y a un gouffre, un canyon même, entre ce que je vois dans les films pornos et la réalité.
Je passe beaucoup de temps dans des sex-shops, qui sont équipés de cabines où l’on regarde des films préalablement choisis dans les rayons dédiés au genre, son rouleau de sopalin dans une main et la bite dans l’autre. Je découvre le monde du porno gay et ça n’est hélas pas la réalité que je retrouve lorsque je suis avec un de ces petits chenapans dans la vraie vie.
Tous ces films sont une fiesta permanente, un feu d’artifice de foutre et de plaisir sans frein. Tout le monde y jouit à tout rompre. Et personne n’est laissé sur le côté. Mais c’est ça que je veux, moi ! L’anus n’est plus une finalité pour l’un des partenaires et un mauvais moment à passer pour l’autre. Il est la farandole des desserts, le super brunch, le buffet continental…
CHAPITRE XIV
Leçon de chose n°4 : L’anus (mais qui es-tu vraiment, petit anus ?)
L’endroit probablement le plus visité au monde, loin devant la Tour Eiffel et le Louvre, pourtant secret, intime, caché entre les deux fesses, est la plus ancienne mais aussi la plus fédératrice des institutions. L’alpha et l’oméga de toute relation humaine, de la Laponie à la Nouvelle-Guinée, en passant par le Maroc et le Sénégal, et ce depuis la nuit des temps.
Conspué, célébré, chanté, moqué, mais sortant toujours grand vainqueur de tous les conflits. Orifice du rectum qui donne passage aux matières fécales… mais… Mais aussi un petit trou tout plissé, comme un clin d’œil complice et malicieux, qui est le second organe, après le pénis, le plus prisé et utilisé de bien différentes manières.
Il a donc cette autre fonction que d’être introduit par plein d’autres choses ; exemple : par un sexe étranger (d’une personne tierce ou d’un étranger, justement, d’une autre nationalité), mais aussi par des objets divers et variés (godemichet, plug anal, combiné de téléphone, modèle 1939 en Bakélite) ou encore par des fruits et légumes (cinq fruits et légumes par jour). Ça peut d’ailleurs aller du haricot vert extra-fin en passant par la banane, le concombre, la courge et même l’ananas.
L’anus, c’est la « final touch » de tout rapport homosexuel masculin qui se respecte (bien que les hétéros en soient également férus). On peut rajouter, à l’attention de tous les candides et épicuriens de la terre, une liste dérivée et plus familiale que ce terme encyclopédique. N’en déplaise à ces messieurs Larousse et Petit Robert.
Alors vous avez :
✓ Trou de balle
✓ Troufignon
✓ Trou du cul
✓ Derche
✓ Fion
✓ Rondelle
✓ Rosette
✓ Darjo
✓ Baigneur
✓ L’Ostie
✓ L’entrée des artistes
✓ Lucarne enchantée
✓ Le rondibé du radada
✓ Juda
✓ Cyclope
✓ Les charmes du donut (pour cela, placez un donut côté pile devant vos yeux puis laissez-vous aller à la rêverie)
A présent, le jeu : toi, l’ami, joue aussi et ris avec ta famille. Tu peux rajouter pleins d’autres petits sobriquets à cette liste.
D’un point de vue biblique, ce qui jadis fit sombrer Sodome et Gomorrhe dans les abysses du pêché a été depuis repris en chœur par tout le monde. La sodomie, le mot est lancé. Cet acte condamné par l’église (vade retro sodomite !) et par toutes les autres religions d’ailleurs, et ce depuis la nuit des temps, fait pourtant le bonheur de toutes et de tous. Ce que l’on peut appeler aussi l’amour dans les fesses.
On pense à tous ces moines, qu’ils soient catholiques ou tibétains, dans leur monastère, face à la solitude de Dieu. On pense aussi à ces prisonniers du monde entier dans leur centre de détention, à ces marins qui partent pendant longtemps. Bref, à tous ces hommes sans femme, ces bergers dans leur montagne…
Entre cierges et savonnettes, les alibis culturels ne manquent pas à la plus grosse hypocrisie que l’histoire de l’humanité ait pu engendrer.
… Mais il n’en reste pas moins que cela ne me satisfaisait guère. Et je comprends finalement que je ne fonctionne pas exactement comme un mec qui peut empiler les rencontres comme autant de trophées de chasse.
Il me faut beaucoup plus. Il me faut de l’affection, de la compréhension, de la passion, des papillons dans l’estomac et pourquoi pas, soyons fous, allez… Comme le chantait Mouloudji, « l’amour, l’amour, l’amour »…
[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Hubert Touzot : « La Pudeur » (Episode 11)
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Hubert Touzot : « La Pudeur » (Episode 12)
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Hubert Touzot : « La Pudeur » (Episode 13)
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Hubert Touzot : « La Pudeur » (Episode 14)
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Hubert Touzot : « La Pudeur » (Episode 15)
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Hubert Touzot : « La Pudeur » (Episode 16)
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Hubert Touzot : « La Pudeur » (Episode 17)