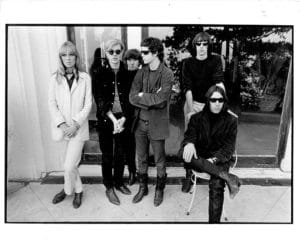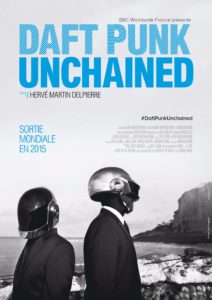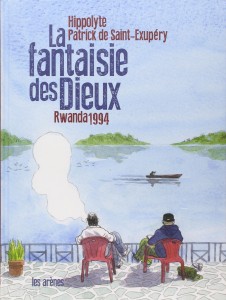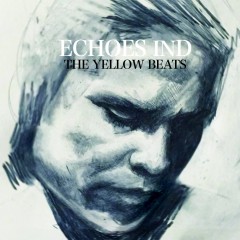Jim (de son vrai nom Thierry Terrasson) est un auteur de BD qu’on n’a plus besoin de présenter : 110 albums, 1,3 million d’exemplaires vendus, du théâtre, des courts-métrages, et un rêve : le cinéma. Parce que Jim nous fait rêver, nous avons voulu à notre tour nous intéresser à ses rêves.
IC : Vous avez déclaré « rêver de cinéma depuis vos 18 ans » (interview « My little discoveries » – Mars 2013). Qu’est-ce qui vous attire dans le 7ème Art que vous ne retrouvez pas dans le 9ème ?
Thierry Terrasson : Le monde de la BD et celui du cinéma sont différents : faire de la BD reste un travail solitaire. Parfois on est deux, trois, mais on jouit d’une liberté totale de création. Je peux imaginer un personnage, dire une phrase d’une certaine façon, le dessiner comme j’en ai envie, découper le texte comme il me semble et raconter ce qui me chante. Je peux jouer avec tous les éléments mis à ma disposition pour évoquer des choses, les faire ressentir ou créer un mouvement, et cela juste d’un coup de crayon. Ce sont les possibilités infinies que nous offre la BD.
L’une des qualités du cinéma qui m’attire, c’est le travail en équipe. On se retrouve soudain plusieurs à projeter notre ressenti, nos idées sur le film. Chacun, selon sa compétence (réalisateur, metteur en scène, scénariste, responsable photo, acteurs…). Un acteur apportera au texte de la finesse, une certaine intensité, un sous-texte, autant de choses qui vont agrémenter la simple idée de départ. De la même façon, le lieu influe sur les idées qu’on avait, c’est pour cette raison que j’essaie de ne pas trop dessiner de story-boards. Ce sont souvent les plans les moins intéressants car les plus calculés. Je préfère les surprises, les accidents qui donnent la sensation d’attraper la vie au vol.
IC : Vous avez participé aux scénarios de sept courts-métrages : Comment se sont créées à chaque fois les rencontres et les opportunités ?
Thierry Terrasson : Parfois, des gens sonnent à ma porte, mais la plupart du temps, c’est une envie très instinctive au démarrage, et je cherche alors qui le projet peut intéresser. Souvent en allant chercher dans mes connaissances, parfois en découvrant de nouvelles personnes. On parle là d’une majorité de courts métrages joyeusement amateurs. Seuls les tout derniers prennent un tournant plus professionnel. Je ne fais plus tout, tout seul, ou avec quelques copains. Mon dernier court-métrage, « Vous êtes très jolie, mademoiselle » a été réalisé en faisant appel à des professionnels. Ce n’est plus moi qui tiens la caméra, ce qui est une étape décisive : il s’agit de passer le relais à quelqu’un de calé en photo, en cadrage, qui saura faire bien mieux que ce qu’on ferait, et lui faire confiance ! Chacun son métier.
IC : En 1986, vous réalisiez votre premier court métrage «Chipie St Jill». Quel était le pitch ? Quels étaient vos moyens ?
Thierry Terrasson : Les moyens ? Illimités ! (rires) En fait, « Chipie St Jill » est mon tout premier court métrage, co-réalisé avec mon frère Philippe : il avait 17 ans et moi 19, on parle donc ici d’une histoire de gamins ! Le Crédit Agricole nous avait soutenus dans notre projet en nous faisant un don de 13 000 francs (2 000 euros). Le court parlait d’admiration, de la manière qu’a chacun d’admirer quelqu’un d’autre. On y sentait à plein nez les influences de « 37°2 le matin » et de « La lune dans le caniveau », deux film de Jean-Jacques Beineix. Nos moyens étaient très limités. Comme nous étions inscrits à un club photo et vidéo, un professionnel rencontré là-bas nous avait gracieusement prêté sa caméra et nous avons tourné en 16mm pendant les six mois qu’a duré le tournage. On a très vite réalisé qu’on pouvait faire des miracles à notre petit niveau. Je me souviens d’une anecdote : la scène se déroule sur un quai où sont amarrés des paquebots, dans le port de La Rochelle. Une DS devait être déchargée d’un des paquebots. Facile à écrire, ça prend deux minutes sur un coin de table, mais à tourner ? En discutant avec des hommes sur le chantier naval, contre un petit billet, ils ont accepté de monter et descendre le véhicule pendant une demie- heure, de quoi tourner nos plans. Ça parait tout bête, mais à l’âge qu’on avait, c’était un vrai moment magique pour nous. Pour finir, le court-métrage a fait le tour de quelques festivals et a eu le premier prix au festival du Futuroscope. C’était notre première projection publique, autant dire un régal !
« Si je devais donner un conseil à tous ceux qui veulent démarrer, ce serait celui-là : ne restez pas dans votre coin. Il existe de nombreux clubs vidéos qui permettent de projeter sur écran ce que vous faites. C’est plus intéressant que de poster une vidéo sur U Tube, en tout cas, c’est complémentaire. La réaction du public dans une salle permet de voir très vite si ce que l’on a tourné fonctionne ou pas… et de se remettre en question. »
IC : Votre frère en était co-réalisateur et acteur. La passion du cinéma, une histoire de famille ?
Thierry Terrasson : Philippe a bifurqué vers l’architecture de son côté. Mais oui, au départ, c’était une vraie passion commune. On a grandi côte à côte à discuter des mêmes films. On venait d’une petite ville de province, c’était sans doute ça ou mourir d’ennui…
Pour ma part, j’ai toujours adoré raconter des histoires, que ce soit à travers l’écriture, la bande dessinée ou la prise de vue réelle. Ce qui me passionne, c’est de prendre un bout d’histoire et de la faire évoluer en y ajoutant un drame, une rencontre, une situation un peu dingue… Ce qui m’intéresse, c’est de trouver des ponts entre tout ça. Prendre ce que la vie nous offre de plus piquant et de meilleur pour essayer d’en faire quelque chose. J’aime faire vivre des tas de choses à mes personnages, les surprendre, les secouer… Je suppose que c’est ma drogue !
IC : Hubert Touzot est un acteur récurrent de vos courts-métrages. Pouvez-vous nous parler un peu de lui ?
Thierry Terrasson : Hubert Touzot est un photographe qui a un vrai talent et mérite que l’on découvre son travail. Je lui rends hommage dans l’un de mes prochains albums « De beaux moments ». C’est aussi un super ami, la personne la plus drôle que je connaisse. Il a un cerveau connecté je ne sais où, ce qui lui permet de constamment partir en vrille sur n’importe quel sujet. Il a fait un peu de scène à une époque… Il me conseille, je le conseille. Nous avons même fait un livre ensemble : « T’chat ». Nous nous faisions passer pour une fille et faisions tourner en bourrique des hommes avides de sexe sur les premiers réseaux sociaux. On en pleurait de rire ! L’éditeur un peu moins quand il a vu les chiffres de vente désastreux (rires). C’était il y a cinq ans environ. Hubert l’avait signé U’br. Il écrit toujours, le bougre. Mais son vrai virage est la photographie.
IC : En 2001, vous recevez un 1er prix avec « Le Jeune » et en 2005 votre court-métrage « George » reçoit trois prix, se vend à trois chaînes de télévision. Les choses se sont accélérées durant ces quatre années ?
Thierry Terrasson : Disons que ça a marqué une petite étape : je me suis dit qu’il était peut-être temps, maintenant, de tenter l’aventure du long. Ecrire, trouver le bon sujet, convaincre des producteurs, tout cela est indispensable pour franchir cette étape. C’est aussi pour ça que mes projets BD ont évolué, et ressemblent de plus en plus à des films sur le papier. Je suis de plus en plus régulièrement à Paris et j’apprends pas mal de la relation avec les producteurs.

« Les projets BD et ciné se mêlent donc de plus en plus. Maintenant quand j’écris, je ne sais pas toujours si je l’imagine d’abord en film ou en livre. »
IC : De quoi ont été faites ces dix dernières années depuis 2005 ?
Thierry Terrasson : J’ai écrit, imaginé des personnages, des situations. J’ai fait des lectures avec des acteurs, j’ai rencontré des réalisateurs et des producteurs. J’ai beaucoup travaillé à comprendre le fonctionnement du milieu grâce aux rencontres : il s’agit là d’un travail sous-terrain pour parvenir à cerner le métier de scénariste de cinéma, ce qui n’est pas du tout la même approche que scénariste de BD. D’un côté c’est une industrie, de l’autre encore un artisanat.
IC : Quel est votre technique pour écrire ?
Thierry Terrasson : Au départ, je notais toutes mes idées dans des carnets, des feuilles volantes… Aujourd’hui je les intègre directement dans mon smartphone. Je prends ensuite du fil et une aiguille et j’essaie de coudre les idées ensemble. C’est, de l’avis de spécialistes bien informés, une très mauvaise méthode, car j’essaie d’intégrer la structure après coup. Ils ont sans doute raison mais c’est la méthode que je préfère. J’écris le weekend, la semaine, chez moi vers Montpellier, ou dans le train, ou chez belle-maman, un peu n’importe où. Chez moi, je suis infichu d’écrire dans mon atelier (consacré au dessin), j’ai une pièce dans laquelle j’aime écrire. Avoir un lieu ainsi dédié à l’écriture nous met en condition et donne un cadre, un cérémonial qui met le cerveau en position « écriture ». Même si, en vérité, j’écris vraiment n’importe où. Et je dois bien avouer que la plupart des nouveaux projets naissent en vacances, ou en trajet. Comme quoi, il n’y a pas de secret : il faut agiter son cerveau pour en sortir quelque chose !
IC : de l’écriture à la réalisation, quelles sont les étapes à franchir ?
Thierry Terrasson : Vous voyez ces militaires en camp d’entraînement, qui avancent à plat ventre dans la boue sous des barbelés ? Ecrire un film, ça m’évoque un peu ça (rires).
Je n’ai aucun réseau et je sors de nulle part.
« Ma notoriété entre peu en ligne de compte : parfois, quelqu’un me connaît et accepte donc de lire mon travail plus facilement. Mais j’ai forcément tout à prouver chaque fois, ce qui est le jeu. »
Ecrire un scénario de BD a au final si peu à voir avec écrire un scénario de long métrage. Je travaille de plus en plus avec des producteurs, mais les décisions ultimes appartiennent aux distributeurs et aux chaînes de télévision. Il suffit de trouver un éditeur pour qu’une bande dessinée existe. Au cinéma, le producteur n’investit plus d’argent, il va démarcher des investisseurs : les chaînes de télévision, les distributeurs, les aides diverses… Pour les convaincre, le producteur essaie d’avoir un maximum d’atouts en main : des acteurs, un scénario, son passif… Il est bien loin le temps où les producteurs investissaient sur leurs fonds propres, sur leur seule foi en un projet…
IC : Entre 2012 et 2015, vous avez connu plusieurs très grands succès d’édition avec « Une nuit à Rome » Tomes 1 & 2, avec « Héléna » Tomes 1 & 2, avec « Un petit livre oublié sur un banc » Tomes 1 & 2.
Thierry Terrasson : Même si je m’essaie au cinéma, je resterai toujours attaché à la liberté que m’offre la BD. C’est un vrai bonheur de passer de l’un à l’autre. En ce moment, je me régale en BD de cette extrême liberté. Je dois bien avouer que je savoure ce bonheur là tous les jours !
IC : Sur quels projets travaillez-vous actuellement ?
Thierry Terrasson : Je travaille sur plusieurs projets en écriture, dont un en co-réalisation avec Stéphan Kot, un vieux complice talentueux. Et je peaufine des scénarios de comédie.
En septembre 2015 démarre le tournage de l’adaptation de ma BD «L’invitation», par Michel Cohen avec Nicolas Bedos. Le sentiment que quelque chose se met en route.
Et en BD, j’achève un album dans la lignée de « Une Nuit à Rome », qui s’appelle : « De beaux moments », aux éditions Grand Angle, et va sortir fin août « Où sont passés les grands jours, Tome 2 » avec Alex Tefengki au dessin.
Et avec Lounis Chabane (Héléna), nous sommes sur deux tomes d’une BD qui va s’appeler « l’Erection ». Tout un programme !
IC : Merci Thierry d’avoir accepté de répondre à nos questions.
Thierry Terrasson : Mais c’est moi. Merci à vous !

Et en cadeau, le court-métrage de Thierry Terrasson : « Vous êtes très jolie Mademoiselle » :
[vimeo id= »83614567″ align= »center » mode= »normal » autoplay= »no » maxwidth= »900″]
[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Liens externes » class= » » id= » »]
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Son Blog
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Sa Page Facebook