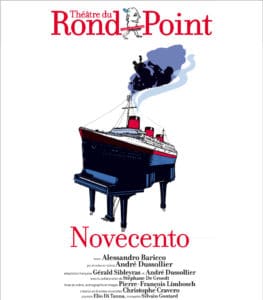Il y a un an précisément, au Grand Palais, se célébrait non sans un certain sens du solennel la carrière de Jean-Paul Gaultier, bien que toujours en vie. A cette occasion, on exposait certaines des créations les plus marquantes de sa carrière, qui n’est pas encore terminée, je suppose. De la robe en toile cirée en passant par les seins coniques pour Madonna, jusqu’à la fabuleuse robe haute couture commençant en marinière pour devenir un éblouissement fait de plumes, cette démonstration tournait pourtant un peu à vide. En vulgarisant et en expédiant ainsi quelques modèles sélectionnés, on nous faisait oublier qui était réellement Jean-Paul Gaultier, avant d’être un habilleur mondain pour icones de la pop-culture.
A la manière d’une visite au musée, les visiteurs, après de longues heures de queue, avaient enfin le loisir de contempler, dans un environnement sombre et étudié, des œuvres qui pourtant n’avaient pas trente ans d’existence. Etrange paradoxe, en l’espèce, que de venir contempler de très près des pièces conçues sur une période de quinze années, comme on viendrait se recueillir devant des antiquités babyloniennes retournées de ces mondes à tout jamais perdus. Très peu de couturiers ont pu connaître de leur vivant pareils honneurs. Le génial Yves Saint Laurent, peut-être, dans les années 90, au Louvre et dans une salle extérieure, mais dans une bien moindre mesure. Ce n’est d’ailleurs qu’une fois mort qu’il aura finalement droit à sa grande exposition, mais « seulement » au Petit Palais…
Cette exposition Gaultier a donc été conçue avant tout pour l’exportation. Avec son tapage médiatique, on y décelait en fin de compte surtout le principe de la jolie vitrine faite pour nous vendre ensuite des livres et des produits dérivés estampillés aux rayures et aux nom et prénom du créateur, en alignement asymétrique. Misère de notre temps où l’on récupère tout pour le mettre dans des boîtes. Et comble de l’ironie pour celui qui a dépoussiéré la mode en France, en se jouant des codes et des différents niveaux de hiérarchie pour évoquer le luxe et le style, avec un premier parfum sorti dont le packaging était une boîte de conserve.
Jean-Paul Gaultier apparaît au début des années 80, comme un lapin qui sort d’un clap, au milieu d’un champ de bataille moribond et venteux, après ses passages studieux au sein des maisons Cardin et Jean Patou. Le premier, connu en son temps, au début des années 60, pour ses innovations, à l’instar de Courrèges et Paco Rabanne, et le deuxième pour sa haute couture et ses fourrures, son savoir faire et le prestige d’une grande maison parisienne d’avant-guerre. Jean-Paul Gaultier gardera de ces expériences un goût prononcé pour l’innovation, le détournement des codes, mais aussi une précision sans faille dans la modélisation et la connaissance parfaite du vêtement.
Dans cette période post-Punk, avec cet esprit épingle à nourrice, motif écossais et godillots militaires qui nous vient tout droit de Londres, et qui le caractérise rapidement, le jeune homme à la brosse peroxydée en utilise les principaux motifs pour se lancer et affiner son propre style. Fort d’une première collection et d’un défilé qui remportent un grand succès critique, mais pas commercial, il devra tout de même attendre l’aide du groupe financier Japonais Kashiyama pour s’épanouir et donner la pleine impulsion à son imagination et son audace, ses principaux partenaires pendant toute la décennie qui allait suivre.
Après dix longues années de pattes d’éph et de chemises col pelle à tarte, le vêtement se radicalise et tout se rétrécit à nouveau. Ouf… Renoma, une célèbre marque de prêt à porter tient le haut du pavé depuis les années 60, mais n’arrive plus à suivre la tendance de la rue, à l’orée de cette décennie qui s’ouvre avec la crise, le sida et François Mitterrand. Place donc à une nouvelle génération de jeunes gens audacieux, nourris au punk, aux multi-références culturelles et biberonnés aux slogans émancipateurs. Il y a bien aussi Kenzo, déjà dans la place, et ses quelques innovations, mais qui restent bien sages et complexées car trop assujetties à la toute omniscience d’Yves Saint Laurent qui règne sans partage sur la mode en France et dans le monde. Le maître de la Couture de la Rive Gauche, qu’elle soit Haute ou bien prête à porter, reste indéboulonnable et les bourgeoises et autres happy fews de l’époque ne respirent que pour ce couturier aux célèbres lunettes et à la voix surannée.
Les grandes maisons d’antan, Dior, Balenciaga, Guy Laroche, Balmain, Givenchy, Chanel ou bien encore Jean-Louis Scherrer sont toutes à l’agonie. N’ayant voulu tabler que sur de la Haute Couture, les salons d’essayage de l’Avenue Montaigne paraissent bien vides dans ces années-là, si ce n’est encore quelques commandes passées par de riches épouses d’armateurs grecs, ou bien des licences pour ceinturons ou chemises ici et là. Mais c’est surtout avec la parfumerie que toutes ces maisons jadis prestigieuses parviennent à sauver les meubles.
Le concept de « Créateur » viendra en fait du Japon dès 1978, avec deux noms qui émergent, Rei Kawakubo et sa marque Comme des Garçons, et Yohji Yamamoto. Tous deux présentent leur première collection à Paris en 1980. Issey Miyake, quant à lui, déjà dans le circuit depuis 1973 au Japon, bénéficiera de cette ouverture pour venir proposer ses savants plissages à la capitale française. Ce qu’on appellera l’« antifashion », avec cette approche plus cérébrale du vêtement, va remettre en perspective tout l’édifice de la mode. Porter du beau, oui, mais cette fois-ci avec du sens…
D’ailleurs, le mot « Mode » n’aura plus vraiment de légitimité avec cette façon de redéfinir l’habillement, puisque malgré les obligations commerciales et les délais qui incombent pour livrer en temps et en heure les dites collections, ces vêtements proposés ne sont plus l’histoire d’une saison, voire même destinés à un homme ou à une femme. Ils sont tout bonnement des pièces avec leur propre histoire, leur propre cheminement, et porter tel ou tel vêtement devient pour celui qui l’acquiert plus qu’un code ou une appartenance sociale.
Avec des silhouettes le plus souvent noires ou bleu marine, ces grandes chemises de popeline de coton blanches aux formes destructurées, assymétriques, savantes, ces vestes, ces robes aux volumes étonnants, ces touches de rouge parfois cinglant l’ensemble, la révolution viendra donc bien du pays du Soleil Levant…
Jean-Paul Gaultier va ainsi arriver dans ce sillage, accompagné aussi de trois autres grands noms qui vont marquer les années 80 : Claude Montana, Thierry Mugler et Azzedine Alaïa. Quatre griffes qui en France vont faire frémir pendant dix ans au moins les attentes des fashion addicts.
Si les trois homologues de Gaultier ont une vision de la femme quelque peu fantasmée, avec tout ce que l’on se rappelle des années 80, les vestes taille de guêpe hypra épaulées chez Montana, par exemple, arboreront des arrondis goldorakesques. Quand Mugler préfèrera les épaules en angles et les silhouettes louchant entre la pin-up 50′ et des courbes insectoïdes, Alaïa accentuera une femme hyper féminine tout droit sortie d’un compte médiéval austère et sexy à la fois.
Une marque comme Marithé & François Girbaud, jusqu’ici confidentielle, va se servir de ce tremplin et l’engouement nouveau pour la « mode autrement », pour revenir aussi au devant de la scène avec ses métamorpho-jeans et ses premières collections capsules.
Quant à Gaultier, il est le plus remarquable des trois, le plus ingénieux, celui qui maniera humour, désinvolture en même temps que savoir-faire et amour du travail bien fait. Jean-Paul Gaultier ne va donc pas chercher coûte que coûte, comme Montana et Mugler, à idéaliser une femme en la rendant fétichiste, futuriste et ultra sexuée. Non, lui va proposer beaucoup plus que ça…
Il y a de l’humilité dans la démarche créative de Jean-Paul Gaultier. Il cite, il égrène ses souvenirs, ce qu’il a vu, vécu, aimé, et il les restitue, en les passant par son prisme personnel. Des créations diffractées, toutes à la fois drôles, enjouées et mélancoliques. Des silhouettes fortes, inédites et belles, qui offrent aux femmes beaucoup plus d’affirmation encore, un travail qui fut commencé en son temps par Saint Laurent, et pour les hommes, une féminisation audacieuse, ludique et une façon de porter un vêtement qui n’est plus juste qu’un uniforme sociétal.
Le succès est assez immédiat, car c’est sûrement Gaultier qui correspond le plus à son époque. Chacun de ses paris est pertinent, même s’ils ne remplissent qu’en partie leur mission, comme la fameuse jupe pour homme qu’il sera le premier à oser faire porter par ses mannequins homme sur les podiums.
Une boutique s’ouvre Rue Vivienne, avec des téléviseurs dans le sol sur lesquels des défilés passent en boucle. Quelque chose de magique s’opère. Pour tous ceux qui ont toujours ressenti de l’excitation à la simple évocation du vêtement et des créateurs, rentrer dans cette boutique et découvrir les pièces reconnaissables à leur petite languette en haut, c’est un véritable enchantement. Et Jean-Paul Gaultier, c’est le plus « créateur » de tous, le plus galvanisant…
Cette manière de travailler les imprimés, les coupes inimitables, la sophistication de chaque silhouette, avec cette manière de porter des vestes hyper-contrées à col châle avec les épaules tombantes, les pantalons extra-larges qui montent au dessus du nombril, des rangers revisitées à bout cubique, broderie et dentelle qui se superposent sur des imprimés camouflage. Jean-Paul Gaultier, c’est ça, sublimer l’anodin de la rue ou le motif désuet en le poussant à son paroxysme. C’est faire du moderne avec du vieux. Rejouer les vieux films de Jean Gabin et de Micheline Presle, mais avec une fougue nouvelle, une énergie incroyable.
Celui qui réinvente la marinière et qui détourne le corset va séduire le monde entier, à commencer par les grandes divas de l’époque en pleine gloire. Si Grace Jones a Alaïa, lui, c’est avec Madonna qu’il triomphe en 1989.
Courant 90, Claude Montana montre déjà ses limites. Thierry Mugler aussi. Leurs styles ne font plus recette et n’arrivent déjà plus à suivre ce qui se profile en venant directement de Belgique. En l’occurence, une nouvelle génération de créateurs tout droit sortie de la prestigieuse Académie Royale d’Anvers. Anne Demeulemeester, Martin Margiela, Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck et Dirk Bikkembergs, j’en oublie probablement, qui font partie de ce qu’on appelle les Six d’Anvers ou la Première Vague. Dans des styles très différents les uns des autres, ils vont rebattre encore une fois les cartes et émouvoir les éditorialistes et les fashion addicts. Ils seront les nouvelles coqueluches pour un certain nombre d’années. Et il y a aura une deuxième puis une troisième vague, avec Raf Simons, Véronique Branquinho, Kris Van Assche parmi les plus connus. Un engouement sans précédant pour la mode belge qui va redéfinir une nouvelle fois les contours de la Hype. Mais ceci est une autre histoire, car les arcanes de la mode sont des méandres où l’on se perd facilement, pour qui ne tient pas le fil rouge dès l’entrée du labyrinthe.
Pour Gaultier, l’état de grâce va durer encore un peu, de par l’aura qu’il génère au delà des aficionados. Alaïa, lui qui n’a jamais rien fait comme tout le monde, en n’organisant ni défilés, ni collections deux fois par an, et surtout en travaillant à son rythme, a du coup toujours su garder son cap et est encore aujourd’hui d’ailleurs extrêmement courtisé.
Viennent ensuite les années 2000 qui voient le monde de la mode de nouveau être chamboulé avec l’arrivée des grandes enseignes telles H&M, Zara ou Mango, qui loin de vouloir proposer de l’innovation, vendent exactement ce que le consommateur modeste attendait depuis toujours, soit des ersatz, des mirages et toujours cette satanée impression de pouvoir avoir un style à vil prix. Mais tout cela a un prix, justement, dans tous les sens du terme. L’amour du travail bien fait, l’artisanat, la confection suivie laisse leur place au mondialisme aveugle et à l’industrialisation négrière.
Paradoxalement, en ce début de nouveau millénaire, on voit le retour des vieilles maisons telles Givenchy, Balenciaga qui emboîtent le pas à Chanel, qui s’était relancée quinze ans plus tôt avec Karl Largerfeld comme directeur artistique vedette. Cette nouvelle décennie verra donc l’avènement des directeurs artistiques, ceux qui donnent le La pour chacune des collections en devenir. Plus que la maison qu’ils représentent, les directeurs artistiques sont de vraies stars, des divas qui dans ce nouveau siècle où la communication sera reine, apportent souvent plus que le produit lui-même. John Galliano pour Dior et Hedi Slimane en sont les plus emblématiques.
Jean Paul Gaultier, dans tout ça, nage la brasse coulée. Heureusement, ses collaborations pour la maison Hermès feront des miracles et consolideront définitivement sa crédibilité. Il va peu à peu abandonner le prêt-à-porter, qu’il préfère laisser au cynisme ambiant pour se concentrer sur la Haute Couture. Et c’est bien ici, dans l’exception, qu’il laissera finalement sa véritable empreinte…
[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Dévoreur Hubertouzot
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Hubert Touzot : Photographe dévoreur d’images