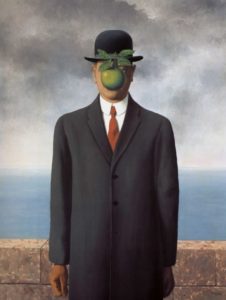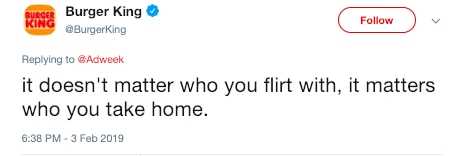Il y a 40 ans, le 09 janvier 1981 précisément, sortait le titre « In The Air Tonight », premier extrait de l’album « Face Value » de Phil Collins. Ce morceau constituera la première incartade en solo du batteur / chanteur, suite à sa prise de distance avec Genesis deux ans plus tôt, et marquera le début d’une carrière très prolifique. A tous ceux qui avaient entre 15 et 20 ans en 1981, cette chanson parle forcément et rappelle quelques souvenirs gravés à jamais dans leur mémoire, entre slows langoureux et échanges de salive interminables…
Dans « In The Air Tonight », Phil Collins exprime toute la colère ressentie suite au divorce d’avec sa première femme, Andrea Bertorelli. On y trouve ainsi des paroles d’une violence rare, telles que « If you told me you were drowning, I would not lend a hand » (« si tu me disais que tu te noyais, je ne te tendrais même pas la main »). Le chanteur dut d’ailleurs se justifier plus tard, en expliquant que la noyade à laquelle il faisait allusion était purement symbolique.
« In The Air Tonight » devint le titre emblématique de la carrière de Phil Collins, pour sa production atmosphérique, l’originalité de sa structure, son thème sombre et l’intensité de sa rythmique. Avant qu’il ne sorte en single, Phil Collins proposa le morceau à son groupe de l’époque, Genesis, mais ses acolytes refusèrent de l’intégrer à leur répertoire, jugeant la chanson trop « simple ». Le succès de l’album « Face Value » fut tel qu’il incitera pourtant Genesis à changer ensuite radicalement de direction musicale. Le clip de la chanson, réalisé par Stuart Orme, a été parmi ceux diffusés le premier jour de lancement de MTV en 1984.
Une légende contemporaine est née autour de cette chanson : les paroles feraient référence à un fait divers, à savoir une noyade accidentelle durant laquelle un proche de la victime ne lui vint pas en aide, tandis que Collins aurait été témoin de la scène mais n’aurait pas pu intervenir à temps. Parmi les différentes variations de cette légende urbaine, certaines prétendent que le chanteur aurait invité par la suite cette personne à l’un de ses concerts et l’aurait fixée du regard durant toute la chanson, ou bien qu’un projecteur aurait été braqué sur elle. Eminem fait également référence à « In The Air Tonight » dans son tube « Stan ». Le Stan en question, qui s’adresse dans la chanson à son idole, Eminem lui-même, compare sa situation personnelle à la noyade décrite dans la chanson de Phil Collins.
Mais quel rapport avec Michael Mann et la série « Miami Vice », me direz-vous ?
[youtube id= »YkADj0TPrJA » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
I can feel it coming in the air tonight
Oh, Lord
And I’ve been waiting for this moment for all my life
Oh, Lord
Oh, Lord…
Le 16 septembre 1984, deux mois après le lancement de la chaîne musicale MTV le 19 juillet de la même année, le premier épisode de la série « Miami Vice » produite par Michael Mann est diffusé sur le réseau NBC. « Miami Vice représentait un changement radical vis-à-vis de tout ce qui était produit pour la télévision à l’époque ». Pour la première fois, une série est construite autour de la musique qui est censée l’habiller. Et pour cause, le cahier des charges qualifie le projet de série « MTV Cops ». C’est ainsi que « Miami Vice » se distingue par sa mise en scène faisant constamment référence à la culture new wave et à la musique des années 1980, avec pour coeur de cible la « Génération MTV ».
« J’ai beaucoup regardé MTV, à l’époque, et « In the Air Tonight » était mon morceau de musique préféré », dit Mann, qui réalisera et produira ensuite quelques monuments du cinéma des années 90, entre « Heat », « The Insider » et « Ali ».
Ça n’est donc pas un hasard si nous retrouvons « In The Air Tonight » dans la playlist du premier jour de diffusion de MTV aux Etats-Unis en juillet 1984, dans le pilote de « Miami Vice » comme dans le tout premier volet de la série, intitulé « Brother’s Keeper », diffusé le 16 septembre 1984 sur NBC… Car Michael Mann conçoit chaque épisode comme un clip vidéo, où la musique est forcément omniprésente. Contrairement aux autres séries de l’époque qui utilisent des réinterprétations de chansons rock, les producteurs de « Deux Flics à Miami » destinent plus de 10.000 dollars par épisode à l’achat des droits d’auteur des tubes de l’époque. Et pour un musicien, pouvoir placer un de ses titres sur la série était immanquablement un gage pour stimuler ses ventes. De nombreux artistes ont ainsi vu une ou plusieurs de leurs chansons habiller des scènes de « Miami Vice ».
Dans la bande-son de ce premier épisode, outre l’habillage musical du compositeur d’origine tchèque Jan Hammer, également responsable du générique, on retrouve The Rolling Stones, Cyndi Lauper, Lionel Ritchie et Rockwell. Quant au titre de Phil Collins, il illustre magistralement la séquence devenue culte, lorsque Ricardo Tubbs et Sonny Crockett, au volant de sa fameuse Ferrari Daytona Spyder noire, se rendent à un rendez-vous avec le trafiquant de drogue colombien Esteban Calderone. Le non-moins célèbre fill de batterie intervient au moment où Crockett sort d’une cabine téléphonique et monte à bord de la voiture.
[youtube id= »-aMCzRj3Syg » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
« C’est probablement la séquence-prototype de Miami Vice », déclarait le réalisateur de l’épisode, Thomas Carter, au magazine TIME en 1985, tout en se félicitant d’avoir eu l’idée de génie d’utiliser la chanson de Collins pour cette scène.
Mais parmi les centaines de titres qui furent utilisés dans les 108 épisodes de 52 minutes, ainsi que dans les trois épisodes de 90 minutes, Michael Mann avouera plus tard que c’est vraiment « In The Air Tonight » qui aura le plus collé au rendu visuel souhaité par le producteur. « Cette chanson est tellement bonne, en termes d’ambiance et de mélodie. Elle aura définitivement marqué de sa patte le programme ». Mann a étudié à la London Film School dans les années 60 et il cite souvent en référence « Alexandre Nevski », la composition de Sergei Prokofiev adaptée à l’écran par le réalisateur Sergei Eisenstein, « la plus parfaite collision entre la musique et l’image ».
Car Mann voulait dès le départ insuffler à la série une sorte de sens hollywoodien du spectacle. « Avec Miami Vice, nous faisions des films d’une heure, pour la télévision ». Et qui dit cinéma et grand écran dit musique et bande-son. C’est ainsi qu’ils adoptèrent une méthodologie différente de ce qui pouvait se pratiquer sur les séries concurrentes de l’époque. Les rushes des épisodes étaient livrés chez Jan Hammer, qui jouait directement sur l’action qui se déroulait à l’écran, sans être dirigé par Michael Mann. Ce dernier n’intervenait ensuite que pour d’éventuels ajustements. Quant au montage final de chaque épisode, il se faisait en fonction de la bande-son, quitte à couper ou à raccourcir certaines scènes pour qu’elles collent parfaitement à la musique.
A noter également que « Miami Vice » fut la première série-télé a être diffusée en stéréo. Tout ça pour dire, Michael Mann doit beaucoup à la chanson de Phil Collins…
Pardon ? Comment ça, « In The Air Tonight » n’est pas un slow ?? Mais… Mais je me vois encore, à quinze ans, danser langoureusement sur cette chanson !
[youtube id= »6CdKeep2huQ » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]