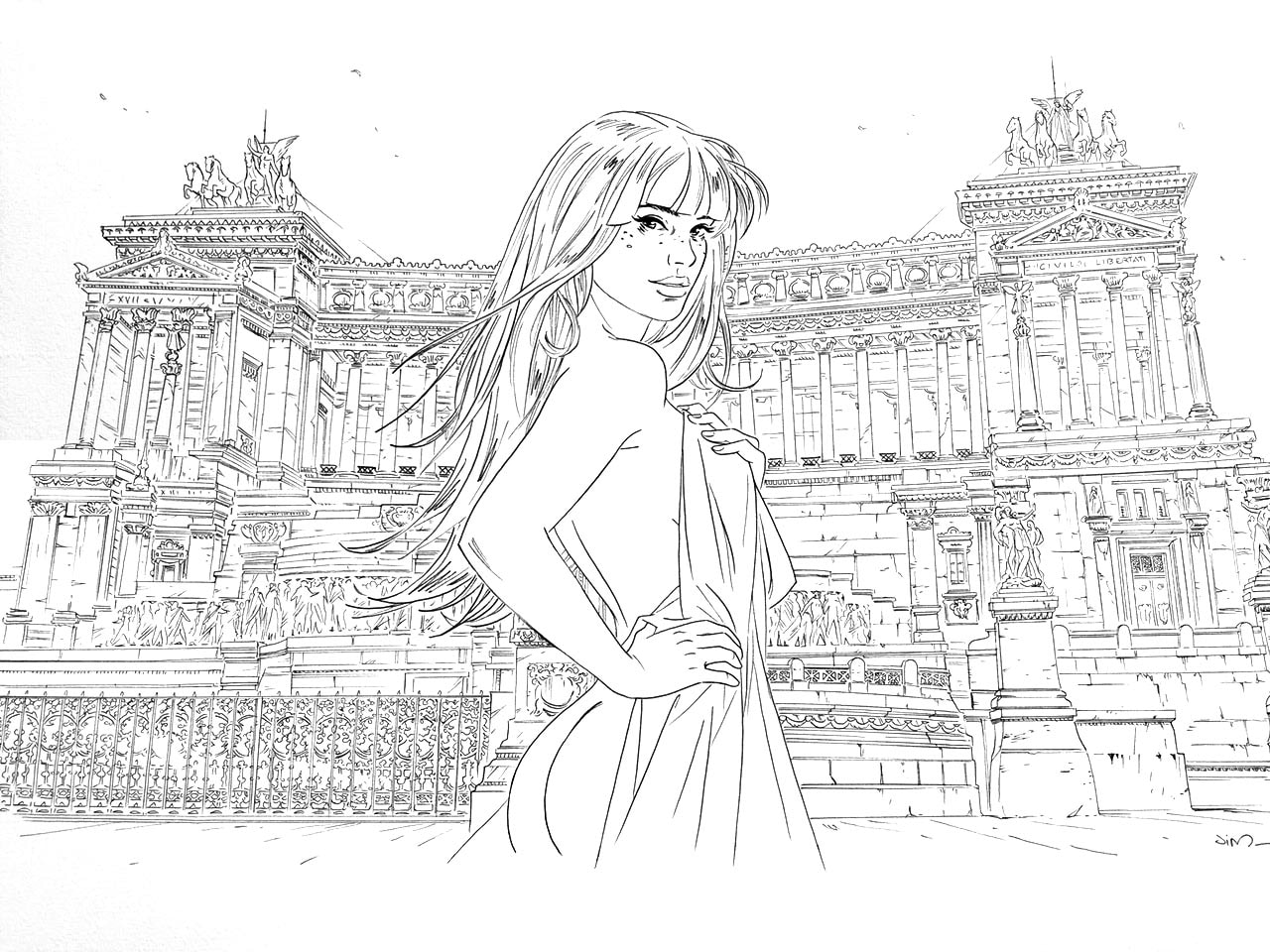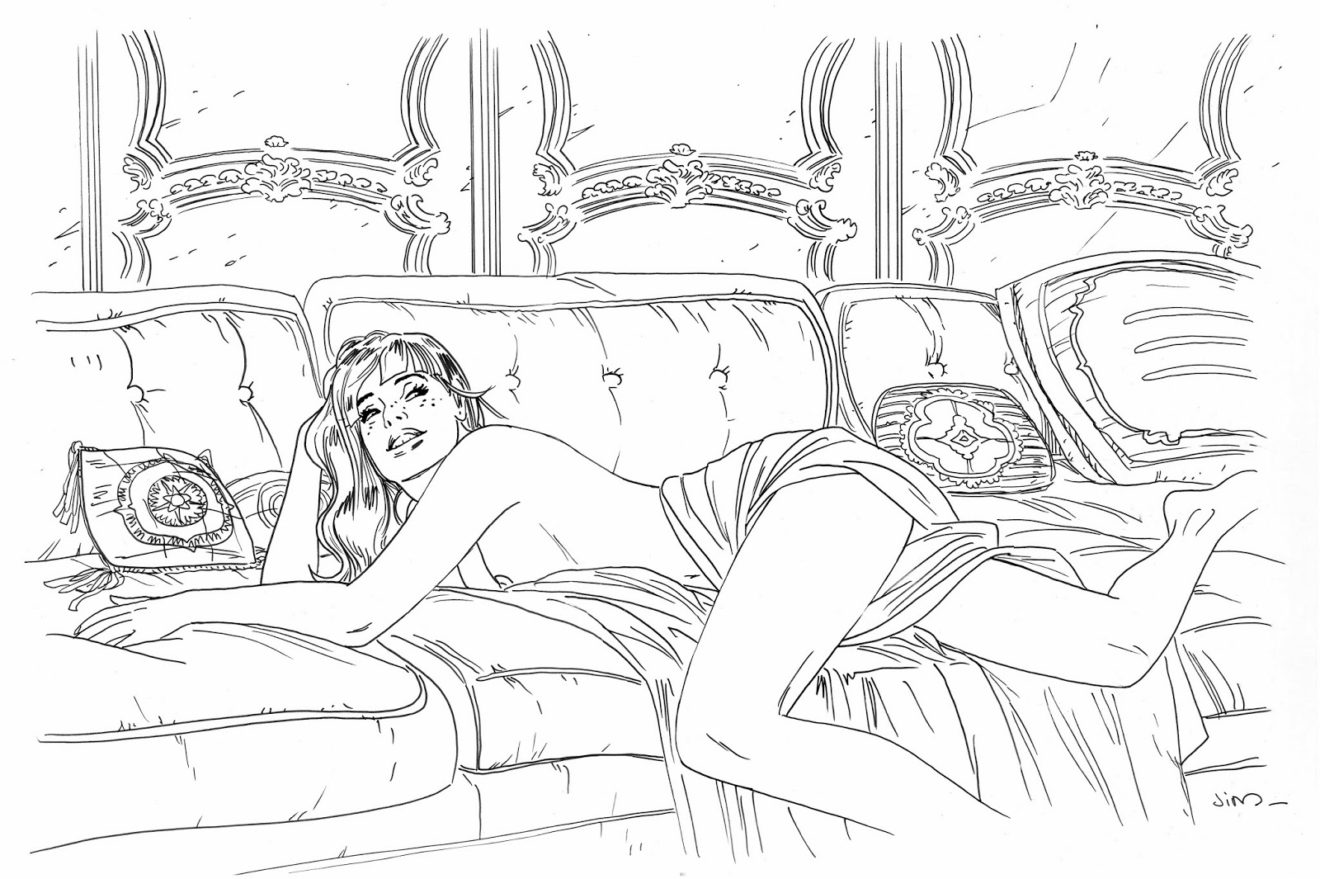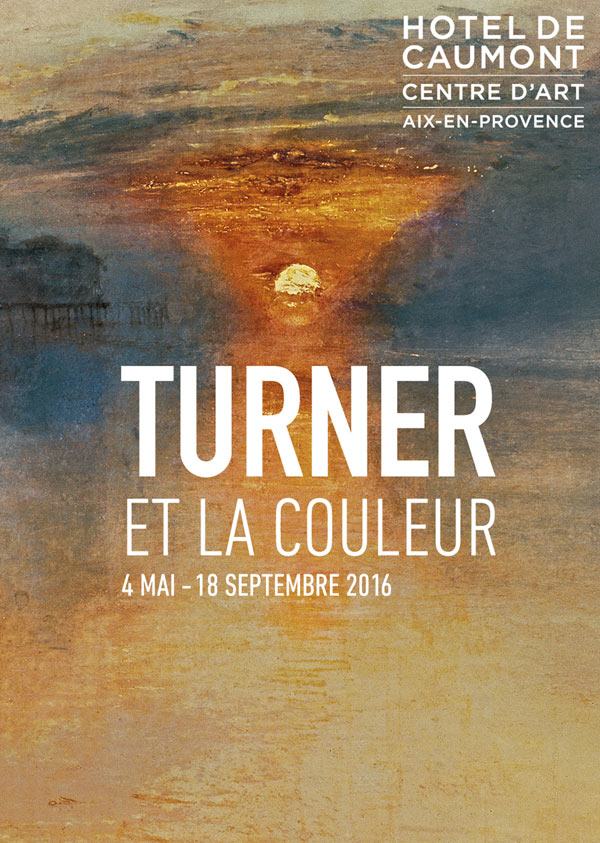1983, un certain Karl Lagerfeld investit les murs de l’une des plus vieilles maisons de Haute Couture françaises, Chanel. Avec ce nouveau directeur artistique, cette institution moribonde rêve de retrouver de sa superbe d’antan, voire même de rajeunir.
Cet ancien grand ami d’Yves Saint Laurent, qui vient d’être engagé par la famille Wertheimer à qui appartient cette maison depuis 1954, tient ici peut-être sa revanche sur celui qui l’a toujours dépassé en tout point. Une rivalité qui existe depuis leur première rencontre, à l’aune de leurs carrières respectives et qui lie les deux hommes, comme un étrange sortilège où s’entremêlent estime, jalousie, respect et amants partagés.
Même après le faste des années 70 et la flamboyance de ses collections, Yves Saint Laurent reste encore l’ultime référence dans ce milieu d’exception et est considéré par tous comme un génie absolue. Karl Lagerfeld, quant à lui, dont le parcours créatif a été plus laborieux, ne semble posséder que le talent.
Néanmoins, cette pureté et cet état de grâce fragile, instable, suspendu au-dessus de Saint Laurent, ont toujours eu besoin de Pierre Bergé pour être canalisés, contenus et exploités. Saint Laurent, aussi génial qu’il put être comme créateur et magicien des femmes, restait aussi ce styliste, ce modéliste en blouse blanche qui travaillait toujours à l’ancienne, prisonnier de son statut, accaparé uniquement par cette fonction de devoir renouveler des collections les unes après les autres, année après année, sans conscience réelle de ce que cela représentait.
Lagerfeld, plus pragmatique et plus visionnaire, a toujours peu laissé de place au hasard ou à une quelconque magie. Travailleur acharné, méthodique et opiniâtre, il savait que son heure viendrait un jour, forcément. Tout ce savoir et cette culture amassée, ces différentes expériences au fil des années, allaient bientôt être payants. Avec l’entité Chanel qu’on lui mettait entre les mains, c’était là une opportunité inespérée de pouvoir enfin concrétiser tout ce qui avait échoué jusqu’à présent, avec ses différents projets avortés. Un laboratoire et une rampe de lancement.
Yves Saint Laurent a connu le succès et les éloges dès le début de sa carrière, d’abord brièvement chez Dior, avant d’être remercié par Marcel Boussac, puis avec sa propre maison créée sous l’impulsion de Pierre Bergé. Saint Laurent – Bergé, une alchimie rare et ce don de pouvoir tout transformer en or. La marque, représentée par ce célèbre logo composé des trois initiales Y S L entrelacées, était devenu un symbole qui exprimait aussi bien le luxe, que la France et l’exception.
Mais des Saint Laurent, il n’y en a qu’un par siècle, voire aucun…
Lagerfeld, quant à lui, n’arrivera jamais à obtenir la moindre reconnaissance ou un quelconque engouement juste avec juste son nom sur une étiquette. Toutes ses tentatives de collections, de sa propre initiative et à différentes époques, se sont toujours soldées par des échecs ou ont été confrontées à une indifférence polie.
Mais faisons un bon en arrière jusqu’en 1955. Karl Otto Lagerfeld est remarqué par Pierre Balmain à un concours, en y terminant d’ailleurs ex-equo avec Yves Saint Laurent. Le célèbre couturier de la rue François 1er propose à ce jeune homme brillant d’origine Allemande de l’assister dans son travail et ses réalisations. Lagerfeld comprend et apprend vite les rouages du métier, les rapports entre les gens, les attentes de la clientèle. Il observe et ne laisse rien de côté, jusqu’au plus petit détail, jusqu’au moindre petit rôle, tout ce qui constitue les arcanes d’une maison de couture. Brûlant les étapes grâce à son caractère émancipé et volontaire, il se voit confier quatre ans plus tard le poste de directeur artistique de la Maison Patou. Une maison de haute couture à l’ancienne, avec ses rites et ses habitudes d’un autre temps, où Lagerfeld se sentira vite à l’étroit. Il y apprendra cependant la rigueur et le sens du détail.
Quand d’autres stylistes ambitieux et forts des expériences vécues dans les grandes maisons de couture, choisiraient alors de continuer logiquement leur ascension comme on ambitionnerait l’Everest, Karl lui choisit plutôt d’emprunter des chemins plus modestes. Comme par exemple, après avoir manié l’organdi et la crêpe de soie, préférer se concentrer sur des collections de vêtements de prêt-à-porter destinées à des grandes enseignes en France, en Italie, en Allemagne ou même au Japon. Comprendre le métier, tous les métiers de la mode de A à Z… C’est avec la maison Chloé en 1963 qu’il décide de renouer avec le luxe, en y créant toute une gamme de bijoux fantaisie et des collections de prêt-à-porter couture.
C’est aussi une époque en pleine ébullition. La mode longtemps restée statique se mue sous l’impulsion d’une nouvelle génération de stylistes tels que Paco Rabanne, Pierre Cardin ou André Courrèges, dont la démarche est en parfaite adéquation avec les nouveaux courants de pensée libertaires de l’époque. La révolution des mœurs et des idées contestataires est devancée par leurs vêtements aux formes radicales et aux matériaux modernes voire futuristes. Cette refonte passe aussi par une démocratisation du luxe et l’idée que le chic et l’allure doivent être à la portée de tous.
Yves Saint Laurent qui ronronne dans sa maison de Haute Couture va se saisir de cette opportunité et proposer très vite une ligne de prêt-à-porter à prix plus abordable. En surfant ainsi sur le prestige de son nom et de son savoir faire, ses collections vont s’exporter partout dans le monde. C’est un carton plein.
Dans son coin, Lagerfeld reste à l’affût, observant scrupuleusement la société en pleine mutation qui ne cesse de changer. Il constate également impuissant l’ascension inexorable de celui qui vient d’être de nouveau acclamé, cette fois-ci pour ses robes-trapèzes Mondrian, et enrage silencieusement de n’être toujours qu’un prête-nom. Est-ce par frustration ou par manque, ou pour un idéal qui semble s’éloigner à chaque fois qu’il avance vers lui, que Lagerfeld multiplie les collaborations comme styliste ou designer, comme avec Fendi ? La marque italienne lui laisse une liberté totale et lui accorde une confiance sans borne pour en changer à sa guise l’esprit, en commençant par son logo qu’il redessine lui-même, avec ces deux F encastrés que l’on peut voir sur tous les sacs à main ou les escarpins qui se vendent dans le monde entier depuis 50 ans.
En ce début des années 80, Chanel n’a plus de prestigieux que ses parfums. Le nom associé au N°5, best-seller incontournable de la parfumerie, reste malgré tout magique, et à sa simple évocation, les yeux brillent. Lagerfeld accepte ce nouveau défi, qui sera de superviser l’ensemble des collections Haute Couture, prêt-à-porter et accessoires, sans en mesurer encore l’ampleur de la tâche et de l’attente. Il s’agit surtout pour lui d’une question d’amour propre, de prestige et d’orgueil, en sachant qu’il met aussi les pieds dans une prison dorée.
Avec son sens inné et précurseur du marketing et de la communication, il va rapidement réaliser tout le potentiel qui dort derrière cette simple enseigne et qui dépasse de très loin par sa simple évocation le prestige des autres noms avec lesquels il a collaboré jusqu’à présent. Cette place dans la lumière, il va peut-être enfin pouvoir y accéder, en vampirisant la marque de l’intérieur pour y graver son empreinte durablement. Force est de constater que 39 ans plus tard, Chanel c’est Karl Lagerfeld et Karl Lagerfeld est Chanel.
Mais revenons au tout début de cette aventure exceptionnelle. En se voyant conférer les pleins pouvoirs et une latitude totale, celui qui arbore déjà à l’époque un catogan va consciencieusement dépoussiérer cette maison située au 21 de la rue Cambon, fondée en 1910, et ce pièce par pièce, objet par objet.
Car finalement, l’esprit Chanel, c’est quoi ?
Des cardigans en jersey et tweed à boutons dorés, de nombreux emprunts à une mode militaire prussienne et masculine, des cabans, des pantalons taille haute, des tailleurs sans col, les célèbres petits sacs matelassés avec leurs chaînes dorées entrelacées de cuir et leurs deux C dorés croisés, un esprit minimaliste et sans exubérance, toute l’influence d’une mode garçonne typique des années 20. Tout ce que Madame Chanel à son époque avait créé comme nouveaux codes vestimentaires émancipateurs, mais devenus aussi avec le temps des artefacts, des chaînons manquants dans l’évolution de la mode.
Ce nouveau directeur artistique est surtout choisi pour redonner à cette maison, à défaut d’une âme, une ambition, une place privilégiée dans le monde de la mode. On a suivi son parcours et constaté les petits miracles qu’il a obtenus chez les concurrents chez qui il a pu officier précédemment.
Karl Lagerfeld va donc d’abord digérer toute l’œuvre de la femme au collier de perles, car il sait qu’on attend de lui qu’il restitue l’éclat d’antan à cette maison, comme le ferait un faussaire. Un travail servile, soigné mais sans éclat. Juste de quoi satisfaire de riches et vieilles Américaine nostalgiques. Heureusement, Lagerfeld a appris tout au long de son parcours initiatique que la mode est amnésique. Car son projet est en vérité beaucoup plus ambitieux. C’est à une métamorphose qu’il songe plutôt, mais qui ne se fera pas non plus du jour au lendemain. Lagerfeld n’est ni fou ni téméraire. Il est méthodiste et allemand accessoirement.
Discipliné, la première collection qu’il présente est un hommage circonspect à tout ce que cette maison de couture a pu proposer de plus acclamé. Il pioche dans les modèles les plus représentatifs imaginés par Gabrielle Chanel, ainsi que dans certains accessoires iconiques. En élève appliqué, il passe le test du premier défilé sans une faute de goût. Et la bourgeoise se pâme… Karl fait des baisemains et des ronds de jambe, et badin, joue le jeu.
La révolution se fera en douceur, par étapes, en gommant progressivement les aspects « mémère » de l’esprit Chanel et en poussant juste certains détails vestimentaires. Il teste au fur et à mesure les réactions à cette réforme qui a pour but d’évacuer à terme les archétypes et certains gimmicks encombrants et obsolètes. Alors on commence à voir des baskets dans un défilé, des combinaisons de moto nippées les unes aux autres, puis un blouson en cuir, des cuissardes. Des matériaux nouveaux tels que le denim utilisé pour l’un de ses fameux cardigans sans col.
Pas un vêtement, un accessoire, un élément qui cependant ne ramène pas au premier coup d’œil à cet esprit Chanel. Astucieux, ludique, comme une musique constituée de samples, ces échantillons de morceaux connus que l’on utilise pour être greffé sur une autre création originale. Lagerfeld fait de même avec, par exemple, les deux C croisés qui deviennent du métal ou de l’or avant d’être montés sur un bracelet en cuir ou une ceinture. Chanel devient logo et Chanel devient alors terriblement cool.
L’une des principales forces de Karl Lagerfeld, constitutives de son talent, c’est qu’il peut sans difficulté s’adapter aux différentes époques qu’il traverse.
Epoques qu’il comprend et qu’il assimile à chaque fois, grâce à la connaissance de tout ce qui les compose, que ce soit culturel, populaire et politique. Il vit pleinement le présent et déteste ressasser le passé, tout en ayant déjà un pied dans l’avenir. En ce sens, c’est aussi l’exact contraire de ce qu’était Saint Laurent, qui lui ne supportait le présent que grâce au passé, comme échappatoire et comme source vitale essentielle. Il aimait s’entourer et vivre parmi les antiquités, les objets anciens. L’avenir le terrorisait. D’une lente et moelleuse mélancolie proustienne, il glissa jusqu’à sa mort avec la dépression.
De son côté, Lagerfeld ne laisse rien au hasard. Il se nourrit du présent et de chacune de ses nouveautés. Au début des années 90, il va anticiper ce que la société deviendra ensuite et sait déjà comment utiliser le pouvoir de l’image et de la communication, deux concepts qui vont bientôt prendre une place inédite dans nos sociétés. Chanel ne sera pas qu’une marque de vêtements de plus, s’adressant à des femmes fortunées. Lagerfeld va lui donner du sens, une direction, et au lieu de se contenter d’un succès mondial, il va peu à peu pousser toujours plus loin les expériences et les concepts. C’est tout un univers cohérent qu’il va mettre en place, en commençant par des défilés monstres, conçus comme d’énormes happenings organisés au Grand Palais, qui vont refléter l’époque et sa démesure, sans occulter la vacuité de la mode et de ce qu’elle représente dans l’inconscient collectif. Avec d’énormes moyens engagés, ces shows sont aussi des forces de frappe stratégiques et financières qui subjuguent, humilient et écrasent toute concurrence.
Au delà du spectacle et de son premier degré, Lagerfeld se joue d’un monde de luxe hypertrophié à la limite de la rupture, parfois beau mais trop souvent vaniteux, mégalo jusqu’au grotesque, jusqu’à l’écoeurement. Lui-même tourne sur la piste de ce cirque baroque, en devenant progressivement un concept, une abstraction, une icône pop déclinée sur tous supports, dessinée, reproduite, facilement identifiable, immuable et totalement en phase avec l’époque. Lagerfeld a dépassé toutes ses espérances. Il est devenu tout simplement l’incarnation de la mode. Etrange paradoxe, cependant, pour quelqu’un à l’égo-trip surdimensionné qui peut en même temps dépenser tant d’énergie, abattre un tel travail, et finalement donner autant de sa vie pour une maison qui a existé avant lui et qui existera sûrement après.
Karl Lagerfeld est bel et bien un paradoxe, ne souhaitant pas être scruté de trop près et ne se prêtant à aucune analyse. Il a toujours brouillé son image, au point de mentir sur sa date de naissance. Il a changé maintes et maintes fois d’aspect jusqu’à celui que nous lui connaissons aujourd’hui, depuis qu’il a entamé ce régime draconien qui lui permit de perdre une quarantaine de kilos, devenu ainsi cet étrange personnage autant reflet que fantôme, enfin débarrassé de toute contingence liée à un âge ou à un quelconque repaire temporel.
Il est devenu une œuvre parmi ses œuvres, ce mutant protéiforme dont l’image iconographique qu’il s’est lui-même créée est indissociable non seulement de la maison dont il est l’ambassadeur, mais aussi de la mode en général et de ce qu’elle représente dans l’inconscient collectif. Celui qui peut concevoir des robes vendues des milliers d’euros mais aussi des vêtements éphémères pour H&M.
Et cette revanche alors, qu’il a finalement assouvie in extrémis au détriment de son vieil ami Yves, aidé en cela par l’érosion du temps et la lassitude ? Il ne s’en souvient plus… Car il est si loin, ce temps d’une mode ultra codifiée, avec ses repaires stricts et tellement vains. Aujourd’hui, Chanel est un empire tout aussi puissant, si ce n’est plus, que l’identité Saint Laurent ; le double C croisé de son logo possède la même force d’évocation que la tour Eiffel sur un T-shirt, et bien plus identifiable désormais que les trois lettres Y S L.
Rétrospectivement l’univers de Saint Laurent reste fort, tenu par quelque chose de mystique et de grand. Et Lagerfeld n’est pas dupe… Il sait que dans 50 ans, ce qu’il a entrepris, créé et propagé ne sera plus qu’une vague anecdote dans l’histoire de la mode, comme un ultime pied de nez warholien.
[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Dévoreur Hubertouzot
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Hubert Touzot : Photographe dévoreur d’images