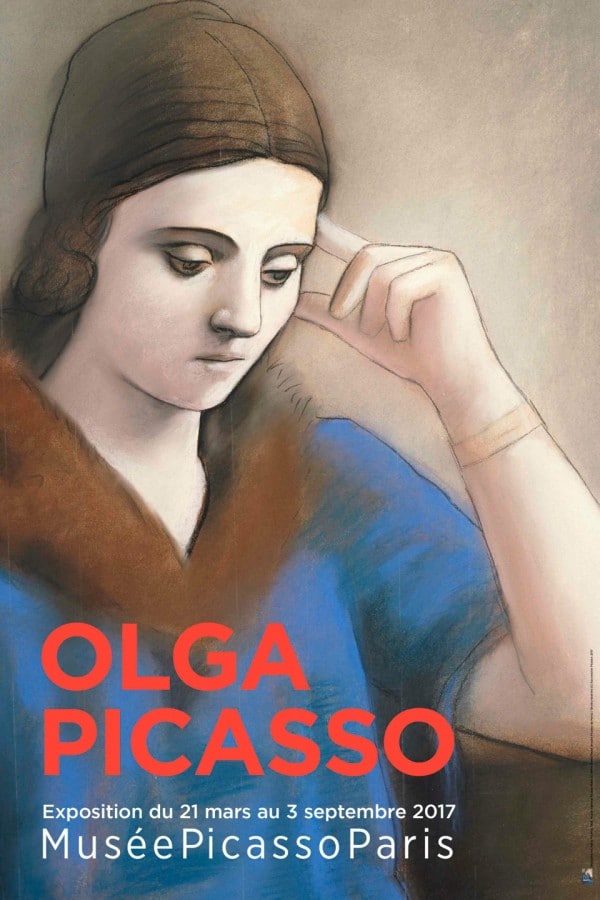Auteur d’une trentaine d’ouvrages, journaliste, écrivain, théologien, Eric Denimal répand « le plus prestigieux des mystères », comme il dit, dans le monde entier. Son livre « La Bible pour les nuls » sorti en 2004, est devenu un best-seller avec plus de 150 000 exemplaires déjà vendus. Ce qui l’intéresse, et ce qui nous a nous aussi intéressés, ce sont toutes les références documentaires du livre de la Bible qu’il nous donne, avec l’extraordinaire talent pédagogique dont il fait preuve. Car Eric Denimal commence par le commencement, et c’est ce qui nous plait. Et au commencement de la Bible, il y a un texte. Un texte qui se vend à pas moins de 50 millions d’exemplaires par an, traduit dans 400 langues, soit le livre le plus vendu et le plus traduit au monde.
Eric Denimal : Aucun livre ne connait une diffusion constante d’une telle ampleur depuis l’invention de l’imprimerie par Gutenberg, en 1451. Le premier livre qui sortit de sa presse fut d’ailleurs une Bible. « La Bible pour les nuls » répond donc à un désir de mieux connaître la Bible, dont je n’avais pas mesuré l’importance. (p. 01)
Instant City : Nous aussi, nous somme très désireux de mieux connaître ce texte qu’on appelle la Bible.
Eric Denimal : C’est un monument littéraire incontestable. Une Bible, dans une édition relativement ordinaire, est un livre d’un millier de pages. Cet ouvrage impressionnant est en fait toute une collection de livres écrits à diverses époques, par une quarantaine d’auteurs parfois très différents, ne s’exprimant pas toujours dans la même langue et moins encore dans un même style (p. 01) (..) La Bible n’est pas un livre comme les autres. Son histoire est exceptionnelle. (p. 09)
Dans un premier temps, « La Bible pour les Nuls » s’attache donc à nous présenter ce texte et Eric Denimal nous fournit des informations sur son ou ses origines, sa transmission et sa conservation à travers les siècles.
Instant City : Le Tanakh est le texte hébreu de la Bible (Bible hébraïque), avec des passages en Araméen. Le livre le plus ancien du Tanakh est la Torah. Il aurait été « écrit » par Moïse. Est-ce par tradition qu’on attribue ce texte à Moïse ou cela s’appuie-t-il sur des bases historiques et scientifiques ?
Eric Denimal : Depuis Moïse jusqu’à Gutenberg, les écrits sacrés (comme les autres, d’ailleurs…) ont été copiés, recopiés et encore recopiés des centaines de fois. (p. 28). On sait qu’Abraham n’a pas écrit, ni Jésus ! Et même si ces personnages avaient écrit, nous n’aurions certainement pas leur texte original. Il n’y a pas de textes originaux, ni pour l’Ancien ni pour le Nouveau Testament. Nous n’avons d’ailleurs aucun texte original d’une quelconque oeuvre de l’Antiquité, pour la simple et bonne raison qu’aucun matériau n’a pu traverser les siècles. C’est la raison pour laquelle il y a eu autant de copies successives. Les conservateurs savaient la fragilité des supports. Comme aujourd’hui, nous faisons de nombreuses sauvegardes de nos écrits, les anciens veillaient à ce que les textes ne se perdent pas. En multipliant les copies et en évoluant avec les supports, on arrive ainsi à conserver des traces. Si la plupart des copies (papyrus, parchemins, codex) n’ont été retrouvées que dans les régions sèches, c’est simplement parce que l’humidité est l’ennemi des archivistes.
La Torah est l’essentiel de la Loi juive et elle est formée des cinq premiers livres de la Bible hébraïque (Le Pentateuque dans l’Ancien Testament). La tradition juive a toujours attribué à Moïse ces livres, et dans les autres textes de la Bible, on évoque toujours la Loi en citant Moïse qui l’aurait reçue de Dieu. Cette conviction est encore présente dans le Nouveau Testament et même dans les propos de Jésus. Par exemple, sur la question du divorce, les prêtres interpellent Jésus et ce dernier cite les prescriptions de Moïse dans la Torah. (Voir Marc 10.2-9). On ne peut donc que se fier à ce que, de génération en génération, on a répété pendant au moins trois mille ans. La science n’est pas capable de faire mieux. Concernant « La Bible pour les Nuls », le but n’était pas d’entrer dans la polémique des interprétations, mais il fallait partir d’une base communément admise, avec une option (qui est déjà une prise de position personnelle) : la Bible explique la Bible, et elle est un livre fiable.
Instant City : Le texte de la Bible viendrait donc d’une tradition orale juive parmi le peuple hébreu. On parle aussi de culture orale, de patrimoine oral ou encore de littérature orale. Il s’agit là d’une façon de « préserver et de transmettre une histoire, la loi et la littérature, de génération en génération dans les sociétés humaines qui n’ont pas de système d’écriture » (Wikipedia). Parfois, le texte véhiculé oralement se transforme, faisant apparaître des variantes, même si le noyau reste commun. Or, ce qui serait extraordinaire avec le texte de la Bible, ce serait justement l’incroyable conformité à la virgule près des copies à travers le temps et selon les centaines, voire milliers, de copistes. Vous dites que le nombre de copies d’un texte vaut attestation. (p. 41). En quoi la copie de copies sur plusieurs siècles sans erreurs est-elle une preuve de la véracité (ou devrait-on dire de la fiabilité) des textes ?
Eric Denimal : Il n’y a pas de ponctuation dans l’Hébreu ancien, donc la formule « à la virgule près » n’est pas conforme. C’est pourquoi Jésus préfère dire que « pas un iota ne changera de la loi » ; le iota étant la plus petite des lettres. Je dis que le nombre impressionnant de copies identiques de diverses époques, sans variations notables et vérifiables, même dans les traductions différentes (pour le Nouveau Testament), est exceptionnel et quasiment unique dans l’histoire de la transmission de textes anciens. Si un texte est falsifié, les copies de ce texte répercutent cette falsification. On devrait donc trouver des copies différentes entre les « originales » et les falsifiées. Mais on n’en trouve pas. Les textes du Nouveau Testament ont très vite été copiés, traduits et cités par les pères apostoliques et par les pères de l’Eglise. Sur les centaines de copies, les milliers de citations, les nombreuses traductions en diverses langues du bassin méditerranéen, on devrait trouver des divergences. Et ce n’est pas le cas. C’est la raison pour laquelle je pense que ce texte est fiable. Les théories (notamment musulmanes) selon lesquelles les textes de l’Ancien et du Nouveau Testament ont été falsifiés sont postérieures au Coran et sont injustifiées. De plus, on sait les différents importants entre les Juifs et les Chrétiens, jusque dans l’interprétation des mêmes textes. Chacun des partis aurait pu, avec le temps, falsifier les textes pour les formater selon ses croyances respectives, or les textes hérités sont identiques de part et d’autre. S’il y a falsification, il faut qu’il y ait eu entente entre les Juifs et les Chrétiens pour que les textes soient falsifiés identiquement dans chacune des religions.
Avant la découverte des manuscrits de la mer Morte, les théologiens libéraux et les philosophes agnostiques mettaient largement en doute la fiabilité des textes anciens. Selon eux, il devait y avoir eu falsification entre les originaux et les copies en notre possession. Les manuscrits de la mer Morte représentent des milliers de textes conservés – et qui ne sont pas que des textes religieux – mais ce sont encore des archives. Autrement dit, tous les textes de l’Ancien Testament qu’on y a trouvés (et qui ont été cachés sans doute avant l’invasion des Romains) sont également des copies de copies. Mais ils sont tous plus anciens que les plus anciens que nous possédions. Parfois, ces archives ont fait faire un bond en arrière de cinq-cents ans par rapport aux textes conservés dans nos musées. La comparaison entre ces nouvelles archives et les documents déjà trouvés, répertoriés, analysés, a permis de vérifier qu’il n’y avait quasiment pas de différences, à quelques lettres près. En tout cas pas de différences qui changent le sens des textes connus. On peut décider que ce n’est encore pas une preuve de fiabilité, mais alors, quelle genre d’autre preuve espérer ?
Instant City : Reprenons les mots : « Texte fiable ». Cela signifie que le texte est crédible, qu’on peut lui faire confiance, qu’on peut le croire. On tombe très vite sur un vocabulaire qui prête à confusion : croire. Ne peut-on utiliser, en toute vérité, d’autres mots ? Un acte (ou encore un document) est jugé « authentique » quand il a été rédigé par un officier public ou ministériel, une personne autorisée par l’Etat à exercer une tâche de service public, nous donne la définition du dictionnaire. Or, le Canon a été constitué par des religieux juifs, des personnes dignes de confiance.
Eric Denimal : Votre définition d’un acte authentique est une définition moderne et qui ne peut être prise en compte qu’à partir d’une certaine époque. Par exemple, jusqu’au XVIème siècle, l’Etat Civil français n’existait pas et c’est l’Eglise catholique qui enregistrait l’existence des personnes. Ses registres étaient pourtant authentiques. Dans l’Ancien Testament, on lit bien que c’est la synagogue et les religieux qui gèrent même la vie civile. Il n’y a pas de mairie ! Pendant des siècles, c’est l’Eglise qui a subventionné les artistes : il n’y avait pas de ministère de la culture… Les écrits religieux conservés par des religieux, c’est donc assez normal. Même Napoléon qui a rédigé le Code Civil, a voulu se faire reconnaître Empereur par le pape. Il est vrai qu’il s’est couronné lui-même tant il croyait à son caractère divin…
Instant City : S’il est admis que le terme « authentique » signifie « dont l’autorité ne peut être contestée parce qu’il émane (le document) d’une autorité non contestée » – comme les registres d’Etat Civil tenus par le clergé – alors, les documents qui émanent des autorités juives de l’époque peuvent-ils être considérés comme authentiques ?
Eric Denimal : La réponse est dans la question. Pourquoi mettre en doute le travail des autorités juives ? La dimension religieuse de ce peuple est dans son ADN et celui qui se présente comme le peuple élu de Dieu accorde à toute chose une importance spirituelle forte jusqu’à l’extravagance, avec une multitude d’interdits pour ne pas pervertir ce qui est juif depuis l’alimentation jusqu’au tissage du tissu, en passant par l’hygiène et l’éloignement de tout ce qui corrompt. Cette attitude que là, on peut juger comme étant intégriste, a au moins l’avantage de respecter la loi et le droit. Cependant, si l’intégrité, l’honnêteté et le sens de la vérité étaient au même niveau à l’époque que sont ces mêmes vertus dans notre présent siècle, tout peut alors être contesté et il ne reste qu’un grand vide et une perte cruelle de sens.
Instant City : Dans votre livre, page 41, vous parlez de tous ces ouvrages datant de l’Antiquité, qui sont considérés comme « fiables » et « authentiques » sans aucune preuve. Par exemple (p. 42) , « La Guerre des Gaules » de Jules César, écrite entre 58 et 50 avant Jésus-Christ. Nous ne possédons aucun texte original écrit de la main même de Jules César, daté et authentifié comme tel. Nous n’avons que des copies, une dizaine environ, qui datent du XVème siècle, soit milles-quatre-cents ans plus tard ! Et pourtant, tous les historiens s’accordent à les trouver « fiables », et ils sont cités en référence comme fondement de l’Histoire de France. Comment expliquer que ce ne soit pas le cas pour la Bible, dont il existe plus de 5 000 copies conformes à la virgule près seulement trois-cents ans après la mort de Jésus ?
Eric Denimal : C’est surtout à partir du XIXème siècle que le rationalisme s’est mis à contester la fiabilité de la Bible et à démonter tout ce que la tradition avait véhiculé. C’est d’ailleurs à cause de ces critiques que la reine Victoria a financé les premières fouilles archéologiques en Terre Sainte afin de trouver des preuves de ce que la Bible racontait. Et l’histoire de l’archéologie (parfois dite biblique) est absolument passionnante, avec des découvertes qui ont quasiment toujours confirmé ce que la tradition biblique avait transmis.
Instant City : On ne trouve aucune trace archéologique de l’Exode cependant.
Eric Denimal : Cet argument n’est pas suffisant : on ne trouve aucune trace des migrations datant de plus de trois-mille ans de peuples dans des zones désertiques. Même des villes entières sont aujourd’hui introuvables (jusqu’ici…) alors que de nombreux documents évoquent leur existence. La découverte des manuscrits de la mer Morte a authentifié tous les textes anciens que l’on possédait, dans le sens de « confirmé ».
Instant City : En conclusion, serait-il juste de dire que des textes écrits par des personnes reconnues comme des autorités morales, issus de la tradition orale, dont des centaines de copies exactes à la virgule près ont passé les siècles, peuvent être par conséquent considérés comme fiables à défaut de pouvoir être qualifiés d’authentiques ?
Eric Denimal : Je ne cesse de dire que ces textes sont fiables, dignes de confiance. Mais dans la confiance et la fiabilité, il y a – étymologiquement – place à la foi. J’ai tendance à faire confiance au texte dont la profondeur et la sagesse ne dépendent pas des auteurs ni des époques de rédaction. Lorsque j’apprécie un « vieux proverbe chinois », je reçois et médite sur le proverbe sans me soucier de son auteur dont le nom et l’existence m’importe peu. C’est le croyant qui décide que les textes bibliques sont authentiques. La raison me permet de dire que les textes sont fiables. La foi me permet de dire que les textes sont authentiques … pour moi !
Instant City : L’argument le plus couramment entendu est qu’au moment de la fixation définitive du Canon lors des Conciles de 397 puis de 1546, les hommes d’église auraient « arrangé » les textes pour que ceux-ci répondent à leur besoin d’obéissance et de soumission du peuple. Est-ce qu’il serait possible que des hommes à cette époque aient réfléchi à une explication de la genèse du monde, à la place de l’homme dans le monde, et qu’ils aient réussi à trouver une croyance qui réponde à toutes les interrogations de l’homme sur l’existence, la mort, la morale ? La Bible pourrait-elle être une création humaine et non la parole de Dieu ?
Eric Denimal : La liste des livres conservés dans la Bible a été fixée bien avant 397. Les Conciles cités ont entériné et confirmé ce qui avait déjà été établi plus tôt. Si vous voulez absolument que les textes aient été arrangés pour les raisons que vous évoquez, il faut qu’ils l’aient été avant la première officialisation en 397 parce qu’en 1546, le Concile de l’époque a confirmé ce qui était déjà fixé en 397. Il est clair que la Bible, comme tout ce qui existe, peut être mise en doute par toutes sortes de théories du ou des complots. Il ne faut pas donner plus de crédit à Dan Brown qu’aux Pères de l’Eglise. Il y a des croyances et des explications du monde fantasmées ou bricolées en fonction de présupposés, voire des systèmes de pensée complaisants avec ce qui convient à ceux qui les proposent, qui les imposent. Sur l’origine de l’univers et du vermisseau qui s’y tortille (l’homme), il convient d’avoir une extrême humilité. Il n’est pas humiliant de réhabiliter le mystère. Et la science n’est pas une déesse, elle est une orgueilleuse qui n’accepte jamais de reconnaître ses erreurs. Par exemple, c’est elle qui, il y a à peine cent ans, démontrait encore que certains humains étaient inférieurs à d’autres. Ce qui a cautionné l’extermination d’handicapés, d’homosexuels et de juifs par millions. Dès lors, je ne peux me fier aux prétentions de la science…
La Bible offre une explication du monde, mais ce n’est qu’une explication. Le récit de la Genèse et les premiers chapitres sont à recevoir comme une espèce de parabole explicative pour le cerveau limité des hommes. La puissance de la vie dépasse très largement les capacités intellectuelles des mortels. Pour moi, l’important n’est pas de savoir comment le monde est devenu monde, mais d’accepter le principe d’une méga-puissance dont nous ne percevons qu’un contour flou. Pour que l’humain, issu de l’humus, sorte de la glaise et envisage une éternité, un infini, une éthique et une morale, il a dû recevoir (et non concevoir de lui-même) un souffle d’ailleurs. Pour moi, j’envisage aisément l’intervention d’un extra-terrestre totalement céleste.
Instant City : Pensez vous que la Bible réponde à un besoin affectif de l’homme ?
Eric Denimal : La Bible répond à tous les besoins. Nos psy ont, par exemple, établi que le tout premier besoin de l’homme est d’être aimé avant même d’aimer. La Bible le dit depuis longtemps : Dieu nous a aimé le premier, puis vient la consigne récurrente : aimez-vous les uns les autres, et apprenez à vous aimer vous-même. Vous pouvez prendre la pyramide des besoins de Maslow et découvrir que la Bible n’en oublie aucun, qu’elle donne des consignes d’une extrême sagesse pour y répondre dans un vivre ensemble d’une grande modernité, et sans l’angélisme de nos politiques. La Bible donne un sens à la vie en lui faisant percevoir une dimension d’éternité. Elle donne des pistes qui touchent toutes les sphères de notre existence. En cette année électorale, par exemple, je découvre dans ses pages des principes remarquables qui éclairent sur des notions comme le pouvoir, l’exercice du pouvoir, les limites du pouvoir, le statut de chef, le statut du peuple, les relations entre les politiques et les citoyens. Il est clair que la Bible ne traite pas seulement de l’aspect spirituel de l’homme croyant. L’enfermer dans ce domaine, c’est n’avoir rien compris de ce qu’elle est. La plus grosse erreur du Christianisme est de l’avoir confisquée alors qu’elle est pertinente pour toute l’humanité et pas seulement un guide pour la foi.
Instant City : Quel était votre cible, le public visé ?
Eric Denimal : J’ai souvent été présenté comme un « remarquable vulgarisateur ». J’aime beaucoup être perçu comme un vulgarisateur, même si je suis aussi théologien. Nous ne sommes pas nombreux à rendre accessible ce qui est parfois présenté comme hermétique par des spécialistes jaloux de leur savoir. Il n’est pas difficile d’être « remarquable » et donc remarqué, quand nous sommes peu à décider de montrer la lisibilité de la Bible, et son accessibilité. En son temps, l’Église catholique du Moyen-âge a voulu une traduction latine moderne de la Bible. Cette traduction de Saint-Jérôme a été appelée la Vulgate, c’est-à-dire en langue « vulgaire », à l’usage du plus grand nombre. Depuis le XVème siècle, le Protestantisme (et avant lui les pré-réformateurs) a toujours insisté pour que le lecteur puisse lire la Bible dans sa propre langue afin d’avoir un lien étroit et personnel avec le texte. Mon souci permanent est de permettre au plus grand nombre de découvrir la richesse et la beauté de cette Bible.
Instant City : Lors de votre relecture, avez-vous veillé à votre vocabulaire ? Avez-vous censuré des mots trop érudits ?
Eric Denimal : En tant que journaliste, j’ai un jour essayé de suivre les entretiens de Bichat. Il s’agit d’une session de travail durant laquelle de grands spécialistes en médecine traitent de tout ce qui touche à la santé. Le néophyte est complètement largué alors que les participants jouissent intellectuellement de tous les échanges sur les travaux en cours. Aussi passionnant que soit le monde (microcosme) de ces savants et praticiens médicaux, ils sont dans une bulle impénétrable. Les théologiens, comme n’importe quels spécialistes, sont aussi dans leur univers avec un langage propre. Mais ce langage a été forgé par des hommes pour définir autant que possible ce qu’ils tentent de comprendre. Et souvent le langage complexifie ce qu’il veut expliquer. On peut parler de substitution pour expliquer le principe du sacrifice, ou de transsubstantiation pour parler du dernier repas de Jésus, mais alors, qui percute quelque chose ? Un Français moyen dispose d’un lexique de 5000 mots mais 10 % de la population française ne dépasse pas les 400 à 500 mots. Cela montre le travail nécessaire !
Instant City : Qu’en est-il de ce projet intéressant d’une « Théologie pour les nuls » ou d’une « Exégèse pour les nuls » ? Je trouve que c’est une excellente idée car certains lecteurs, dont je fais partie, ont beaucoup de mal à trouver sur internet des interprétations (des explications), des paraboles ou des évangiles, par exemple. Une synthèse des interprétations…
Eric Denimal : Le succès de librairie que connait la « Bible pour les Nuls » tient en grande partie au fait que c’est un livre qui explique le contenu de la Bible mais qui n’apporte pas d’interprétations. C’est ce qui fait que ce livre a été salué autant par les catholiques que par les protestants et même par les juifs. C’est avant tout non une énième traduction de la Bible mais une introduction à la Bible. Sans oublier l’histoire de sa rédaction et de sa composition : une histoire unique. Une « Théologie pour les Nuls » devrait proposer les interprétations possibles des textes. Si la piste est intéressante, il faut savoir que ce sont les interprétations différentes qui ont provoqué les scissions, les schismes et parfois même les guerres entre croyants. J’ai, dans ma bibliothèque, un livre de cinq-cents pages qui tente de faire une synthèse des meilleures interprétations de l’Apocalypse de Jean. L’Apocalypse, dans ma Bible, c’est un texte de 18 pages. Le commentaire se nomme « La Clarté de l’Apocalypse » et franchement, la clarté des synthèses n’est pas aussi évidente que cela.
Tout au long des vingt siècles du Christianisme, et depuis plus longtemps encore pour le Judaïsme, des hommes érudits ont disséqué le texte biblique et des millions de volumes ont été écrits. Le chantier n’est donc pas nouveau et ne sera jamais achevé. Personnellement, et pour un autre livre, je me suis arrêté sur un thème : le Christ selon Jésus. Je ne me suis servi que de l’Evangile de Marc (le plus court des quatre) pour faire le portrait du Messie attendu au travers des actes et des propos du fils du charpentier. Ce simple angle journalistique m’a ouvert des pistes insoupçonnées et a élargi ma perception de la personne de Jésus. La Bible est un diamant brut dont on peut faire jaillir tant et tant d’éclats qu’on ne peut qu’aboutir à la conclusion suivante : c’est un livre exceptionnel. Les Éditions First viennent de rééditer en format « Poche » un de mes livres épuisés depuis quelque temps : « Le serpent qui parle ». Dans ce livre, je suis sur un tout autre registre puisque j’aborde des sujets difficiles de la Bible, notamment les épisodes dans le Jardin d’Eden, et je tente une interprétation. Cette fois, je suis dans le rôle du théologien et non plus du journaliste. Et le livre est tout différent.
Instant City : Lorsque vous dites que vous n’aviez pas mesuré l’importance de l’engouement qu’allait susciter le livre, à quoi vous attendiez-vous ?
Eric Denimal : Pendant près de dix ans, j’ai été éditeur dans une petite structure protestante. En lien avec de très nombreux éditeurs « confessionnels », je savais quel était le seuil des ventes des livres à thème religieux ; le succès d’un titre restait un chiffre relativement modeste (environ 2 000 exemplaires pour les « succès »). Mais en même temps, les éditeurs confessionnels (outre de grosses maisons catholiques, mais souvent généralistes comme Cerf) ont des réseaux de distribution peu performants. Les librairies religieuses ne sont pas légions. C’est la raison pour laquelle, mon intuition était que pour toucher le grand public, il fallait passer par une maison d’édition généraliste avec une diffusion aussi large que possible. Les éditions First, avec leur collection « Pour les Nuls », étaient idéales pour atteindre ce double objectif. Ce qui a intéressé l’éditeur, c’est que je suis à la fois théologien et journaliste. Il fallait, pour la lisibilité et le sérieux mentionnés plus haut, à la fois quelqu’un qui maîtrise le sujet, et qui sache restituer les informations de façon accessible.
Instant City : « J’ai découvert qu’il y a une curiosité, une soif , une attente de découvrir la Bible », dites-vous. Comment expliquez-vous le succès de « La Bible pour les Nuls », face aux centaines de livres disponibles sur la Bible ? Ce n’est après tout qu’un énième livre en plus. La différence tient-elle au format (à la formule) ? Est-ce un genre de manuel pédagogique à destination des prêtres ou catéchistes pour leur apprendre à s’adresser aux non-croyants ou aux convertis débutants ?
Eric Denimal : Il existe beaucoup de livres sur la Bible, mais souvent, ils sont proposés par des maisons d’éditions confessionnelles et les lecteurs ont alors peur d’une récupération, d’une orientation. L’avantage de la collection « Pour les Nuls », c’est qu’elle est généraliste. La réputation de ses manuels pédagogiques n’est plus à faire. « La Bible pour les Nuls » est sans doute utilisée par des prédicateurs laïques, par des catéchistes (notamment La Bible pour les Nuls Junior), mais aussi par beaucoup de chrétiens « ordinaires » qui ont envie de se documenter. Sans parler des personnes curieuses de savoir ce que contient la Bible et qui refusent d’être entrainées dans un système de pensée plus ou moins ecclésial. Par ailleurs, « La Bible pour les Nuls » est une véritable encyclopédie qui permet de tout savoir (ou presque) sur la Bible.
Instant City : Vous avez dû recevoir énormément de courrier contenant des remarques, des demandes de corrections ? Qui a le plus mal accueilli votre livre ?
Eric Denimal : L’accueil a été globalement très positif et le succès permanent de ce livre prouve qu’il est apprécié. Quelques théologiens ont regretté que je ne mette pas de réserve sur le texte, notamment le courant libéral qui aurait préféré que je dise que des doutes existent sur tel auteur, tel livre etc… Mais alors, cela devenait de la théologie et ce n’était pas l’objectif du livre. Quelques personnes se sont étonnées qu’un tel volume soit l’oeuvre d’un seul auteur et non d’une équipe de rédaction. Quand je me suis lancé dans le « Jésus-Christ pour les Nuls », je me suis associé à un autre grand spécialiste pour enrichir l’information. Écrire à plusieurs mains est un exercice bien intéressant. Cette fois, certains m’ont demandé : « Pourquoi as-tu fait appel à Matthieu Richelle et pas à … ? » On suscite toujours de drôles de réactions, et passablement de jalousie.
Instant City : Quel est votre personnage biblique préféré ?
Eric Denimal : Joseph vendu par ses frères, dans l’Ancien Testament. Jésus, naturellement, dans le Nouveau Testament.
Instant City : « Je suis un passeur, je montre un chemin, je suis un poteau indicateur : j’oriente la réflexion ». Pourquoi avoir choisi l’écriture comme mode de partage ?
Eric Denimal : C’est mon meilleur mode d’expression. Je suis nul en musique, en sculpture, en peinture… Un autre lieu d’expression possible aurait été le théâtre. Cette passion se vérifie quelque part puisque j’ai écrit avec Roland Giraud et avec Gisèle Cascadesus. Mais avec eux, je suis resté journaliste. Pour tout vous dire, mon rêve serait aujourd’hui d’écrire pour le théâtre. J’ai apprécié l’audace de Frédéric Lenoir et sa pièce « Bonté divine » dans laquelle a d’ailleurs joué Roland Giraud.
Nos remerciements les plus chaleureux à Eric Denimal pour le temps passé à nous répondre.
Bibliographie :
✓ La Bible illustrée pour les nuls (nouvelle édition, octobre 2016)
✓ 50 notions clés sur la Bible pour les nuls (mai 2016)
✓ Le serpent qui parle (2016)
✓ Le Nouveau Testament pour les nuls (novembre 2011)
✓ L’Ancien Testament pour les nuls (novembre 2011)
✓ Jésus-Christ pour les nuls (2014)
✓ Les grands personnages de la Bible (2006)