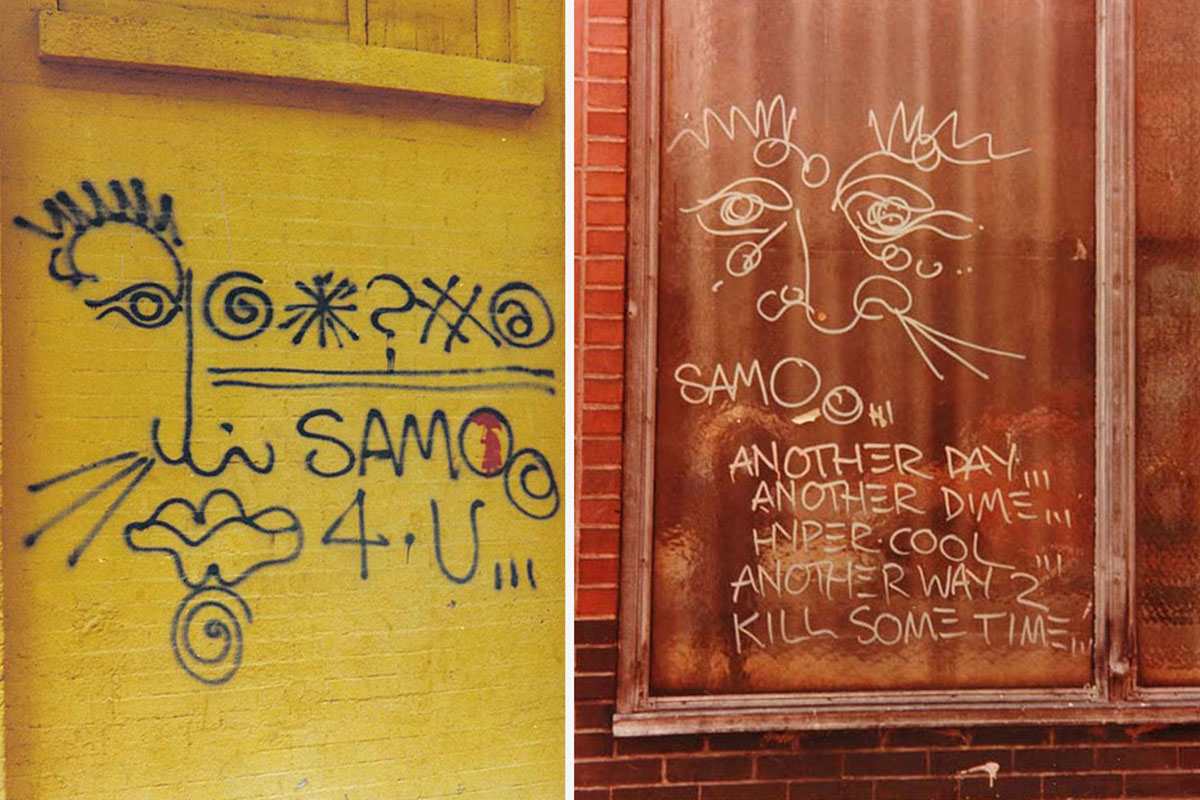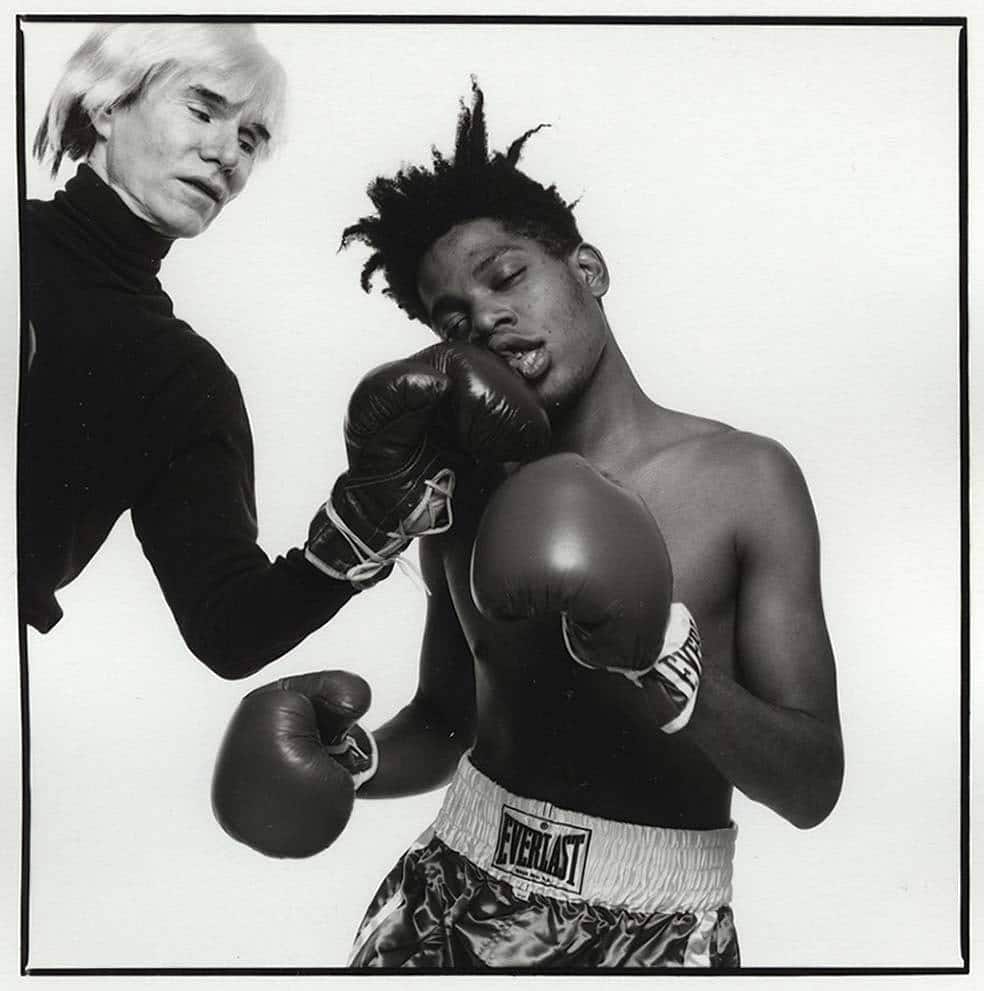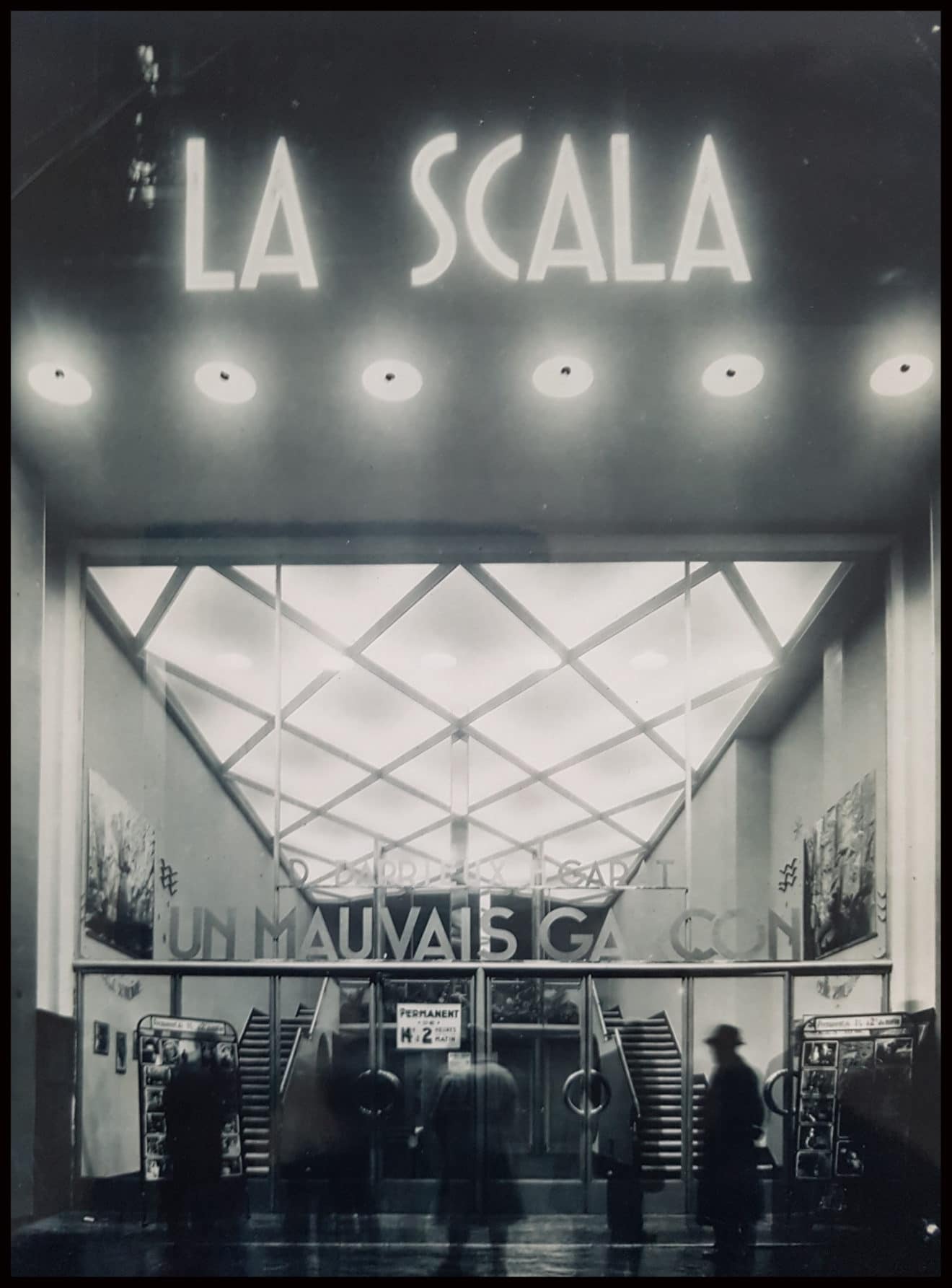Aborder la carrière d’Ennio Morricone, c’est un peu comme avoir l’outrecuidance d’essayer de décrypter le travail de Dieu sur terre.
Voyez-vous, en gros, l’échelle des valeurs, et où s’y situerait le compositeur et chef d’orchestre italien ? Oui, Ennio Morricone est un génie, un dieu, sans conteste le plus grand des compositeurs de musique de film. Souvent copié mais jamais égalé… Il est toujours vivant, et je me fiche de le savoir, en fait, car ses chefs d’œuvre sont bien installés dans l’imaginaire collectif depuis un demi-siècle déjà. Aujourd’hui, le maestro se contente certes de diriger des concerts pour le prestige poli de soirées de gala dans des salles remplies le plus souvent de messieurs et dames qui s’en tamponnent le coquillard de ce qu’ils écoutent. Certes, il a récemment composé un thème original pour faire plaisir à Quentin Tarantino, qui l’utilise dans pratiquement tous ses films. Il y a bien encore de temps en temps une composition pour tel ou tel film plus ou moins oubliable. Vieillard transformé en institution, bardé de récompenses et de médailles en tous genres, Morricone est l’un de ces derniers monstres vivants, à l’instar de Lalo Schifrin, Quincy Jones ou Herbie Hancock, qui ont dans leurs genres respectifs transformé et bouleversé le son des musiques de film, et plus généralement notre sensibilité musicale ainsi que notre goût pour le cinéma.
C’est dans les années soixante qu’Ennio Morricone surgit, en même temps que John Barry et Lalo Schifrin, dans le paysage un peu routinier de l’habillage musical de film. De nouveaux noms, qui n’étaient pas prédisposés à emprunter cette voie, vont tous partir du même postulat pour accompagner un film et lui apporter une singularité, une identité, ce petit supplément d’âme qui fait la différence. C’est ce que ces nouveaux compositeurs vont justement mettre en œuvre pour faire avancer le cinéma vers une autre approche du ressenti et de l’implication émotionnelle des spectateurs. La musique ne sera plus là simplement comme accompagnatrice ou illustratrice d’une scène, d’un geste ou d’un sentiment, mais bel et bien un personnage à part entière qui influera sur l’histoire elle-même. La musique pourra devancer l’action, elle pourra exprimer beaucoup d’autres choses qu’on ne voit pas forcément à l’écran, mais qui sont censées faire partie de l’univers décrit par le réalisateur. La musique va devenir intuitive, ludique, interactive et installer un dialogue entre l’oeuvre et le spectateur. C’est bien dans les années 60 et encore davantage dans les 70 que le cinéma deviendra toujours plus immersif.
Le plus souvent, la musique se composait après que le film ait été réalisé, monté et sonorisé. Le compositeur attitré devait se contenter, tel un peintre, d’accommoder ici et là la touche, la couleur et d’habiller les surfaces demandées. Suite à sa rencontre avec Sergio Leone, et la longue collaboration de toute une vie qui s’en suivit, Ennio Morricone allait prendre le problème à l’envers en composant la musique avant que le film ne soit produit. Le réalisateur du « Colosse de Rhodes » avait donc le score de son futur film déjà prêt sur le tournage et articulait ce qu’il avait écrit en fonction de la puissance émotionnelle de ce que Morricone avait composé, projetant ce que le film serait, une fois abouti… Avec « Pour une Poignée de Dollars » naîtra une collaboration qui allait durer huit films. C’est à la lecture de l’histoire ou du scénario que Morricone imaginait en quelque sorte son propre film et son propre ressenti. A l’arrivée, les films de Sergio Leone gagnaient en force, en puissance décuplée, ultra-iconographique et tout faisait sens.
Au delà de cette approche qui n’appartient sans doute qu’à Morricone, c’est bien la magie exercée par tous ces grands noms de la bande originale de film qui est parvenue à rendre viscérale et entière leur musique, à l’instar d’un John Williams sur une quantité impressionnante de films et leurs thèmes légendaires (« Jaws », « Star Wars », « Superman », « Indiana Jones », « Harry Potter », « Jurassic Park »…), John Barry et les « James Bond », Lallo Schifrin et « Bullit », « Tango », « Mission Impossible », « Mannix ». Des identités musicales indissociables des films qu’elles représentent. Ainsi, la grande force de tous ces compositeurs de génie, à commencer par celle du plus génial d’entre eux, c’est qu’ils ont su évoluer avec les époques qu’il traversaient et s’y adapter.
Jouer et composer à contre-courant d’une mode, comprendre le film et son auteur pour essayer de faire ressortir l’œuvre par l’emploi inédit d’instruments, de voix et de tout ce qu’il était possible de mettre au service de la création pure.
Edda Dell’Orso, la grande chanteuse soprano, fut avec Sergio Leone et Bruno Nicolaï, une autre des contributions majeures au rayonnement de l’œuvre de Morricone. C’est avec « Le Bon, la Brute et le Truand » que leur collaboration démarre, et elle durera le temps d’une centaine d’autres titres qui suivront jusque dans les années 80, avec une des plus emblématiques B.O., celle de « Once Upon A Time In America ». Edda Dell’Orso, c’est cette voix féminine qui semblait descendre du ciel pour y remonter aussitôt et qui a toujours donné un avant-goût d’impalpable, de doux, de mélancolique et de céleste.
Replongeons par exemple dans la scène d’ouverture de « Il était une fois dans l’Ouest », juste après l’intro et le massacre par une horde de tueurs de toute une famille qui se préparait à un mariage, cette scène dans laquelle Claudia Cardinale descend du train dans une petite bourgade de l’Ouest, en pleine construction. On est censé venir la chercher mais personne ne viendra. Elle attend. La musique commence, douce, cristalline, et constituera le thème récurrent du film, à chaque fois qu’apparait ce personnage : le thème de Jill. La voix d’Edda Dell’Orso fait son apparition. On comprend, avec juste quelques plans et cette musique, que cette femme devait se marier aujourd’hui. La musique continue et semble la suivre, comme une Louma, lorsqu’elle rentre dans la gare pour demander des indications. On la voit ensuite ressortir et la caméra s’envole avec la musique. C’est à ce moment précis, lorsque nos poils se dressent sur les bras et que nos yeux s’écarquillent, embués, que l’on sait que Sergio Leone et surtout Morricone nous feront aimer le cinéma inconditionnellement. La fameuse magie du cinéma…
Avec sa formation de trompettiste puis de chef d’orchestre classique, ayant fait ses armes en passant par la radio et la télé où il composa des génériques, des jingles, Ennio Morricone saura donc manier toutes ces connaissances pour les fondre ensemble. Pas étonnant que sa musique soit aujourd’hui parmi les plus utilisées par les arrangeurs et divers Dj, pour être mixée et en faire de nouveaux morceaux. Morricone fut en quelque sorte le premier grand mixeur de l’histoire de la musique, un expérimentateur, un sorcier. Dans les années soixante, on assiste aux déferlantes Atonale, Dissonante et Bossa Nova, ce courant musical apparu dans les années 50 au Brésil. Utilisé partout ailleurs comme ce que l’on qualifierait de nos jours de « Musique Lounge », Morricone va quant à lui s’en servir pour composer ses premières musiques de film, notamment pour des giallos ou des comédies sentimentales, en y injectant des sonorités plus angoissantes.
Tandis que François de Roubaix, Michel Magne, Pierre Jansen ou Pierre Henry suivaient les traces de Ligeti ou de Stockhausen en France, sans trop savoir où aller avec cette musique dite répétitive et aux premières sonorités électroniques, outre-atlantique, Jerry Goldsmith avait quant à lui déjà bien compris l’utilité de cet héritage, en mélangeant ces sons atonaux produits par des machines avec un orchestre symphonique (« The Illustraded Man », « La Planète des Singes »). Ennio Morricone, plus radical encore et toujours plus moderne, poussait donc l’idée de mélanger tous ces sons et ces influences pour exprimer l’époque et cette ébullition permanente que l’on trouvait aussi bien dans le cinéma (La Nouvelle Vague) que dans la musique (tous les noms précédemment cités) ou dans la mode (Cardin, Paco Rabanne, Courrèges).
Aujourd’hui, revoir bon nombre de ces films italiens de qualité toute relative souligne le fait que Morricone ne se moquait jamais du film qu’il devait illustrer, comme d’aucun l’aurait fait d’une commande alimentaire. A chaque fois, on est stupéfait de la richesse thématique, mélodique, de la sophistication des arrangements déployés. « Metti Una Sera A Cena », comédie polissonne italienne avec Jean-Louis Trintignant ou bien encore « Crescete E Moltiplicatevi », film d’exploitation italien du début des 70’s, avec histoire prétexte et jeunes femmes dénudées, sont deux exemples frappants de films passables soutenus par une musique assez dingue.
Ennio Morricone était en fait à l’aise avec n’importe quel genre que l’on pouvait lui soumettre, alors qu’on a un peu trop tendance à le cantonner strictement au rôle de compositeur de musique de westerns spaghetti, et surtout à oublier qu’à l’époque, Bruno Nicolaï (qui oeuvra au côté de Morricone comme arrangeur et orchestrateur pendant plus de vingt ans), Luis Bacalov, Riz Ortolani, Piero Umiliani étaient eux aussi d’authentiques et talentueux compositeurs de musique de film, et que tous ont créé pour des genres très différents, du Giallo au Polar, en passant par le Western ou les films érotiques bon teint. C’est d’ailleurs ce qui fait la force et la richesse de la musique de film transalpine, si on la compare (mais peut-elle être comparée ?) à celle produite en France, en Angleterre ou aux Etats-Unis.
L’autre force du cinéma Italien, c’est l’ouverture d’esprit qui a toujours fait tant défaut au cinéma français. Que ce soit pour la musique ou pour les thèmes abordés au cinéma, les compositeurs et réalisateurs n’ont pas de problème avec les étiquettes. Ainsi Morricone a pu passer du film bis d’exploitation à des œuvres à gros moyens et à renommée internationale, avec la même élégance et le même sérieux dans la manière de travailler.
Durant les décennies 60 et 70, le cinéma offrait une totale liberté aux compositeurs. Ce n’est pas pour rien si les meilleurs B.O. de films ont été composées dans ces années-là.
Morricone a tout d’abord collaboré à la production de films italiens dans les années soixante, avant de s’exporter en France dès les années soixante-dix, avec en particulier Henry Verneuil et ses polars louchant justement sur le cinéma italien (« Peur sur la Ville », « Le Clan des Siciliens ») ou américain (« Le Casse », « Le Serpent » ou « I Comme Icare »)… Mais s’il y a des œuvres plus prestigieuses que d’autres, que le public ou Morricone lui-même mettent hélas trop en avant, avec des concerts qui sentent le sapin et le syndrome Charles Aznavour, il y a pourtant d’authentiques chefs d’œuvre un peu passés à la trappe, qui pourtant n’ont jamais perdu de leur puissance, de leur modernité et de leur créativité. Pour faire court, les musiques de « Danger : Diabolik » de Mario Bava, « Le Venin de la Peur » de Lucio Fulci, « Enquête sur un citoyen au dessus de tout soupçon » de Elio Petri, « La Dona Invisibile » de Paolo Spinola, « Photo Interdite d’une Bourgeoise » de Luciano Ercoli… Et je ne cite pas les films de Dario Argento, où Morricone a contribué grandement à l’univers torturé et expressionniste du réalisateur de « Profundo Rosso »…
Ennio Morricone, l’homme aux cinq-cents musiques de film, et peut-être encore d’avantage, puisque l’on découvre tous les jours des musiques composées pour des films totalement oubliés, le stakhanoviste de la B.O., capable de travailler sur trois, quatre ou cinq films par an, n’a jamais démérité ou exercé son talent par dessus la jambe. Retravaillant, recréant, réinventant ou revenant sur des partitions qu’il avait jugées faibles au moment de leur création, pour mieux les faire aboutir sur un autre film des années plus tard, Ennio Morricone a façonné son œuvre comme un tout, avec cohérence et la satisfaction de laisser derrière lui un héritage digne, beau et intemporel.
[youtube id= »CdL__zuZvpA » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Dévoreur Hubertouzot
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Hubert Touzot : Photographe dévoreur d’images