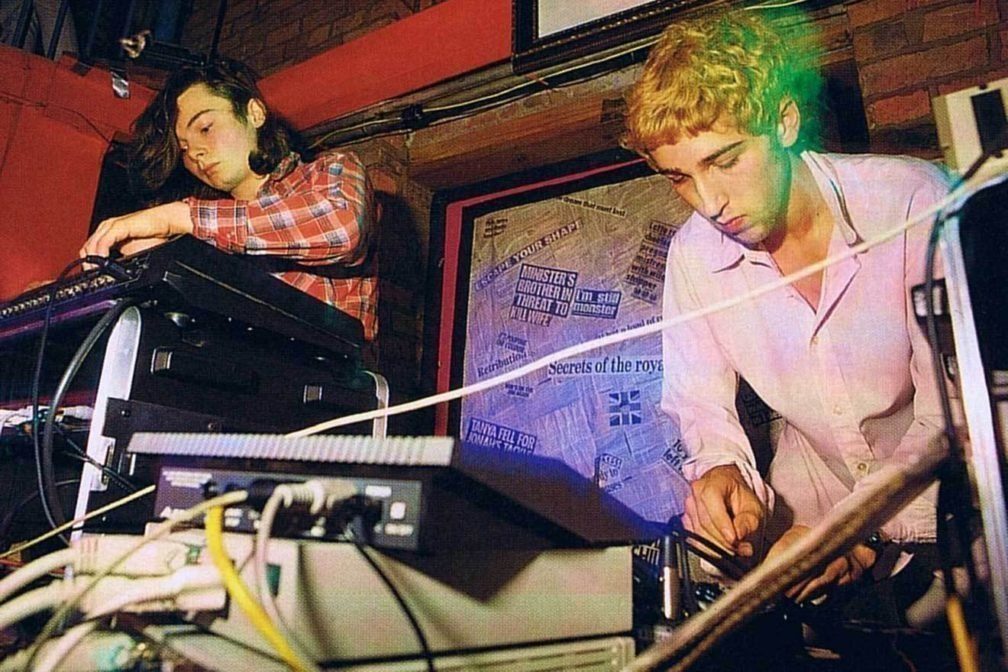Robert Johnson n’est pas un bluesman parmi tant d’autres… Avant lui, il y eut bien quelques bluesmen fondateurs, de W.C. Handy à Charlie Patton, en passant par Tommy Johnson, parmi lesquels certains sont d’ailleurs passés à la postérité. Après lui, et jusqu’à nos jours, pléthore de bluesmen ont bien-sûr continué à écrire l’histoire de cette musique… Mais Robert Johnson est le blues.
D’abord, cette vie… Une vie digne des plus beaux romans de Balzac, à la dramaturgie imparable, et où tous les ingrédients sont réunis pour forger la légende de Johnson, qui se confondra peu à peu avec la légende de cette musique qu’il aura contribué à rendre si populaire : le blues… Robert Leroy Johnson serait né le 8 mai 1911, à Hazlehurst, dans le sud du Mississippi, l’état alors le plus dur à l’encontre de la communauté noire, pourtant majoritaire. Enfant naturel et petit-fils d’esclaves, son existence d’affranchi n’a cependant rien à envier à celle de ses grands-parents. En effet, après l’abolition de l’esclavage en 1865, ces anciens esclaves sont devenus des employés exploités par ceux qui étaient jusqu’alors leurs « maîtres ». C’est donc dans ce climat de misère et de chaos familial que Robert Johnson vit sa plus « tendre » enfance et son adolescence, balloté entre une mère ayant déjà enfanté à dix reprises, un père « inconnu », Noah Johnson, que Robert n’aura de cesse que de rechercher toute sa vie, des beaux-pères successifs, mais aussi des villes, des écoles, et divers noms de famille, entre Spencer, Dodds ou Willis… Ca n’est d’ailleurs qu’à seize ans qu’il adoptera définitivement le nom de Johnson.
A quatorze ans, Robert Johnson abandonne la guimbarde pour l’harmonica, qui restera pendant longtemps son instrument de prédilection. Mais c’est à la fin des années 20 qu’il rencontre deux figures mythiques du blues, qui lui enseignent les rudiments de cette musique : Charlie Patton (1891 – 1934), le père du « Delta Blues », une des toutes premières formes de blues, qui inspirera bon nombre de musiciens malgré sa courte carrière, de John Lee Hooker à Son House, en passant par Howlin’ Wolf, Robert Palmer, Bob Dylan, jusque The White Stripes et… Francis Cabrel, et Willie Brown (1900 – 1952), dont on sait peu de choses, si ce n’est qu’il collabora régulièrement avec Patton jusqu’à la mort prématuré de ce dernier.
En 1929, à l’âge de dix-huit ans, Robert Johnson découvre donc le blues, et se met à la guitare, sans abandonner pour autant l’harmonica, pour lequel il a confectionné un support qui lui permet de jouer des deux instruments en même temps.
Mais c’est en 1930 qu’un événement tragique le précipite définitivement dans les bras du blues, la « musique du diable »… Sa femme de seize ans perd la vie, ainsi que leur enfant, suite à un accident qu’il aurait lui-même provoqué. Robert Johnson est anéanti, et pour calmer son immense peine, il se réfugie corps et âme dans la musique. C’est à cette période qu’il rencontre Son House, qui le ridiculise en public lors d’un concert : « tu ne sais pas jouer de la guitare, tu fais fuir les gens ».
Vexé par cet affront, Robert Johnson retourne s’installer à Hazlehurst, sa ville natale, et il y rencontre Ike Zinnerman qui deviendra son mentor et le poussera à prêcher la « mauvaise parole » du blues dans les états du Sud. Cet homme étrange disait devoir la maîtrise de son instrument à la fréquentation d’un cimetière ; il exerce une influence certaine sur Robert, qui répétera à maintes reprises avoir appris à dominer sa « six cordes » à minuit, sur les tombes…
Lorsqu’il revient à Robinsonville deux ans plus tard pour montrer ses progrès à Son House et Willie Brown, ceux-ci sont stupéfaits par la virtuosité et le talent sans bornes du jeune homme. C’est à ce moment précis que nait la légende de Robert Johnson, selon laquelle il aurait conclu un pacte avec le diable, une nuit sombre, à un carrefour au fin fond du Mississippi. Car ces années d’apprentissage et de concerts minables dans tous les « juke-joints » de l’état ne peuvent pas expliquer une telle métamorphose…
Voilà ce que relate sa chanson « Crossroads » (enregistrée en novembre 1936) : un soir, à minuit, en pleine misère et en plein désarroi, le Diable lui a rendu visite à ce carrefour, pour lui proposer un pacte : le talent en échange de son âme. Ainsi, le blues ne pouvait pas mieux justifier cette appellation de « musique du diable »…
Mais en réalité, cette légende proviendrait de son homonyme, Tommy Johnson, qui aurait vendu son âme au diable en échange de sa virtuosité à la guitare. Et Robert n’aurait fait que reprendre cette légende à son compte, à moins qu’elle ne lui ait été attribuée par erreur. C’est d’ailleurs le personnage de Tommy Johnson qui apparait dans O’Brother des frères Coen. De quoi finalement continuer à alimenter la polémique, et donc la légende de Robert Johnson…
Et pour parachever le tout, Robert Johnson n’aura gravé durant sa courte carrière, sur vinyle et à la postérité, que 29 chansons en tout et pour tout, enregistrées lors de deux uniques sessions studio, en novembre 1936 à San Antonio, puis en juin 1937 à Dallas. La légende veut qu’il aurait écrit une 30ème chanson, mais que le Diable l’aurait gardée pour lui… Ce morceau qu’il n’a pas eu le temps d’enregistrer serait « Mister Downchild », repris ensuite par Sonny Boy Williamson.
Mais Robert Johnson, c’est aussi trois uniques photos prises de son vivant, ainsi que trois tombes réparties dans l’état du Mississippi, son lieu de sépulture le plus probable étant Morgan City, où l’on peut lire sur la pierre tombale dressée en 1991 : « Ci-git Robert Johnson, roi des chanteurs du Delta Blues. Sa musique fit vibrer un accord qui continue de résonner. Ses blues s’adressaient à des générations qu’il ne connaîtrait jamais, et transformaient en poésie ses visions et ses peurs ».
Le 16 août 1938, Robert Johnson meurt des suites d’un mystérieux empoisonnement… par un mari jaloux, après avoir agonisé pendant trois jours, dira encore la légende. Il n’avait que 27 ans. Pour la petite histoire… Ou pour la grande, il est le tout premier membre fondateur du fameux « Club des 27 » réunissant les artistes morts à 27 ans.
Robert Johnson accédera à un début de notoriété en 1961, avec la sortie de l’album « King of the Delta Blues Singers », et deviendra ensuite la référence absolue pour toutes les générations de musiciens qui lui ont succédé, au-delà des frontières du blues, de Muddy Waters à Jimi Hendrix, en passant par John Lee Hooker, Elmore James, Robert Lockwood, Eric Clapton, les Allman Brothers, ou encore les Rolling Stones.
A noter que tous les enregistrements de Robert Johnson ayant pu être récupérés, y compris les inédits, sont disponibles sur le double CD : « Robert Johnson – The Complete Recordings » (Collection Roots N’Blues – Sorti chez CBS en 1990 et réédité chez Sony Music Entertainment en 1996).
Et pour finir, vous pourrez visionner Crossroads, film américain de Walter Hill sorti en 1986, qui évoque Robert Johnson à travers l’histoire d’un jeune guitariste blanc qui part à la recherche de la « légendaire » 30ème chanson du bluesman.
Pour toutes ces raisons, Robert Johnson est le blues…
Et là, pour la peine, ça n’est pas une légende…
[vimeo id= »24735954″ align= »center » mode= »normal » autoplay= »no » maxwidth= »900″]
[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Robert Johnson Blues Foundation
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] robertjohnson.fr
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Robert Johnson @ Deezer
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] La Chronique d’André Manoukian
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Supernatural Crossroad Blues Intro
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Eric Clapton – Session For Robert Johnson – Me And The Devil Blues
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Robert Johnson – Supernatural – Crossroad Blues