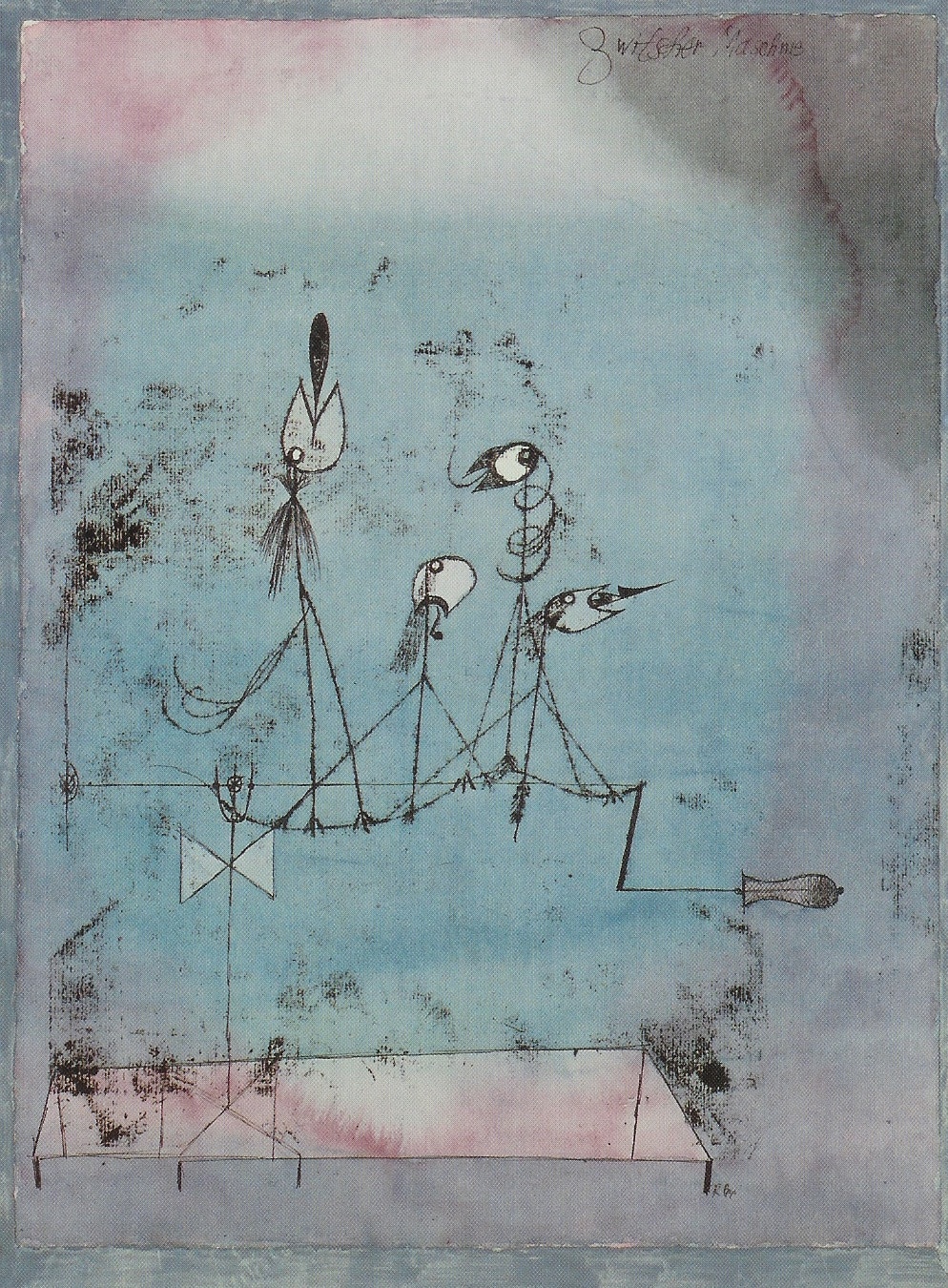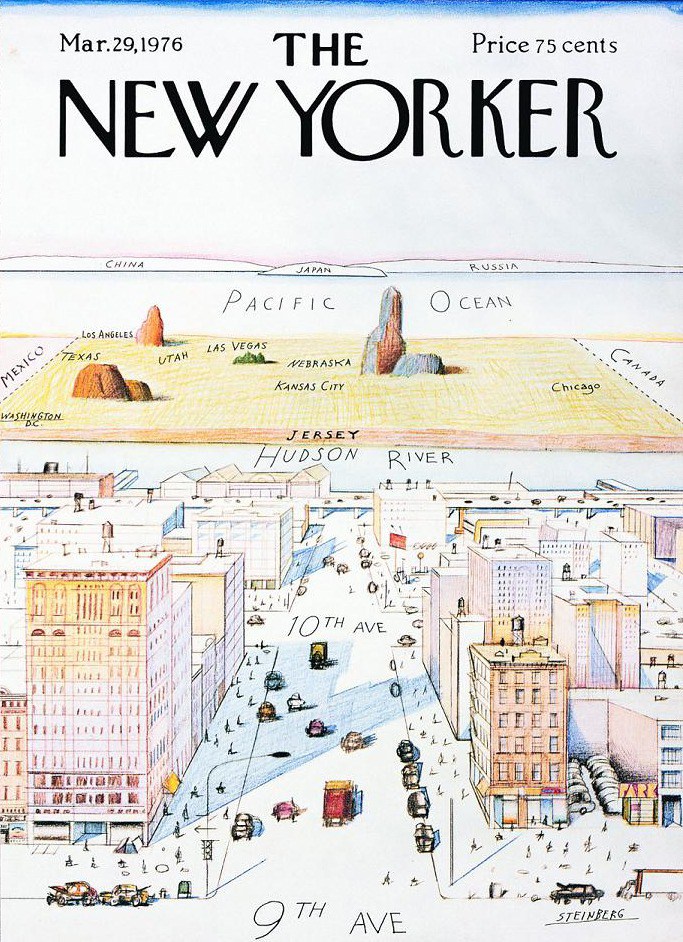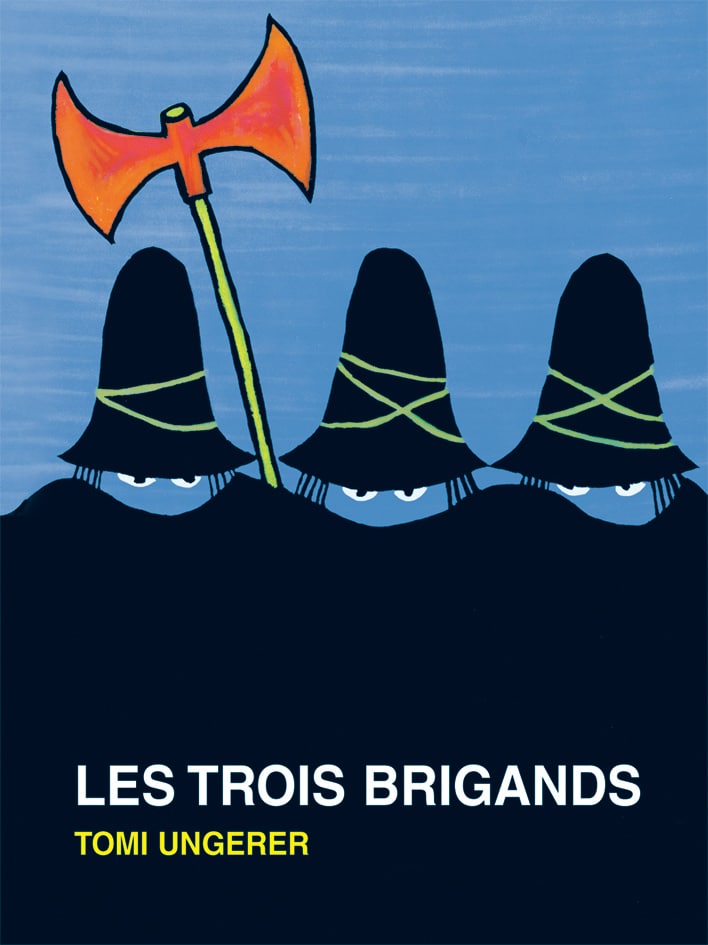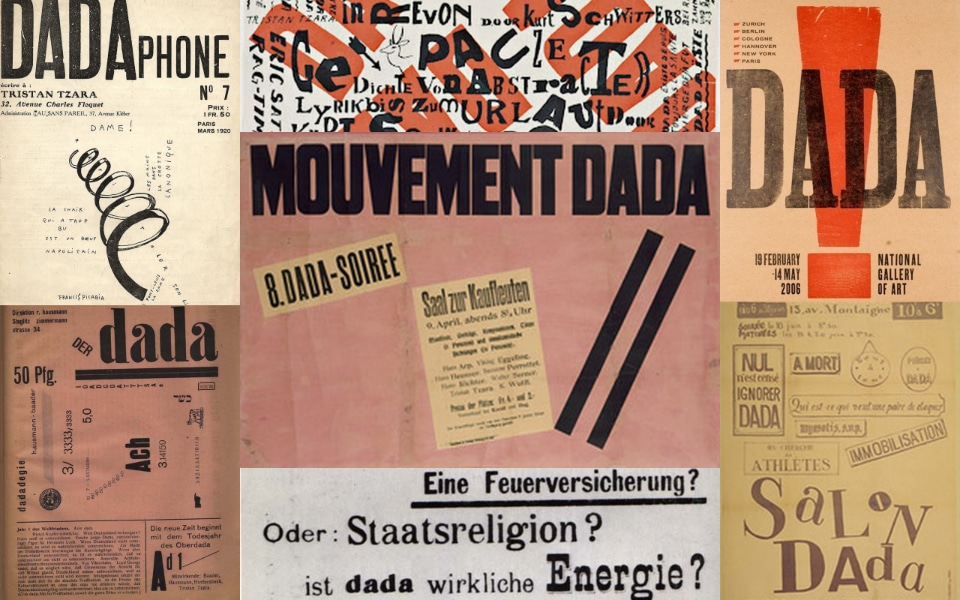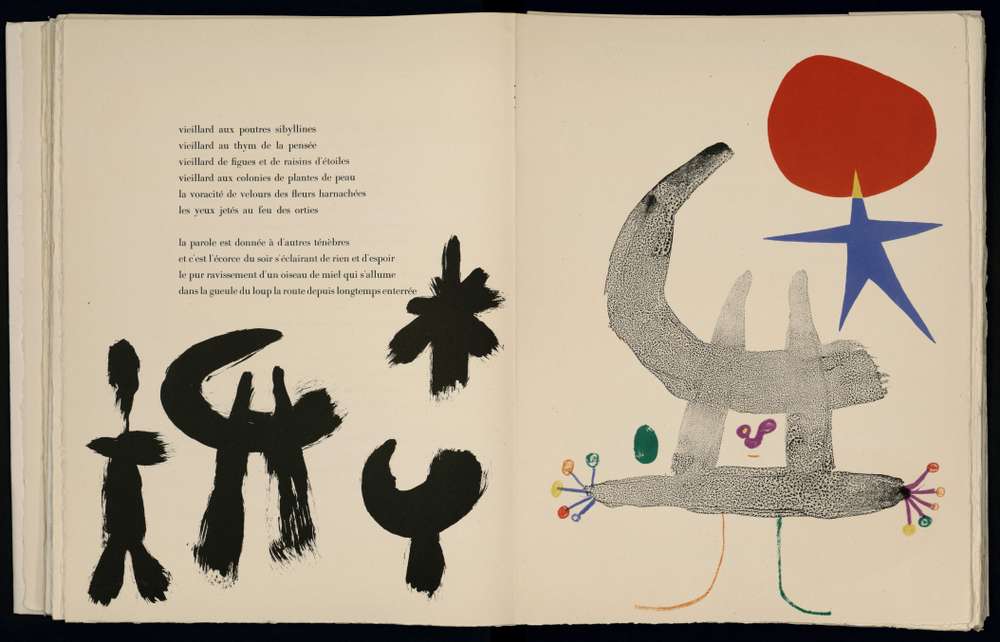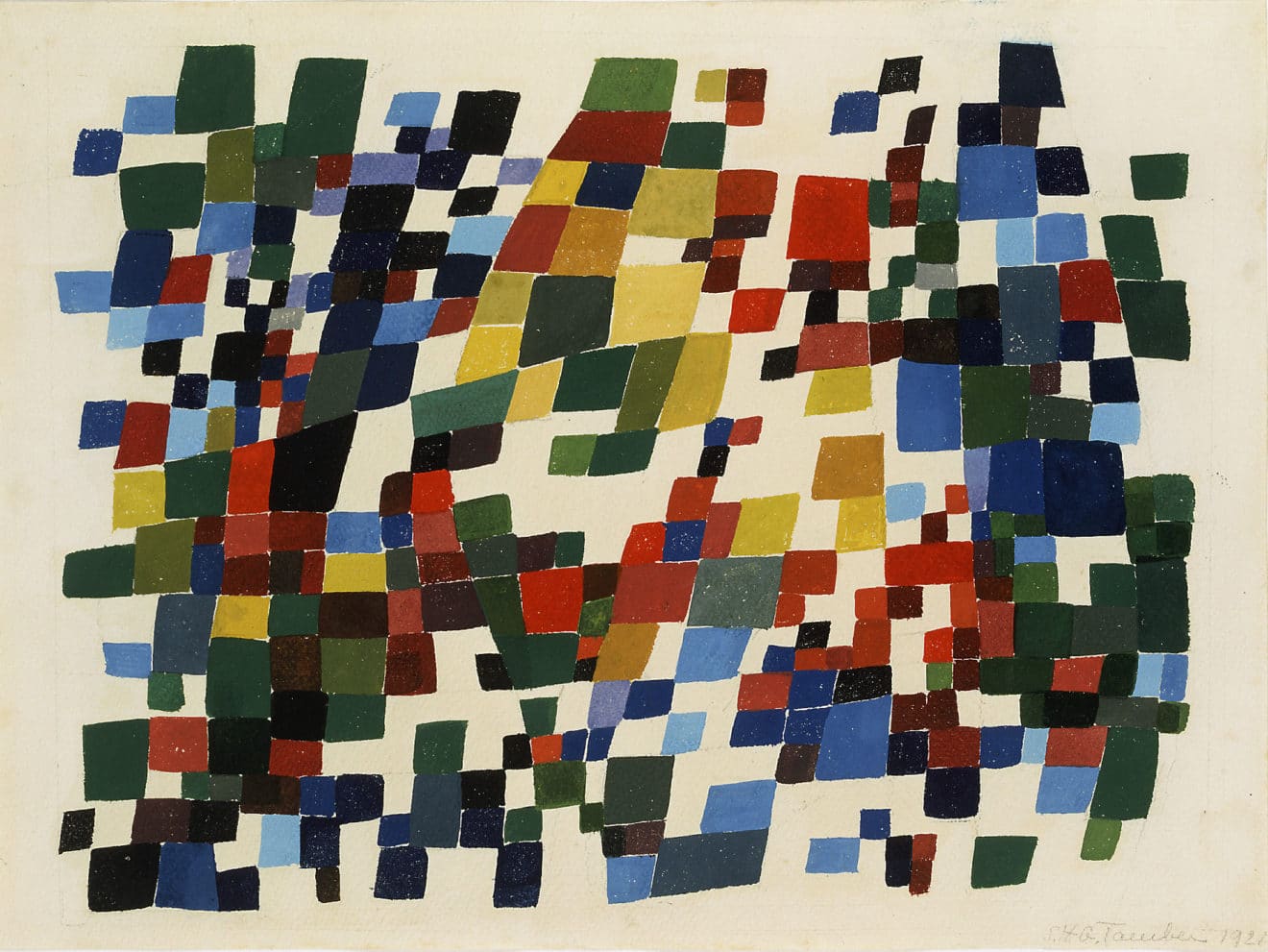Le mardi 29 mai à 20h00, assistez à la soirée spéciale consacrée à Hedy Lamarr au Louxor, Palais du Cinéma.
« Les gens sont déraisonnables, illogiques et égocentriques, aimez les malgré tout. Si vous faites le bien, on vous prêtera des motifs égoïstes et calculateurs, mais faites le bien malgré tout. Ceux qui voient grand peuvent être anéantis par les esprits les plus mesquins, voyez grand malgré tout. Ce que vous mettez des années à construire peut être détruit en un instant. Construisez malgré tout. Donnez au monde le meilleur de vous-même, même s’il vous en coûte. Donnez au monde le meilleur de vous-même malgré tout. »
Des débuts fulgurants dans « Extase » aux prémices des nouvelles technologies chères à notre ère digitale, c’est un double portrait de l’autrichienne Hedy Lamarr. L’un, très officiel, est celui d’une actrice qui fascina le monde par sa beauté et sa liberté sexuelle exacerbée. L’autre, plus intime, est celui d’un esprit scientifique insoupçonné. Obsédée par la technologie, Hedy inventa un système de codage des transmissions qui aboutira au GPS et bien plus tard au Wifi. Il s’agit d’une invitation contemporaine à redécouvrir une figure complexe, celle d’une enfant sauvage partie conquérir Hollywood pour fuir son mari pro-Nazi.
En avant-première, vous pourrez assister à la projection du documentaire « Hedy Lamarr: From Extase to Wifi » réalisé par Alexandra Dean (USA, 2018, 01h30).
[youtube id= »uMp435p57JQ » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Casting :
Nino Amareno, Charles Amirkhanian, Jeanine Basinger, Bill Birnes, Peter Bogdanovich, Manya Hartmayer Breuer, Mel Brooks, Lisa Cassileth, Wendy Colton, David Hughes, Diane Kruger.
Festivals :
✓ International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) 2017
✓ San Fransisco Jewish Film Festival 2017 – Grand Prix
✓ Jerusalem Film Festival 2017
✓ New York Film Critics, Online – Meilleur documentaire
✓ Women Film Critics Circle Award – Meilleur documentaire
La soirée sera précédée d’une lecture de sa biographie « Ectasy And Me » par Anna Mouglalis.
Pour le programme, c’est ici !
Louxor – Palais du Cinéma
170 boulevard Magenta, 75010 Paris
[ultimate_google_map width= »100% » height= »300px » map_type= »ROADMAP » lat= »48.8832455″ lng= »2.3498138999999583″ zoom= »17″ scrollwheel= » » infowindow_open= »infowindow_open_value » marker_icon= »default » streetviewcontrol= »false » maptypecontrol= »false » pancontrol= »false » zoomcontrol= »false » zoomcontrolsize= »SMALL » top_margin= »page_margin_top » map_override= »0″][/ultimate_google_map]
[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour Aller Plus Loin » class= » » id= » »]
[kleo_icon icon= »link » icon_size=« large »] Hedy Lamarr Official
[kleo_icon icon= »link » icon_size=« large »] Hedy Lamarr Science & Avenir