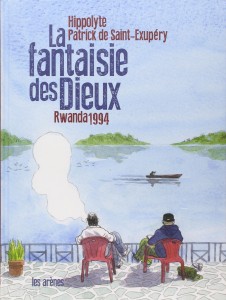« Eden », chronique d’un mouvement underground des années 1990 : les musiques électroniques
Un père traducteur, une maman professeur de philosophie. Mia Hansen-Løve débute dans un premier temps une carrière d’actrice, avec « Fin août début septembre » (1998) et « Les Destinées Sentimentales », tous deux d’Olivier Assayas, avant d’y mettre un terme pour devenir critique aux « Cahiers du Cinéma » jusqu’en 2005, puis réalisatrice : « Tout est pardonné » (2007), « Le père de mes enfants » (2009) et « Un amour de jeunesse » (2010). « Eden » est son 5ème film. Il permet de revivre l’ambiance des années 90 à travers la vie d’un DJ. C’est la première fois qu’un film de fiction est réalisé sur l’émergence en France des musiques électroniques. Le scénario a été écrit à quatre mains par Mia et son frère de sept ans plus âgé, Sven Hansen-Løve, lui-même DJ. « Eden » retrace donc le parcours de Sven (Paul dans le film), DJ, co-fondateur avec Greg Gauthier (Stan) des soirées électro « Cheers » dans les années 1990.
1989 – 1996 : l’émergence des DJ français et de la « French Touch »
Le film balaie de manière méthodique et chronologique la vie de Paul de 1990 à 2013. A 17 ans, il embarque dans le mouvement de la musique électronique tout droit venu de Chicago et de Détroit. Il se rend à des « rave-parties » dans des endroits secrets car interdits par la police, souvent en forêt, dans des champs perdus au milieu de nulle part, de vieux blockhaus (le Fort de Champigny) ou des entrepôts désaffectés (Mozinor). Sven Løve s’y rend avec un copain qui habite le même immeuble.
« Quand j’étais ado, Greg Gauthier, qui est devenu mon partenaire aux platines, habitait à côté de chez moi et nous avions sympathisé avec un autre voisin, un peu plus âgé, homo et très fêtard. (…) Je suis devenu DJ moi-même puis organisateur de soirées. Je suis tombé dedans la tête la première. » (interview de Sven Løve à Tsugi Magazine).
Les soirées sont organisées par Manu Casana sous son label « Rave-Age ». Les coordonnées des lieux sont dévoilées à la dernière minute via des numéros d’infolines imprimés sur des flyers. On appelle, on tombe sur un répondeur. Un message pré-enregistré fournit les infos permettant de se rendre aux soirées. Ces flyers étaient disponibles chez les disquaires ou distribués lors d’une soirée précédente.
«On pouvait aussi consulter le 36-15 Rave, service minitel mis en place par le journal Libération, à la pointe de ces musiques grâce au journaliste Didier Lestrade, l’un des fondateurs du fanzine eDEN. » (Télérama – Jérémie Couston + Odile de Plas)
Très vite, les raves deviennent des laboratoires de la culture underground. S’y retrouvent des centaines puis des milliers de jeunes pour des nuits entières de danse et de transe aux sons de musiques électroniques générées grâce à l’utilisation de synthétiseurs et de samplers. C’est la grande époque de la House, de la Techno et du Garage qui intègre les sons disco ou soul avec une partie chantée (du nom du club new-yorkais « Paradise Garage » où se produisait Larry Levan).
Les réseaux sociaux n’existent pas. Seules quelques radios diffusent ces nouveaux sons, comme Radio FG (Fréquence Gaie), Rue de Rivoli, créée en 1981 au moment de l’explosion des radios FM. Elle est la première radio à dédier intégralement sa programmation aux musiques électroniques et la première à éditer des compilations technos (mixées par Didier Sinclair) à destination du grand public. De nombreux DJ, comme Laurent Garnier, se succèdent à l’antenne. Sven Løve et Stan y animeront une émission de trois heures tous les dimanches pendant dix ans (1996 – 2006). Il y a aussi Radio Nova qui accompagne l’émergence de la French Touch, le magazine CODA et le fanzine eDEN qui paraît entre 1992 et 1996, fondé par le musicien Christophe Monier et le journaliste Christophe Vix de radio FG (Hervé dans le film). A la télévision, l’émission Mégamix, créée en 1997 par Marc Nivesse et un temps animée par… Virginie Efira, capte l’attention de tous les adolescents.
Le public des raves est varié, entre homos et hétéros, en passant par jeunes de banlieue, parisiens, ados ou quadras, toutes sortes de tribus se retrouvent pour faire la fête. Bière, cigarette, joints, extasy chauffent un peu l’ambiance. La fête peut durer toute la nuit, jusqu’au moment où les danseurs décident de rentrer chez eux, parfois le lendemain après-midi.
En 1994, le milieu de la house parisienne émergente tourne plus ou moins en circuit fermé et tout le monde se connaît. C’est lors de la soirée organisée par un DJ anglais, Nicky Holloway, dans une grande salle du Parc Eurodisney que Thomas et Guy-Manuel, alors Daft Punk débutants, rencontrent le groupe Slam, aux commandes du label écossais SOMA, à qui ils donnent une cassette de ce qui allait devenir leur premier maxi.
« On a rencontré les types de SOMA en tant que DJ à la fête à Eurodisney. (…) Ils ont trouvé ça bien. Après c’est sorti sur leur label en avril 1995. »
Une scène du film raconte la fameuse soirée donnée en 1996 par Thomas Bangalter des Daft Punk dans l’appartement de son père à Montmartre, alors qu’il passe un extrait de son premier single afin de le tester (Da Funk). Ils ont alors 21 et 22 ans. Le disque sortira en 1997 et s’écoulera à 1 million d’exemplaires dans le monde entier. Thomas et Guy-Manuel apparaissent en filigrane, de manière régulière, dans le film car les destins de tous ces protagonistes s’entrecroisent depuis 20 ans et encore aujourd’hui…
« Les nombreuses reconstitutions de scènes de club avec de nombreux figurants rendent le film forcément cher. On a passé un an à chercher quel rôle exact aurait la musique. Et quand on a donné une liste de titres à un spécialiste de la négociation des droits musicaux, il nous a donné une première estimation d’un million d’euros pour la quarantaine de titres dont nous avions besoin. Une somme totalement hors budget. Heureusement, les Daft Punk ont lu le scénario et accepté de nous aider. On entend trois de leurs morceaux dans le film, sans leur accord, le projet ne pouvait aboutir. Le film raconte l’histoire d’une génération qui est aussi la leur. Ils ont cédé leurs droits pour une somme symbolique et leur soutien a entraîné celui des autres musiciens et éditeurs. » (Sven Løve pour Tsugi Magazine)
[youtube id= »i2doVAFWbVs » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
1996 – 2005 : Le passage aux soirées clubbing
En 1996, La presse et les partis conservateurs fustigent les raves parties. Des interdictions préfectorales, parfois de dernière minute, obligent les organisateurs à annuler les soirées, ce qui leur fait perdre beaucoup d’argent. Elles quittent les hangars et la forêt sous la pression policière pour s’installer à Paris dans les Clubs. Les ravers deviennent peu à peu des clubbers. L’entrée n’est plus libre mais sélective : il faut désormais être « sur une liste » (celle des potes des DJ qui mixent aux platines) ou payer. Le public est plutôt VIP et bourgeois, le joint est remplacé par la cocaïne. Chacun trouve son club, pour la plupart dans le quartier de Pigalle.
Frédéric Agostini investit tous les mercredis le Queen sur les Champs-Elysées. Il y organise les soirées Respect. On recrute pour distribuer les flyers et pour pimenter les soirées VIP. La soirée marche si bien qu’elle est exportée à New-York où elle tourne pendant trois ans au Twilo avec en DJ résidents aux platines Dimitri from Paris et Junior Vasquez. Jérôme Viger-Kohler raconte :
« Première Respect le mercredi 2 octobre 1996 au Queen. Entrée gratuite aux Champs-Elysées. 1 700 personnes sur la piste. La première nuit d’une saga qui nous emmènera jusqu’à Hollywood. (…) Souvenir trois : le flyer Daft Club doré format carte de visite. Les Daft Punk jouaient toujours gratuitement pour la Respect, le patron devait juste arroser les potes de tickets consos (référence dans le film « Eden »). Entrée gratuite. File d’attente qui remonte les Champs sur quelques centaines de mètres et le feu à l’intérieur. (…) La date ? Mercredi 15 avril 1998. » (Brain Magazine)
Au même moment, David Guetta organise les soirées «Scream» aux Bains-Douches.
Sven Løve organize quant à lui les soirées « Cheers » :
« Elles ont existé, d’abord au What’s Up Bar, près de la Bastille, haut lieu de la house music à Paris, puis pendant trois ans (2001 – 2004) au dancing de La Coupole, la célèbre brasserie de Montparnasse que l’on voit tout au long du film. (…) Les Cheers étaient à Paris le rendez-vous des amoureux de la garage, cette version vocale de la house music, héritière directe du Disco et du Rn’B, où les divas (homme ou femme) tiennent une place centrale. (…) Les dernières Cheers se sont tenues au Djoon, un bar-club du 13ème. » (Télérama)
La Diva dans « Eden », c’est India (mariée un temps à l’un des DJ du Duo «Masters at Work») qui joue là son propre rôle sur un titre culte « With You Was Everything » sorti en 1997.
Les DJ font la fête du jeudi au dimanche, bricolant sur leurs machines dans leur appartement le reste du temps pour trouver de nouveaux sons et faire des disques.
Laurent Garnier (qui anime les «Gay Tea Dance» au Palace) témoigne dans son livre « Electrochoc » :
« Le dimanche matin, lorsque le Palace s’apprêtait à fermer, je prenais le micro, et m’adressant aux dix personnes naufragées dans le club, je lançais : j’ai ma bagnole, j’ai mes disques, je pars en Angleterre pour le week-end dans 10 minutes. Qui veut venir avec moi ? (…) Le dimanche soir, épuisés, nos tee-shirts délavés par la sueur et les taches de bière, nos cheveux collés par les effets conjugués de la transpiration et de la fumée (…), nous remontions dans la voiture (…) direction Paris. »
2001 : La conquête des Dance Floors de New-York
En 2001, c’est le grand bond au cœur de la Grande Pomme. Paul s’envole avec Stan pour vivre au rythme des soirées du MoMA PS1 données sur le patio du Musée d’Art Contemporain et organisées les dimanches après-midi par Agnès B. Dans le livre « French Touch » de Stéphane Jourdain, David Blot raconte :
« Durant cette période, on vivait comme des rock stars. On faisait les branleurs, on rentrait en limousine, on se battait pour être surclassés dans les avions (…) mais en attendant, ta carte bleue ne marche pas car tu n’as plus une thune sur ton compte. C’était une vie complètement absurde mais bien marrante. »
[youtube id= »tqyNO5wLoSc » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
De retour en France, Sven Løve et Stan deviennent résidents à La Coupole pour trois ans. Pour la première fois, ils ont un statut de salarié et leur salaire n’est plus versé au noir comme cela fut toujours le cas auparavant. Les Cheers ont enfin un comptable. On peut se demander pourquoi ils se sont retrouvés criblés de dettes. L’une des raisons est le paiement en liquide, plus volatile. On flambe les billets plutôt que d’économiser, on paye la coke, les bouteilles de champagne. Ensuite, de nombreux habitués font le siège des soirées : ils ne payent pas car ils sont inscrits sur une «Guest List». Leur nombre atteint parfois 300 personnes, ce qui représente un fort manque à gagner. Dans une scène du film jouée par le vrai David Blot dans le rôle du patron de La Coupole, celui-ci demande aux Cheers d’évoluer vers un nouveau public plus moderne et leur reproche le trop grand nombre d’invités et l’impact sur le chiffre d’affaires (un CA de 350 000 euros par soirée). Enfin, il faut aussi payer les DJ avec des cachets allant de 1 000 à 2 000 dollars, sans oublier les caprices des stars :
« Quand on a fait Little Louie Vega qui était une star à l’époque, cela nous a coûté 20 000 dollars. Et puis, il y avait les caprices, je me souviens d’India, la chanteuse des Masters At Work, qui refusait de chanter si on ne lui trouvait pas un coiffeur avant de monter sur scène. Du coup, elle a chanté avec une heure et demie de retard. On est loin de l’utopie des premiers temps de la techno où il n’y avait pas de star, ni de barrière entre artiste et public… Les abus et les caprices, il y en a eu très vite. Surtout du côté des Américains qui se rendaient bien compte qu’ils avaient un prestige énorme en Europe, bien plus qu’aux États-Unis. Certains artistes faisaient monter les enchères et finissaient par ne même pas venir… À New York, Junior Vasquez, le DJ résident du Twilo, un des plus gros clubs des années 90, avait son appartement dans le club même. Il voyait la piste de danse de son salon, derrière une vitre sans tain avec un accès direct à la cabine de DJ. Le Twilo a fini par fermer après une histoire de meurtre et beaucoup de ces DJ-stars des années 90/2000 ont disparu depuis. » (Sven Løve pour Tsugi Magazine)
2008 : Le passage de la trentaine
Après la fête, le réveil est brutal…
Il y a d’abord le suicide de Cyril en 2001 (le dessinateur Mathias Cousin), co-auteur avec David Blot au scénario (Arnaud dans le film) de la bande dessinée « Le Chant de la Machine » qui raconte la saga du disco et de la house. Aujourd’hui devenue culte, la BD a été rééditée avec en bonus une préface dédicacée des Daft Punk. Il y a aussi les problèmes de drogue et d’argent. En 2008, Paul n’a plus un sou en poche. Trop de cocaïne et de frais d’organisation. Il se retrouve à Marrakech à mixer dans des hôtels de luxe pour 600 euros le set. A 34 ans, il sent qu’il est passé à côté de sa vie : pas de femme, pas d’enfant, des dettes, une carte bleue bloquée, plus de sets ni de soirées, et la cocaïne.
« Nous avions le sentiment de participer à un mouvement quasi politique. Impossible de continuer à vivre de la même manière après avoir été dans une rave. On y recevait un tel concentré d’amour et de musique que la vie nous paraissait plus intense. Métro, boulot, dodo avec une petite famille par-dessus, ce n’était plus possible. » (Sven Løve pour Tsugi).
Dans une scène poignante, il craque et se réveille après un burn-out chez sa mère à qui il avoue être au bout du rouleau à cause de ses problèmes d’argent et de drogue. En 2013, les DJ des premières raves ont tous la quarantaine passée. Leurs vies de noctambules et de fêtards sont parfois derrière eux. Ils sont mariés, ont des enfants, continuent parfois de faire la fête à Ibiza. Mais ils ont surtout leurs souvenirs : de l’âge d’or, de la fête et de la découverte de la musique. Même si ce Paradis qu’ils ont découvert adolescents s’est transformé pour certains en paradis perdu. Et Sven Løve de conclure :
« J’ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que la musique n’était pas vraiment ma vocation. Je ne suis pas musicien. (…) C’est sans doute pour cela que je ne suis jamais devenu un producteur professionnel de soirées. La house et le garage ont été un moment très fort de ma vie, mais seulement un moment. Aujourd’hui j’ai découvert à quel point l’écriture est importante pour moi. Ces années ont été un tourbillon. Le film est arrivé au bon moment. »
La bande-annonce de « Eden » réalisé par Mia Hansen-Løve en 2014 :
[vimeo id= »108567107″ align= »center » mode= »normal » autoplay= »no » maxwidth= »900″]
[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Interview intégrale de Sven Løve à Tsugi Magazine
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Interview des Daft Punk au magazine eDEN en 1996
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] « Mes années Respect » par Jérome Viger-Kohler pour Brain Magazine
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Article Télérama : 10 clefs pour comprendre « Eden » et son époque
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Article Télérama : « Homework de Daft Punk : se souvenir de nos raves »