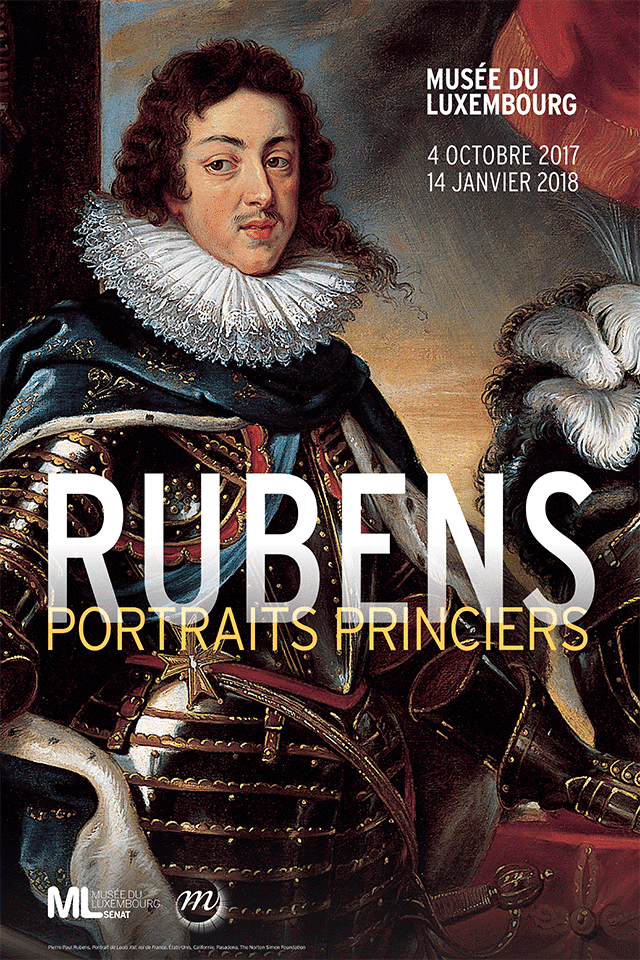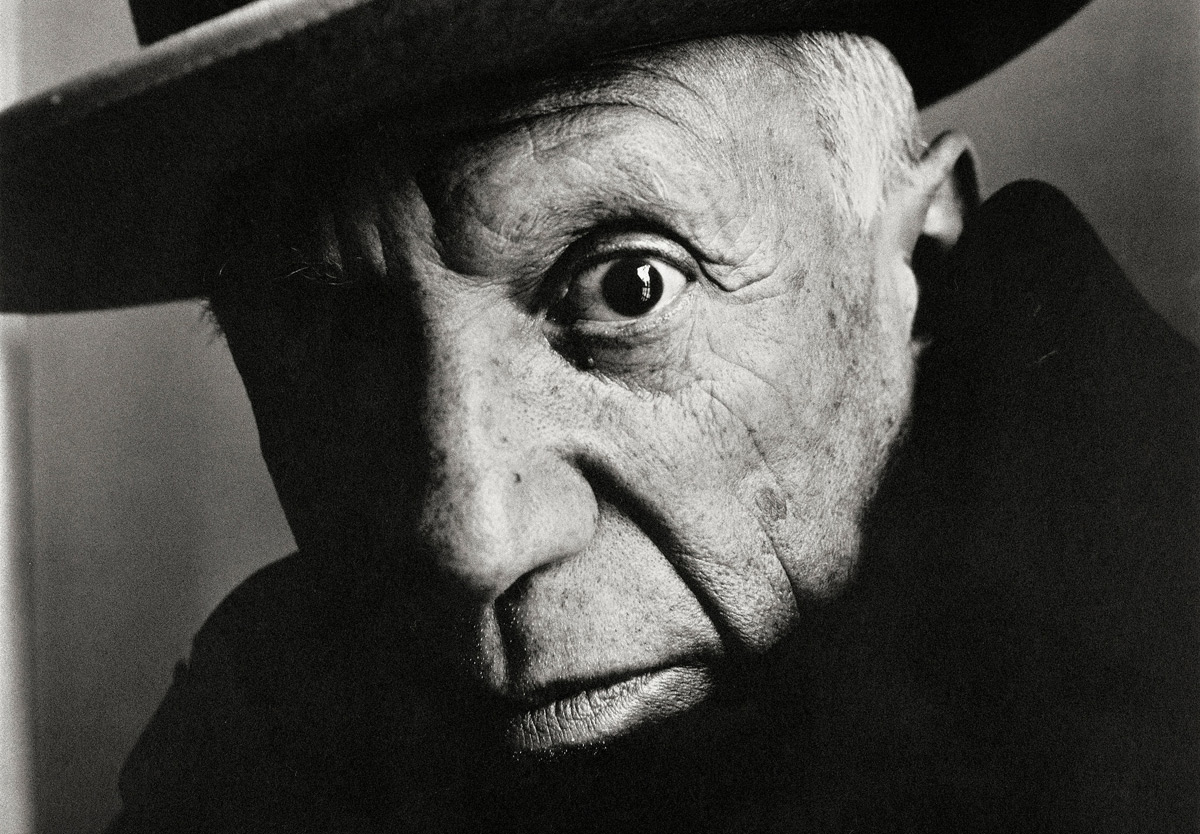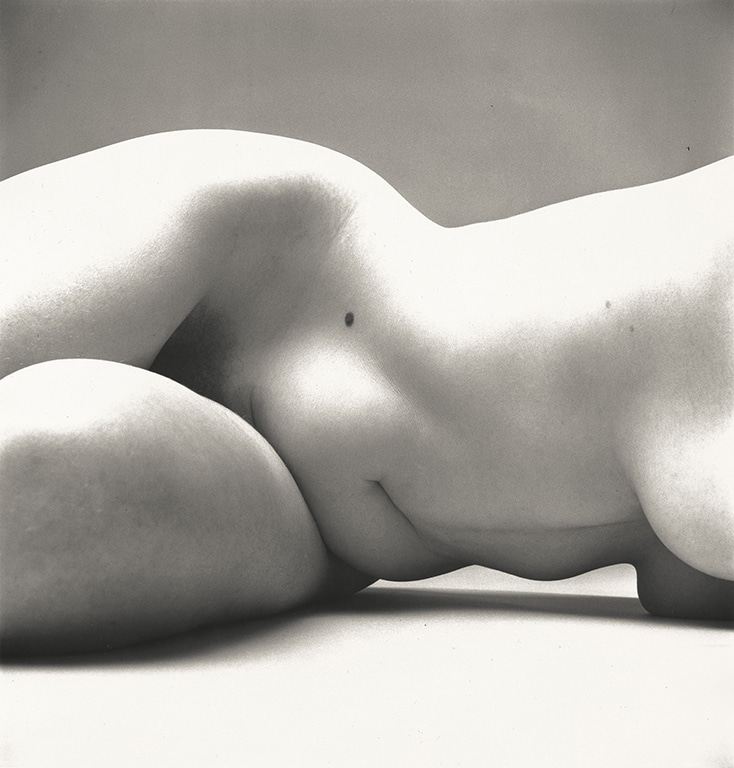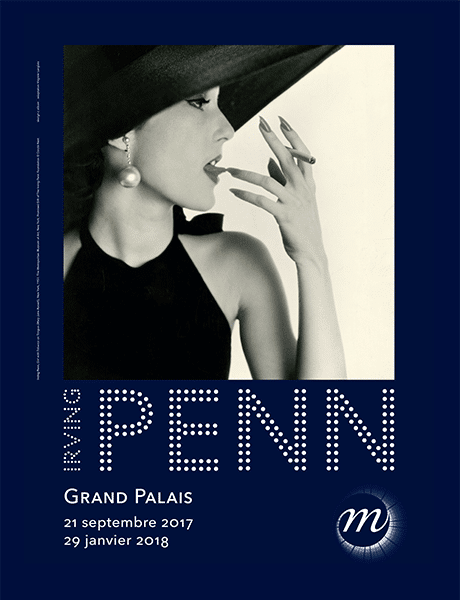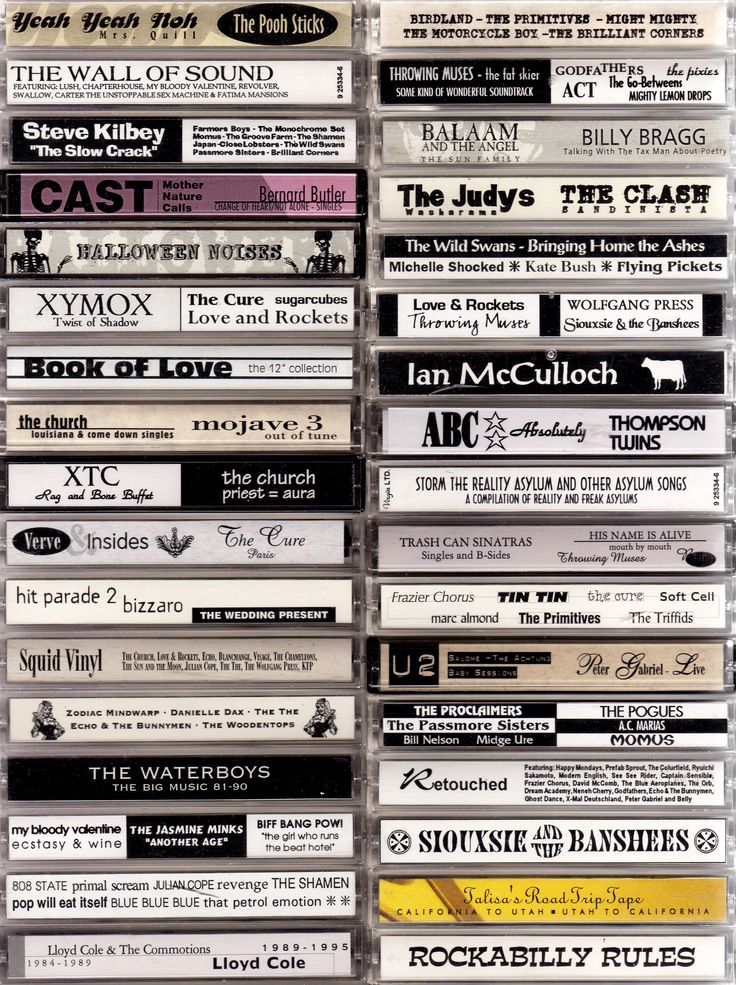Ines de la Fressange, qui a défilé plusieurs fois pour Azzedine Alaïa, se souvient du couturier, décédé ce samedi 18 novembre à l’âge de 77 ans.
« Jeune mannequin, je me souviens de ce petit bonhomme dans les coulisses effervescentes des défilés Thierry Mugler, arrivant les bras chargés de manteaux qu’il venait de terminer ; toutes les filles semblaient le connaître, criaient son prénom, l’embrassaient et plaisantaient avec lui : Azzedine ! Azzedine ! Avant d’apprendre que cette petite silhouette noire embellissait les femmes, j’ai vu d’abord comme elles l’aimaient.
Plus tard, inconnu du grand public mais ami et complice d’Arletty, nous allions, nous les mannequins, rue de Bellechasse dans le petit appartement d’Azzedine où il habitait, mais où se trouvait aussi son bureau et son atelier, afin de faire les essayages pour son petit défilé qui se passait dans ce même lieu. Azzedine savait coudre, couper, draper, mais cet extrême professionnalisme était toujours ponctué d’humour, d’éclats de rire, d’histoires, de souvenirs racontés, de blagues, de coup de rouge, de bons petits plats.
Il aimait les femmes, il en avait connu beaucoup, de toutes sortes de milieux et aimait, entre autres, se souvenir de cette petite employée de maison qu’il avait relookée avec juste un petit pull col en V et une épingle à nourrice, mais aussi de ces grandes bourgeoises des années 60.
Il n’avait pas de sous pour nous payer à l’époque, nous le savions mais pour lui, évidemment, on défilait gratuitement. En revanche, comme il était un gentilhomme, il nous offrait une robe : une façon de remercier mais lorsqu’il disait « cela me fait plaisir », on sentait la sincérité. A l’époque ses vêtements étaient sur commande et sur mesure, j’ai donc choisi une robe et nous étions convenus d’un premier essayage. Pas de premier d’atelier, Azzedine se chargeait de tout.
Là, devant le miroir, enfilant cette robe de jersey qui était un body avec deux pans qui se drapaient en se croisant derrière, je me suis redressée, cambrée, j’ai mis mes épaules en arrière et, je dois le confier, je me suis… admirée. Azzedine était derrière moi et j’ai vu ce petit sourire espiègle ; il avait compris cette seconde de satisfaction narcissique, constaté une soudaine féminité, apprécié le changement soudain d’attitude, son petit tour de magie avait fonctionné. Voilà ce qu’il aimait, trouver la petite bonne femme en vous grâce à sa robe et faire sortir cette féminité coquine, glamour et si parisienne.
Si la mode n’est pas un art, Azzedine était un artiste, il avait son monde, ses goûts, son panthéon de femmes qu’il admirait et très vite, il a refusé ce système qui ne lui convenait pas.
Avec sagesse, Azzedine a compris que ce qu’il aimait était son travail, sa liberté, ses amis, ses chiens, Paris, le talent, la qualité, l’excellence. L’argent ou même les honneurs, il n’en avait que faire et très poliment il envoyait promener les cons. Pas étonnant que sa grande amie ait été Arletty : lui le Tunisien avait cet esprit gavroche, la gouaille et l’humour d’un titi parisien.
Aujourd’hui, il laisse de nombreux amis avec un immense chagrin : Tina Turner, Naomi Campbell, Gilles Bensimon, Leila Menchari, son amie de toujours, mais aussi toutes ces femmes dont les amoureux ignorants de la mode aimaient lorsque leur femme étaient habillée en Alaïa.
Il part et emporte avec lui un peu de l’esprit parisien, les souvenirs de la haute couture des années 60, un grand sac de frivolité et de joie de vivre, un manuel épais de connaissance de la couture et du tissu. Lui qui ne s’habillait que d’un petit costume chinois noir va devoir adopter le blanc pour ses ailes en papier de soie.
Les enfants du paradis se regroupent : en leur racontant des histoires drôles, Azzedine doit déjà être en train de relooker les anges !
Arrivederci Maestro !
Ines. »
Article par Marion Dupuis pour le Figaro Madame