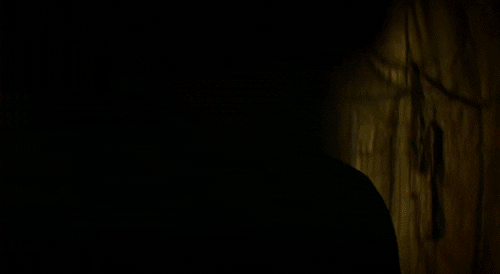[kleo_pin type= »circle » left= »yes » right= » » top= » » bottom= » »] « FOCUS » : un article de fond sur un thème que nos rédacteurs ont sélectionné.
L’année 1979 est définitivement une année-charnière, comme la fin d’un cycle. Elle scelle le sort des dernières utopies. Le monde prend une pelle et enterre à la hâte les cadavres encore fumants de nos illusions perdues. Après 1979, rien ne sera plus vraiment comme avant…
Coincée à la fin d’une décennie qui paraît un peu creuse, durant laquelle les dirigeants politiques semblent manquer de charisme (le pâle Carter face au cowboy médiatique Reagan, VGE après De Gaulle et Pompidou), l’année 1979 n’attire décidément pas les flashes. Et pourtant… Que d’événements considérables ont eu lieu cette année-là, autant de tremblements qui ont marqué la face du monde et dont on ressent encore les répliques quarante ans plus tard.
Révolution iranienne, arrivée de Saddam Hussein au pouvoir en Irak, début de la Guerre d’Afghanistan qui mènera à la chute de l’URSS et à l’apparition du terrorisme islamiste, second choc pétrolier et crise économique mondiale, paix entre Israël et l’Egypte, fin des Khmers Rouges… Il n’est pas insensé de penser que 1979 a en réalité été l’année la plus importante de l’après-Seconde Guerre Mondiale.
Palme d’or à Cannes en 1979, le film de Coppola a marqué l’histoire du cinéma par son tournage apocalyptique, les caprices de Marlon Brando et les millions de dollars engloutis. Mais quarante ans plus tard, le cinéaste impose sa maestria et sa maîtrise avec un superbe nouveau montage, baptisé « Apocalypse Now Final Cut ».
C’était il y a quarante ans, les écrans de cinéma rougissaient de flammes sur la musique des Doors, des palmiers brûlaient en torche… Le fantasque lieutenant-colonel Kilgore bombardait une plage du Vietnam au son de « La Chevauchée des Walkyries » de Wagner. Et lâchait ces mots comme une bombe de plus dans ce déluge de feu : « J’adore l’odeur du napalm au petit matin »…
Avec cette réplique et cet assaut d’hélicoptères, comme avec d’ailleurs beaucoup d’autres scènes mémorables au fil du voyage halluciné du capitaine Willard (Martin Sheen), traquant le colonel Kurtz (Marlon Brando) pour l’éliminer, en pleine guerre du Vietnam, « Apocalypse Now » a fini par prendre la place qu’il méritait dans l’histoire du cinéma. Majestueusement… Pourtant, c’est dans l’incertitude totale que le film de Francis Ford Coppola commença sa carrière, en 1979.
[youtube id= »KlsfM2BmsJU » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Fort du succès des « Parrain I et II », Francis Ford Coppola présente en 1979 au Festival de Cannes son nouveau projet inspiré du roman de Joseph Conrad, « Au Cœur des Ténèbres » (non crédité au générique). Il obtient la palme d’or ex-aequo avec « Le Tambour » de Volker Schlöndorff. Un destin inespéré pour un film dont le tournage fut tout bonnement catastrophique. Entre les crises du réalisateur, les caprices des acteurs, les maladies tropicales et la drogue, rien ne prédestinait « Apocalypse Now » au succès dont il fut couronné à l’époque.
Pourtant, dès sa toute première projection à Cannes en 1979, Coppola n’est pas franchement satisfait du résultat et considère cette première version comme étant toujours « a work in progress ». Il en proposera donc une nouvelle version 22 ans plus tard, en 2001, rallongée de 49 minutes et renommée « Apocalypse Now Redux ». Aujourd’hui, le réalisateur récidive en sortant « Apocalypse Now Final Cut », qui devrait (selon ses propres dires…) être la version ultime de son chef d’oeuvre absolu. 40 ans, c’est le temps qu’il aura fallu à Coppola pour être enfin satisfait de son film le plus emblématique…
« Apocalypse Now n’est pas un film sur le Viêt Nam, c’est le Viêt Nam. Et la façon dont nous avons réalisé Apocalypse Now ressemble à ce qu’étaient les Américains au Viêt Nam. Nous étions dans la jungle, nous étions trop nombreux, nous avions trop d’argent, trop de matériel et petit à petit, nous sommes devenus fous. » (Francis Ford Coppola)
« Apocalypse Now » nous conte donc l’histoire du Capitaine Willard, missionné en pleine guerre du Vietnam pour trouver et éliminer le Colonel Kurtz, officier des forces spéciales, brillant mais soupçonné de mener sa propre guerre. Ce qui ne devait être qu’une simple opération va se transformer en voyage initiatique et en une prise de conscience choquante de l’horreur de la guerre. Pour être au plus près de la réalité, Coppola n’a d’ailleurs pas hésité à utiliser de vrais cadavres pour certaines scènes…
Le film s’ouvre sur le jeune capitaine Willard, cloîtré dans une chambre d’hôtel de Saïgon, mal rasé, imbibé d’alcool et sorti de sa prostration par une convocation de l’état-major américain. Le général Corman lui confie une mission qui doit rester secrète : éliminer le colonel Kurtz, un militaire aux méthodes quelque peu expéditives et qui sévit au-delà de la frontière cambodgienne.
[youtube id= »E-QefTioe3I » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Coppola nous livre à travers son film une sévère critique de la guerre du Vietnam, ce qui sera cependant contredit par certains journalistes ou chroniqueurs à l’époque de sa sortie. Rappelons que l’opinion publique était dans son ensemble défavorable à l’engagement américain en Indochine et que lorsque les vétérans finirent par rentrer au pays, ils furent accueillis non pas en héros, mais plutôt comme des parias et des criminels. En plus de la violence et des abus inhérents à tout conflit, l’inutilité de la présence de l’armée américaine était au cœur des critiques.
« Apocalypse Now » reflète ainsi le manque de conviction notoire de ces soldats américains, désœuvrés, perdus, qui ne savent même plus pourquoi ils se battent. Ce n’est pas pour rien que dans la scène de la colonie française, le propriétaire de la plantation assène à Willard : « Vous les américains, vous vous battez pour rien du tout ». L’isolement et l’absence de but les poussent donc à toutes les folies.
Au milieu de ce chaos, Martin Sheen, l’implacable Willard, à la tête de son commando improbable, progresse le long de la rivière, bien décidé à trouver le fameux Kurtz. Au fil de l’eau, il devient spectateur d’un monde complètement à la dérive et comprend peu à peu les raisons qui ont pu faire sortir le brillant colonel des Forces Spéciales du droit chemin. Ce dernier reste d’ailleurs une énigme jusqu’à la toute fin. Le suspense quant à son identité et sa véritable apparence monte crescendo, jusqu’à ce que l’on découvre, sortant de l’ombre, un Marlon Brando métamorphosé. À la fin du film, les deux personnages ne font pratiquement plus qu’un, tant leurs visions respectives de cette guerre et plus généralement du monde semblent désormais liées pour toujours.
En 1979, à Cannes, la présidente du jury, Françoise Sagan, restera absolument hermétique à « Apocalypse Now », pour lequel le Festival avait été contraint d’accepter au préalable tous les ordres, contre-ordres, caprices et diverses contraintes techniques. Sagan ne jure en fait que par « Le Tambour » de Volker Schlöndorff… Gilles Jacob, conscient quant à lui de l’ampleur de l’œuvre de Coppola, déroge même à la règle qui interdit à un cinéaste déjà lauréat de la Palme d’or de revenir en compétition (Coppola l’avait obtenue cinq ans plus tôt pour « Conversation Secrète »).
Car un vent nouveau souffle sur Cannes cette année-là… En fait, tout a basculé trois ans plus tôt avec la palme d’or à Martin Scorsese pour « Taxi Driver », qui a fait l’effet d’un électrochoc. On dit que le vieil Hollywood, celui des John Ford et des Vincente Minnelli, est à l’agonie. La relève est là, piaffante d’impatience. On les surnomme les garnements (Movie Brats). Ils détestent les grands studios – Fox, MGM, Warner, Columbia, Universal, Artistes Associés – et inventent déjà le cinéma du XXIème siècle avec des superproductions délirantes.
C’est une tribu qui rêve de gloire et va qui va révolutionner le cinéma mondial, en pesant « accessoirement » des milliards de dollars au box-office : Roger Corman, Steven Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese, Paul Schrader, Michael Cimino, Brian de Palma et Francis Ford Coppola. Justement, ce dernier a choisi son heure pour débarquer en force à Cannes en 1979, avec son film spectaculaire et nietzschéen, présenté en première mondiale. Car après ce festival, rien ne sera plus comme avant… La suite est à lire dans l’excellente série d’articles du Point parue en août 2019, à l’occasion du 40ème anniversaire du chef d’oeuvre de Coppola et de la sortie du « Apocalypse Now Final Cut », version restaurée en 4 K Dolby Atmos, conçue par le réalisateur comme ultime et définitive…
« Apocalypse Now » en 8 Minutes by Blow Up (Arte)
[youtube id= »TzB0a_jNroI » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] « Apocalypse Now, la faillite de l’histoire » (Le Monde Diplomatique, 1979)
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Wikipedia