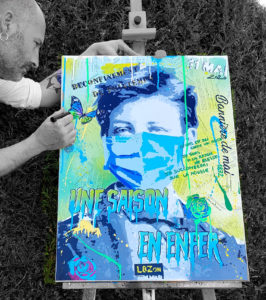PARTIE I
« Niort, Niort… Niort, deux minutes d’arrêt, Niort ! »
CHAPITRE VII
Pouvoir voler ou devenir invisible ?
Je me suis longtemps posé cette question et je dois admettre que j’étais face à un choix cornélien. Il fallait bien réfléchir. Au départ, j’avais forcément opté pour la faculté de voler, tel un oiseau ou Superman. C’était une évidence. Il s’agissait là à mon sens du pouvoir absolu : la liberté. Pouvoir aller où bon me semble, sans être restreint par le temps ou la distance. Mais je songeais aussi au danger que pouvait représenter ce mode de locomotion.
Vous êtes dans les airs, heureux comme une cigogne, mais tout à la joie de pouvoir flotter ainsi au gré du vent, vous n’avez pas vu le Boeing 747 qui surgit derrière vous et ne vous a pas vu non plus. Paf, en deux secondes, vous êtes happé par l’un des réacteurs de l’appareil et c’est fini. Ou bien alors, il est vous est impossible de passer incognito lorsque vous décidez, comme ça sur un coup de tête, de vous envoler parce que vous ne supportez plus l’endroit où vous vous trouvez. Vous devez apporter un tas d’explications plus nébuleuses les unes que les autres. Votre famille et vos proches, en retour, vous assaillent de questions : « mais alors, comment tout cela est arrivé ? », « et pourquoi toi ? » « as-tu été choisi ? », « quelles sont tes intentions, sauver le monde ou l’anéantir ? »…
Pouvoir s’envoler discrètement quand on le désire, deviendrait alors un vrai casse-tête. On serait sans arrêt repéré, il faudrait voler toujours de plus en plus haut et devoir se couvrir en conséquence. J’avais horreur des doudounes et il faut dire qu’avec mon physique de l’époque, les gens auraient pensé avoir affaire à un bonhomme Michelin volant. Non, ridicule… Se faire avaler par un réacteur ou mourir de froid, c’était décidément trop risqué.
Devenir invisible… J’avais de prime abord rejeté ce choix, car cela m’embêtait d’entendre ce que l’on pouvait dire sur moi « en mon absence ». Ça n’était de toute façon pas dans mon caractère d’espionner les gens ou des les observer à leur insu. Je trouvais cela tordu et surtout injuste. Et au diable si on disait du mal de moi dans mon dos. J’assumais les goûts et les couleurs.
Avoir la faculté d’être invisible quand on le souhaite pourrait néanmoins comporter bien d’autres avantages que le simple fait de faire du mal ou même de s’en faire à soi-même. Je pourrais par exemple m’introduire en pleine journée dans un magasin de jouets ou une pâtisserie sans être inquiété le moins du monde. Grâce à ce pouvoir, je pourrais ainsi prendre ce qui m’intéresse et repartir avec. Du vol ? Non, absolument pas, mais néanmoins en éprouvant un certain sentiment de jubilation de voir le robot ou l’éclair au chocolat se mettre à léviter avant de sortir du magasin, devant des paires d’yeux incrédules.
Être invisible, cela pourrait également me permettre de disparaître en classe, si le cours s’avérait trop ennuyeux ou que le prof décide, sans crier gare, d’une interro surprise… « Pof », disparition ! Et on pourrait trouver aisément bien d’autres situations inconfortables qui pourraient se régler le plus simplement du monde, grâce à ce pouvoir. Comme des personnes avec qui on ne souhaiterait pas forcément composer. Je pense à de la famille qui me fatiguait, ma grand-mère méchante (j’y reviendrai…), une cousine envahissante ou lorsque ma mère me cherchait pour m’engueuler, mon frère qui voulait me taper, bref, tout ce qui pouvait m’embarrasser à longueur de temps. Et la liste était infinie…
Allez, ma décision est arrêtée ! Je prends l’invisibilité !
… Mais jamais aucune force cosmique, aucun magicien venu de Neverland, ne me proposèrent ce pouvoir. Ça n’est pas faute d’avoir laissé très souvent la fenêtre de ma chambre entrebâillée la nuit, et même en plein hiver ! Mais malheureusement, cela ne se produisit jamais…
Et sinon, des yeux à rayon laser désintégrant ?
CHAPITRE VIII
Scolarité, ou l’image d’un corps que vous plongez sans prévenir dans une eau glacée.
Je dois avouer que je n’ai jamais rien compris au concept de l’école, des études et des devoirs… Ce principe même d’obliger des enfants, n’ayant pour la plupart d’entre eux aucun point commun, à se retrouver dans un même espace clos et ça durant pratiquement toute une année. Répéter cette terrible torture encore et encore, mois après mois. Forcer la main à tous ces mioches, sous prétexte qu’un certain Jules Ferry l’a un jour décrété…
Les parquer dans des pièces sinistres éclairées au néon, dénommées « classes », sous de fallacieux principes d’égalité et de république, là même où des créatures malfaisantes, grimées en homme ou en femme, déblatèrent à longueur de journée d’incompréhensibles logorrhées, des incantations blasphématoires, des paroles impies qu’elles forcent les pauvres gosses à avaler. Litanies infernales déversées sur des êtres innocents, hypnotisés, dans le seul but de les transformer lentement mais sûrement en mie de pain…
Non, je n’étais pas dupe ! Dès l’âge de cinq ans, je savais au fond de moi que quelque chose clochait. Mais à qui m’adresser ? Mes parents ? Non, ils étaient de mèche ou se taisaient par peur des représailles. Je savais bien comment les choses se passaient. Je l’avais vu dans « Les Envahisseurs ». David Vincent avait passé toute sa vie à tenter de prouver à un monde incrédule que le cauchemar avait déjà commencé. Alors un mouflet, pensez donc !
Tout au long de ces années durant lesquelles il me fallut endurer ce supplice, de la maternelle jusqu’au lycée en passant par le collège, je n’eus de cesse que de maudire tous ceux qui exerçaient ce simulacre grotesque et toxique, toutes ces institutrices, ces professeurs ; ces suppôts de Satan mis au monde par un chacal. Les forces démoniaques oeuvraient sous couvert de démocratie et affirmaient chaque jour un peu plus leur odieuse puissance du mal.
Et pendant ce temps, quelque chose que j’avais en moi depuis le début, commençait à prendre davantage de place : ma libido. Elle était pour l’instant enfermée à clé dans une petite boîte de Pandore, qui respirait. Mais elle se contractait comme un cœur et elle était en train de devenir un coffre. Je pressentais la suite de cette évolution. La malle allait se muer en armoire normande.
Je n’en avais pas encore la clé alors je forçais la serrure. D’abord, je ne vis rien… La boîte semblait vide, sombre, avant que je n’y perçoive un léger bruit au fond, comme un mouvement. Une petite ballerine se releva dans un cliquetis métallique puis commença à tourner lentement sur elle-même. Cette musique, cet air, je les connaissais pourtant. C’était quoi, déjà ? La porte de l’armoire se refermait brutalement, manquant de justesse de me sectionner deux doigts.
Comment un pré-adolescent biscornu à la voix fluette, boudiné dans son pull jacquard, avec aux pieds des chaussettes Burlington assorties et à la main un cartable en cuir noir comme ceux des notaires, pouvait supporter ces établissements privés catholiques où pôpa-môman l’avaient placé depuis sa plus tendre enfance ? Pourtant, j’avais la panoplie complète. Mon frère lui, était dans le public. Est-ce que mon prénom justifiait à lui seul ce sacrifice ?
Non, tout cela tenait décidément du plan parfait, celui qu’avait ourdi mon double maléfique pour parvenir à ses fins. Il s’agissait d’une sorte de monstre mi-Barbapapa mi-araignée, à visage humain, tissant sa toile calmement, tranquillement… mais sûrement.
Reprenons chaque élément, dans l’ordre.
Tout d’abord, l’école Jeanne d’Arc, de la maternelle jusqu’en CM2. Un établissement catholique vétuste, en pierre de taille et avec de nombreux recoins sombres. Les escaliers, les parquets, en fait tout ce qui était en bois, était vermoulu. Il y avait aussi ces WC dans la cour, tapissés intégralement de faïence du sol au plafond, avec des toilettes à la turque. On y trouvait ces gros citrons en savon fixés sur des tiges en fer, elles-mêmes accrochées à chaque évier, que l’on devait branler à deux mains avant de se les laver… Les mains, évidemment…
Cette école était également équipée de bonnes sœurs sans âge, dont l’aspect comme l’odeur auraient tout de même dû mettre la puce à l’oreille à mes parents. L’une d’entre elles, appelée Sœur Marie-Ange, dont la tâche principale consistait à surveiller les enfants lors des récréations, avait comme distraction favorite, une occupation dont elle était férue, de distribuer des torgnoles aux élèves qui jouaient trop bruyamment. Elle avait toujours son sifflet autour du cou, qu’elle utilisait lorsqu’il lui semblait qu’un garçon ou une fille criait trop fort en s’amusant. Soudain, un grand coup retentissait et tout le monde devait s’arrêter de bouger. Un peu comme « 1, 2, 3 soleil », mais avec une paire de baffes qui n’aurait pas été spécifiée dans la règle du jeu, pour celui qui aurait bougé trop tôt. Sœur Marie-Ange désignait alors le ou les coupables et d’un geste sec, leur demandait de venir devant elle. C’est alors qu’elle assénait une gifle à ses victimes…
C’est sur ce postulat que vous découvrez, comme ça, sans prévenir, brutalement, la religion et ses représentants. Dieu, Jésus, Marie, Joseph… Et tu fermes ta gueule ! Il y a avait aussi ces prêtres avec la raie sur le côté qui nous rendaient visite lors des sessions de catéchisme : « Coucou, les enfants… HOSANNA, HOSANNA, POUR LA GLOIRE DE DIEU !! »… Deux Pater, trois Ave et hop !
J’aurais pu ici davantage encore salir le clergé, avec des éléments à charge bien plus accablants que ces souvenirs de cour d’école, comme ceux d’enfants de chœur où sont évoquées des confessions putrides, des attouchements et divers tripotages, mais je n’ai pas le souvenir de m’être une seule fois retrouvé sur les genoux d’un de ces porcs en soutane. Non, je dois admettre que je n’ai personnellement jamais eu à subir quelconque cochonceté de la part de ces êtres à la foi percée.
Et c’est vrai que je ressemblais à un cornichon. Les curés aimaient peut-être les petits garçons, mais au moins avec des visages innocents. Il est aussi fort probable que l’un de ces prêtres ait vu un jour à travers mon cuir chevelu l’inscription tatouée sur mon crâne : « 666 ». Bref, on me laissait tranquille. Même Sœur Marie-Ange, d’ailleurs.
Pour ce qui était des cours, il y avait ces institutrices en twin-set, jupe écossaise munie d’une énorme épingle à nourrice, dont elles devaient se servir, je suis sûr, pour crever des yeux, serre-tête et physique d’oiseau. Elles avaient toutes la baffe aussi facile que fréquente et l’humiliation comme méthode pédagogique…
Je me souviens par exemple du jour où en CM2, un élève dans la classe avait fait je ne sais quoi de mal et n’avait pas voulu se dénoncer. Madame Baudin, l’institutrice, un mix entre Fernandel et Charles Pasqua, menaçait de punir toute la classe si l’unique fautif ne se dénonçait pas. Cette punition collective lui avait sûrement été inspirée par des méthodes employées par la Waffen SS pendant la Seconde guerre mondiale. Mais le coupable ne se dénonçant toujours pas, Madame Baudin qui, entre nous, avait probablement raté sa vocation de sosie officiel, fît venir jusqu’à son bureau chaque élève, un par un et par ordre alphabétique. La punition en question fut une gifle assénée à chacun d’entre nous. Pour ceux dont la première lettre du nom de famille se trouvait plutôt en fin d’alphabet, l’effet sur la peau était encore plus marquant. Pour ma part, j’étais l’avant dernier… Autant dire que je me souvins longtemps de la cruauté de ce supplice et en même temps de l’ironie de la situation. Nous apprenions à cette occasion, nous autres enfants, le concept de la solidarité.
Pour moi, l’école était juste une machine à transformer les enfants en sociopathes. Je me fermais autant que je pouvais et attendais que ça se passe. Un bernard-l’hermite patient, qui évitait tant bien que mal les regards mauvais de ces adultes sadiques, tristes et (je ne le savais pas à l’époque…) sûrement mal honorés par leur époux pour en arriver à de tels agissements.
Au final, ma scolarité fut désastreuse, dès le CP, et je redoublais finalement en fanfare le CM2. J’étais la risée de toute ma classe, mais aussi des enseignantes qui me toisaient de leurs regards sinistres à chaque fois que je me risquais à essayer de contempler ce qu’il y avait derrière leurs yeux d’animaux morts.
Ne voyant en moi qu’une sorte d’organisme, plus proche de la mousse des forêts du type lichen que de l’enfant modèle, béat et faux-derche, on m’éjectait tant bien que mal à la catapulte fabriquée en bâtons d’esquimaux Gervais en direction de la 6ème, dans un collège appelé Notre-Dame. Merci pôpa, merci môman… Mais la malédiction qui me frappait n’était pas encore à son terme. Le crucifix devait apparaître sur mon ventre mou, comme une marque indélébile. Il fallait que je sue par tous les pores de ma peau, les « Je vous salue Marie, pleine de grâce » ainsi que les « Notre Père qui êtes aux cieux »…
Cette fois-ci, plus de bonnes sœurs possédées dans ce nouvel établissement…
En ce qui concernait le catéchisme, on nous forçait à bêler des chansons aux paroles d’une niaiserie absolue que scandaient les Christine Boutin de l’époque. Et on devait prier en chaussettes… Il y avait aussi toutes ces « Madames » neurasthéniques, accessoirement épouses de notables, qui venaient alors tartiner de leur morale Tupperware les goûters d’adolescents cucul la praline. Des sorties champêtres étaient également organisées, agrémentées de pique-nique où, là encore, des prêtres venaient nous raconter des anecdotes croustillantes sur ce que Jésus (pas le dernier pour la déconnade celui-là…) avait dit ou accompli.
Je ne comprenais pas vraiment tout cela, et j’essayais de redéfinir les objectifs de ma vie en ne me déplaçant jamais sans des pisto-lasers, dissimulés dans mon sac, pour, le cas échéant, prendre de force le contrôle des opérations. Jouets que je me faisais en général systématiquement confisquer dès mon arrivée. Mes projets se voyaient ainsi sabordés par le pouvoir en place.
Je fis mes deux communions. J’étais bien-sûr totalement ridicule dans mon aube blanche. Le seul point positif à tout cela fut que nous mangeâmes de la pièce montée lors du repas dominical, point d’orgue de la cérémonie. J’adore ça, moi, la pièce montée… Cette tour babylonienne constituée de petits choux à la crème pâtissière, caramélisée sur un socle en nougatine, m’a toujours évoqué le rêve absolu, la magie des gâteaux, une dinguerie ultime. A mon sens le seul intérêt d’y participer…
J’adorais toutes sortes de gâteaux, à l’exception d’un seul. Les Chamonix, ignobles petites génoises à la confiture d’orange avec un glaçage sur le dessus. Rien que cet emballage en carton me faisait horreur, avec à l’intérieur ces deux niveaux, séparés par une feuille d’aluminium. Lorsque je découvrais chez moi l’une de ces boîtes dans le placard à biscuits, ou que ma mère en sortait un exemplaire lorsque nous allions à la plage, je faisais une syncope. Je devenais hystérique. Et il fallait me balancer à la mer pour me calmer.
Rien que le nom que portaient ces aberrations me faisait faire des cauchemars. Et puis, quel rapport avec la célèbre station de ski ? Des cerveaux malades, des entités démoniaques avaient ourdi dans l’ombre un plan pour me rendre dingue en concevant ces biscuits dégoûtants.
Je les rajouterai donc sur ma liste, avec le camping, des choses à proscrire définitivement lorsque je serais devenu Tyran.
Vivement !
[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Hubert Touzot : « La Pudeur » (Episode 01)
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Hubert Touzot : « La Pudeur » (Episode 02)
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Hubert Touzot : « La Pudeur » (Episode 03)
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Hubert Touzot : « La Pudeur » (Episode 04)