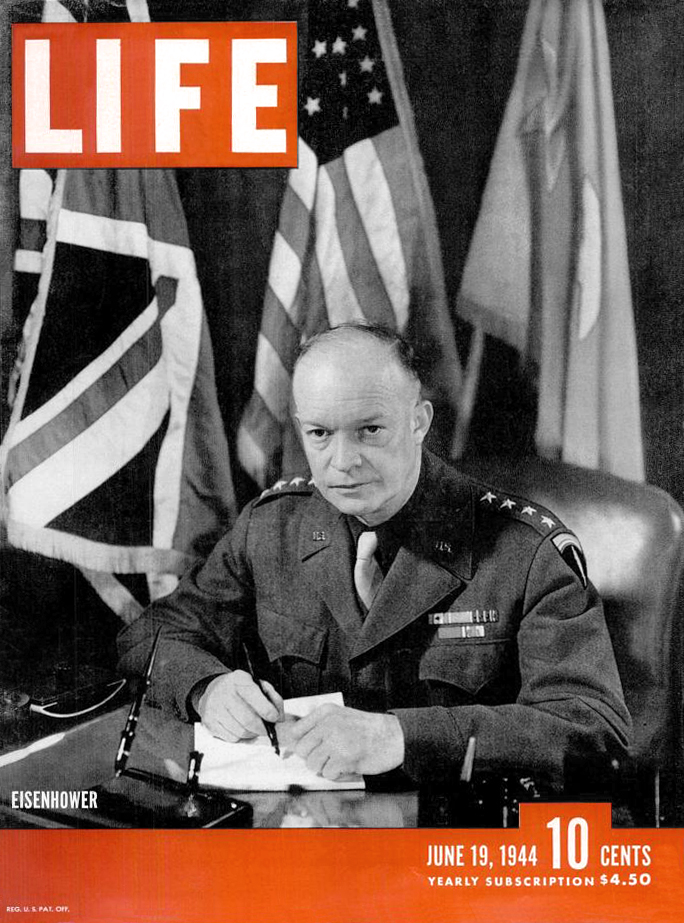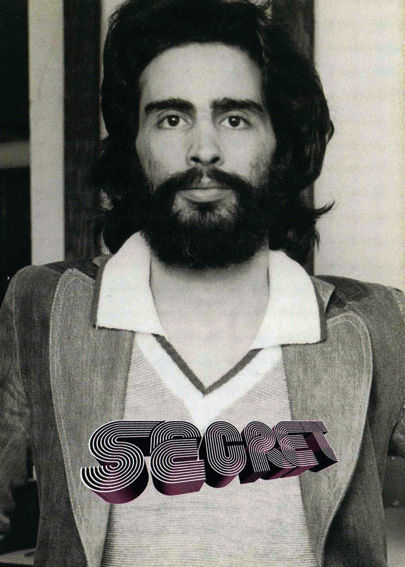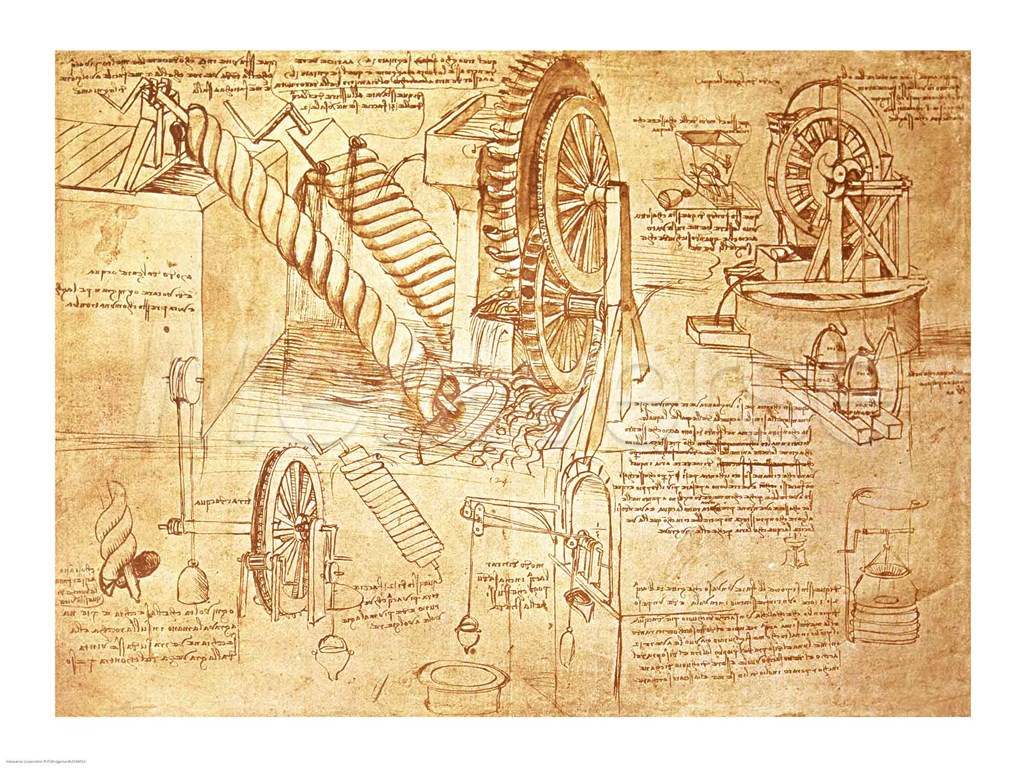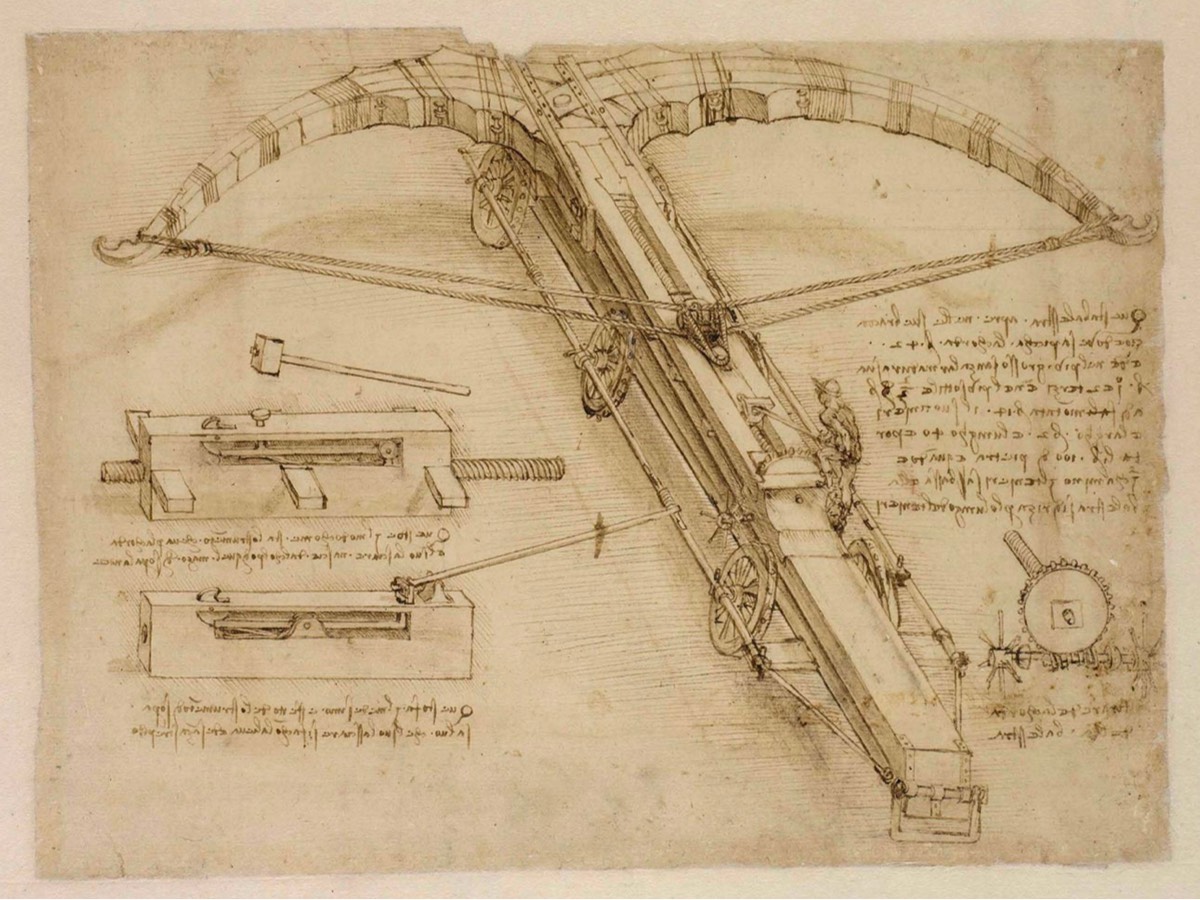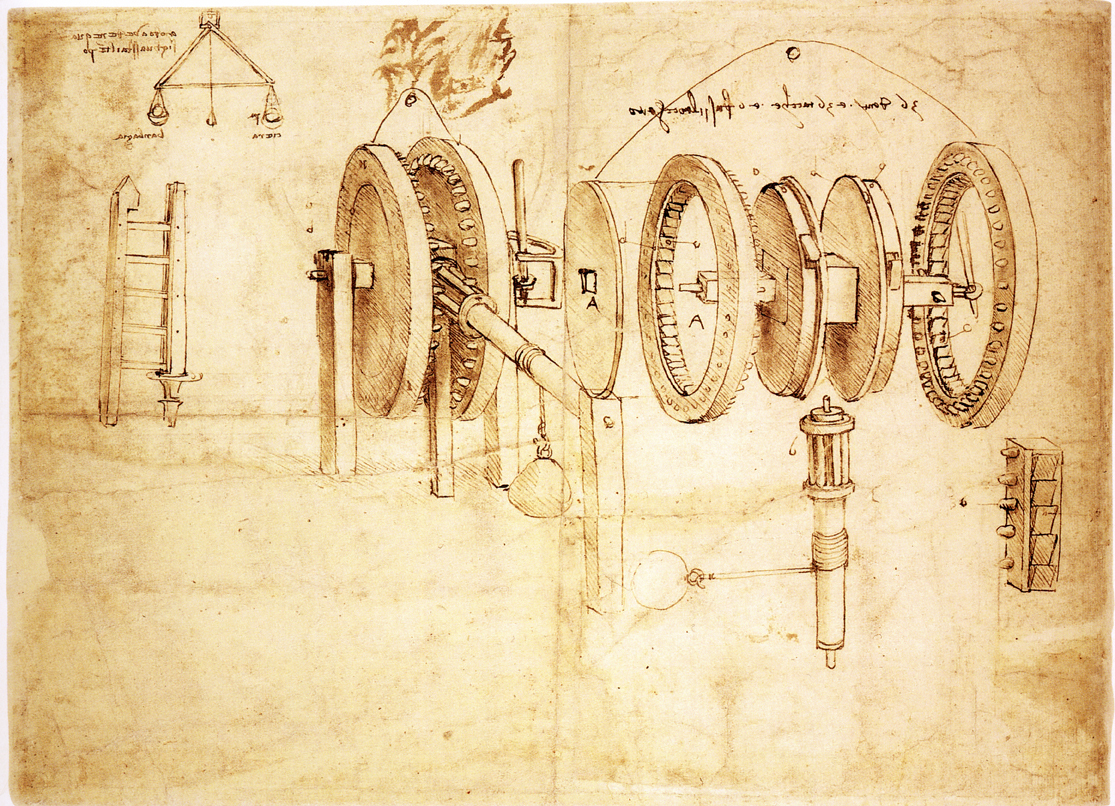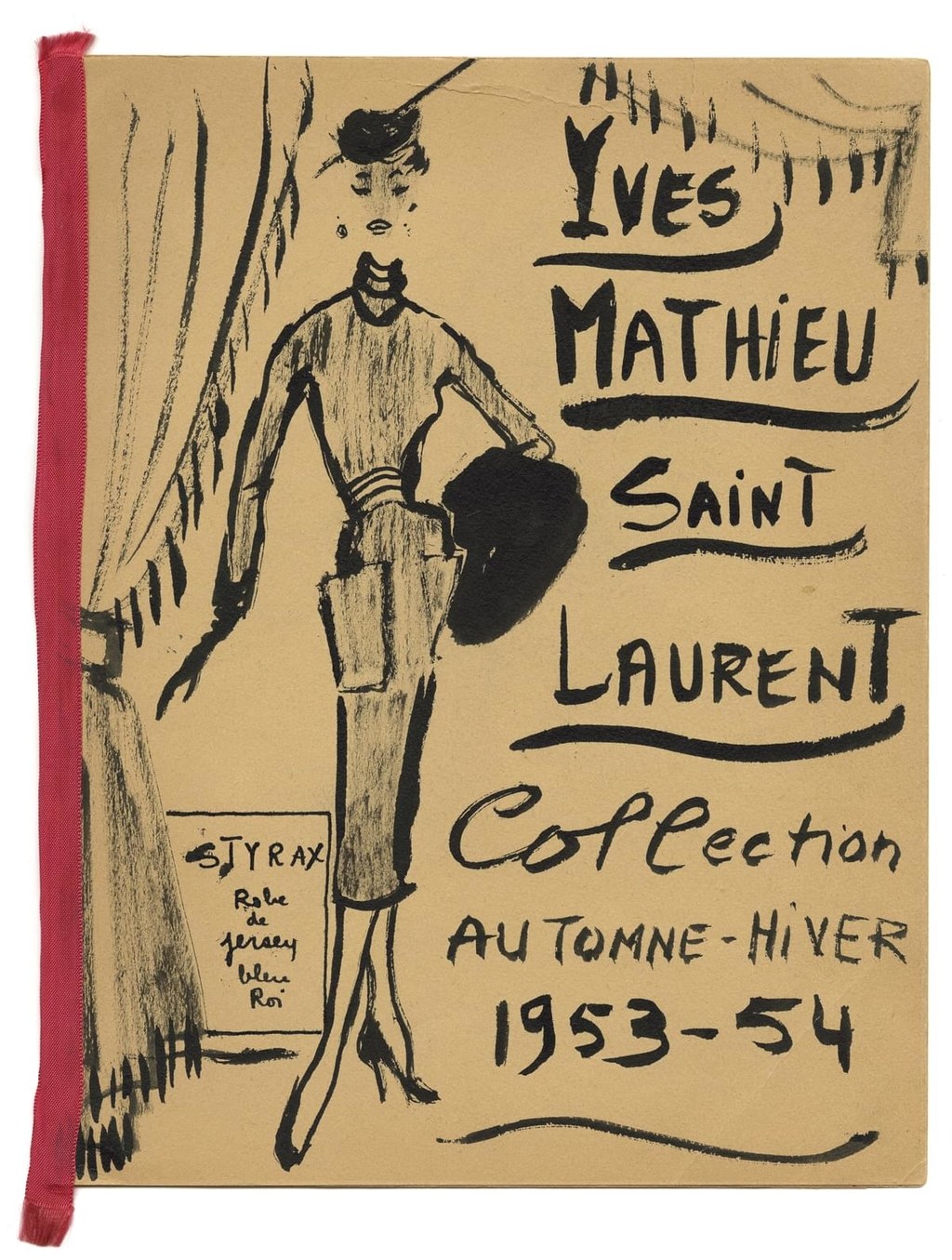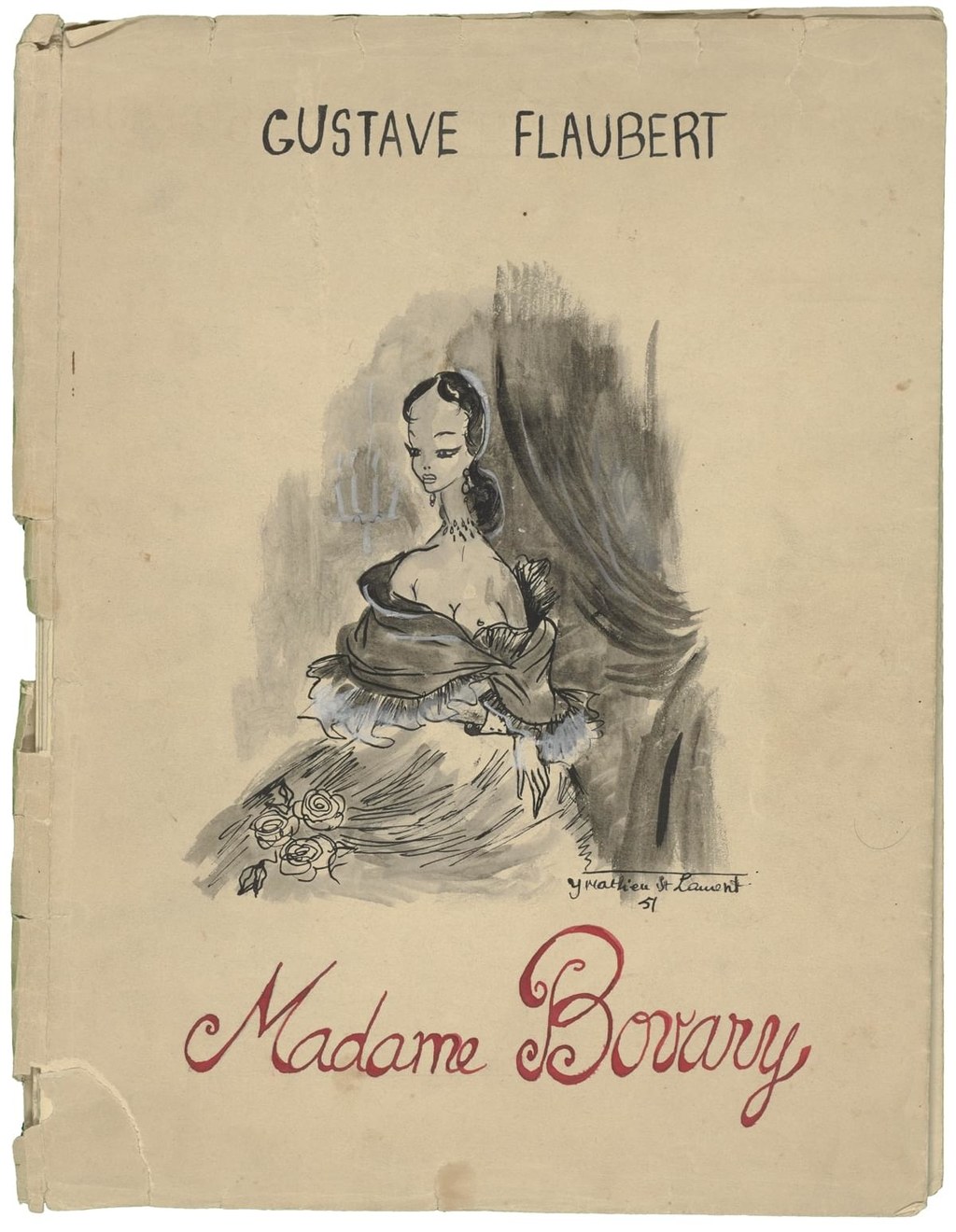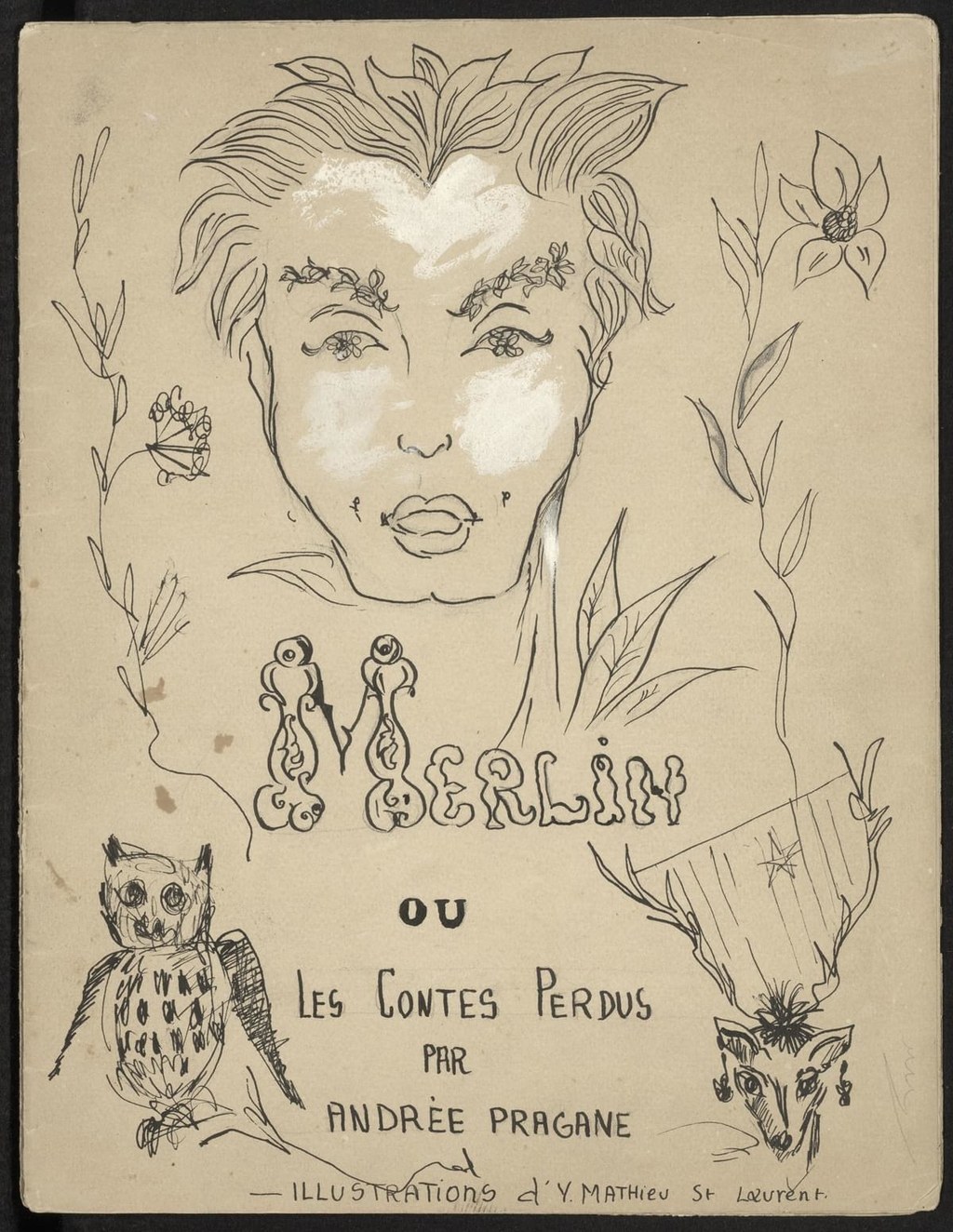Allez, rendons-nous à l’évidence, depuis combien de temps n’avons-nous pas eu peur au cinéma ? Cette peur viscérale, irrationnelle, celle que l’on ramène ensuite chez soi et qui nous saisit jusque dans notre lit…
Vous allez me dire que tout est une question de subjectivité… Certes. Car chacun possède son propre bagage émotionnel et ne réagit pas de la même façon en fonction de la situation donnée. Je mettrai donc tout le monde d’accord si je cite la mort et la souffrance comme vecteurs incontournables de ce qui peut engendrer la véritable peur originelle, même si cette perception est désormais souvent galvaudée par un surplus de représentation graphique gérée par le biais d’images virtuelles. Mais on confond hélas bien souvent gore et peur, dégoût et imagination.
Ces thèmes sont pourtant bien présents dans tout ce que l’on nous propose en salle depuis longtemps, mais la mode des « Jump Scares » a peu à peu supplanté ce qui était auparavant élaboré tout au long du récit pour nous faire ressentir au maximum les craintes des protagonistes. On a désormais tout au plus affaire à des trains fantômes, des attractions de fête foraine qui nous provoquent un petit frisson, mais qui s’oublient dès que nous avons quitté la salle.
Les « Conjuring », « Anabelle », « Insidious » et autres « Dame Blanche » ne sont que de petits goûters à grignoter, avec ça et là quelques idées intéressantes et des mises en perspective nous rappelant les phobies de notre enfance. On joue avec nos nostalgies et nous sommes des peureux consentants…
Mais pour un véritable festin tel que « L’Exorciste » premier du nom, dans sa version d’origine avec surtout le doublage français, « Massacre à la Tronçonneuse », « Henry, Portrait of Serial Killer » et même le premier « Amytiville », il nous faudra désormais nous tourner vers la télévision pour savourer et regarder la terreur dans les yeux. Renouer avec cette peur qui vous étreint, vous enveloppe et vous met mal à l’aise…
L’avantage indéniable qu’il y a avec les séries, c’est que les scénaristes peuvent déjà élaborer leur histoire et peaufiner les personnages, en prenant le temps qu’il faut. Ainsi, la peur n’est plus un prétexte ou une simple nécessité cosmétique pour masquer l’indigence d’un scénario bâclé et parvenir sur une heure trente de métrage à essayer de contenir un suspense artificiel.
Nous allons à présent nous pencher sur deux séries télévisées américaines récentes qui partagent la même ambition, à savoir : terrifier. Cependant, si l’une réussit son pari, l’autre, en revanche, si elle n’avait pas trop mal commencé, s’est ensuite asphyxiée, ne sachant tout bonnement pas comment se renouveler, restant tellement accrochée à son idée de départ qu’elle en a oublié ses principales motivations.
American Horror Story
Ambitieuse, opportuniste ou éclairée, cette série tout d’abord séduit. En admettant que la plupart des téléspectateurs ont la mémoire cinéphilique plutôt courte et que les autres qui découvriront ce spectacle ont une culture comblée en références prestigieuses, on peut alors s’amuser et prendre beaucoup de plaisir à suivre les aventures de cette première saison sur le thème de la maison hantée.
Les créateurs de ce show affichent des inspirations des plus pointues, du « Sixième Sens » à « Rosemary’s Baby », en passant par « Beetlejuice », « Le Loup-Garou de Londres » ou « The Day of the Locust »… Autant de grands films qui ont servi de modèles à cette première salve d’épisodes. Et il en sera de même pour les huit saisons qui suivront, chacune partant d’un postulat et d’une thématique forte. Après la maison hantée, l’asile psychiatrique avec en bonus des nazies, des tueurs en série et même des extra-terrestres pour la Saison 2. Pourquoi pas…
Pour la troisième saison, on plonge dans l’univers de la sorcellerie, avec son lot de magiciens, de sorts jetés, de vaudou et d’animaux fabuleux issus de folklores en tout genre. La quatrième saison ravive quant à elle l’âme du film mythique de Tod Browning, « Freaks », et le monde du cirque, avec forcément en bonus un serial killer sous les traits d’un clown maléfique.
Dans la cinquième saison, on aborde les vampires dans le cadre étrange d’un hôtel à la sauce « Shining » ; la sixième saison, le survival campagnard mâtiné de cultes païens et de sacrifices humains. La septième saison a tout naturellement pour contexte l’élection de Donald Trump, en référence au titre même de la série, et montre une réelle prise de position des auteurs. La huitième et dernière saison à ce jour a pour thèmes l’Apocalypse et le Diable, et marque le retour en force des sorcières de la Saison 3.
Tel un shaker géant que l’on aurait rempli de tout ce qui a cours depuis près de 60 ans, en clichés ou autres idées sur la question, le cocktail obtenu est parfois un peu épais, un peu riche. Mélangeant des traumatismes et faits divers ayant secoué l’Amérique ces dernières années à d’autres légendes urbaines, le tout agrémenté par des ambiances de Soap Opera façon « Desperate Housewives », « American Horror Story » devient ainsi le rejeton (im)parfait, qui justifie son existence en commentant les névroses dont souffre la société américaine depuis toujours, à savoir ses divers complexes de culpabilité vrillés par la religion et son manque, voire son absence, de culture et d’histoire.
Avec cette galerie de personnages, mortels et fantômes, qui se confondent, s’affrontent, s’aiment et se déchirent, et même si le résultat est parfois confus, des épisodes nous réservent tout de même, à défaut de vrais frissons, des images, des idées formelles sublimes, des acteurs inspirés et surtout, le clou, la cerise, une Jessica Lange impériale.
Si « American Horror Story » n’est pas la série effrayante et malsaine que l’on espérait (trop d’humour, de décalage et d’enrobage esthétique léché, qui donnent parfois plus l’impression de feuilleter un art book qu’une histoire filmée), on apprécie tout de même l’audace de l’entreprise et sa générosité.
[youtube id= »-9KZr2Vn7CQ » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Channel Zero
« Channel Zero » est une série qui ne va pas chercher à faire jolie avec de faux concepts et un casting à répétition. On pense tout d’abord à une autre série anglaise intitulée « Black Mirror ». Ici on ne surfe pas sur la mythologie classique ; sorcières, vampires, fantômes, monstres en tout genre, psychopathes actuels pour faire joli et revendications queers sur le dessus, en un fourre-tout façon fête foraine. On s’intéresse davantage à notre société et l’évolution de nos us et coutumes.
Si « Black Mirror » s’appuie sur notre rapport à la technologie et les dérives que cela entraîne, conséquence et fatalité, dans des récits d’anticipation où chaque point de départ est une projection de ce que l’on vit au présent, « Channel Zero » va plutôt utiliser l’époque actuelle et la tordre façon « Twilight Zone », avec des préoccupations bien ancrées dans le réel.
Pour l’ambiance générale, on navigue dans des réminiscences très « Lynchiennes ». Les protagonistes vont constamment être confrontés à des situations remettant leur équilibre mental et leur existence même en doute. Il y est question de légendes urbaines remaniées et agrémentées de concepts assez fous. Les visions, les situations que vivent tous les personnages, sont dans leur genre assez inédites. La peur fonctionne systématiquement grâce à l’empathie des personnages, suffisamment neutres, pour que l’on puisse se projeter assez rapidement en eux.
Que ce soit une émission pour enfants qui ne peut être vue que par les enfants eux-mêmes et qui les transforme en monstres, une maison noire qui apparaît et disparaît à sa guise dans une banlieue pavillonnaire quelconque et qui renferme un monde inversé, une famille ayant pactisé avec une divinité funeste pour obtenir la vie éternelle ou une femme capable de faire surgir ses amis invisibles de son enfance afin de se venger, ce sont autant de thématiques passionnantes dont on peut aimer avoir peur, mais tout en réfléchissant sur notre existence et notre rôle à jouer dans cette vie qui nous est allouée.
L’inventivité des scénaristes conjuguée au talent indéniable des réalisateurs et producteurs apportent tout le sel à ce programme brillant, innovant et totalement dérangeant. Chacun de ses thèmes tient sur une saison de six épisodes, au cours de laquelle les concepteurs de la série prennent vraiment le temps de développer l’intrigue.
Avec « Channel Zero », nous avons indubitablement affaire à la série la plus aboutie, la plus moderne et définitive dans ce registre, avec toujours cette peur en filigrane, qui ne se cache plus derrière la porte ou dans un recoin sombre pour nous faire sentir sa présence ; mais une peur qui ne joue plus avec des références empruntées aux classiques de la littérature, ni avec les codes en vigueur ou les règles usitées.
Et force est de reconnaître que les séries sont aujourd’hui de précieux laboratoires pour nos imaginaires et notre appétit insatiable de nouveauté…
[youtube id= »JE8FnM9o9Gg » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Quant à la prochaine Saison 9 de la série « American Horror Story », elle se dévoile dans un teaser sombre et mystérieux…
[youtube id= »lC3SkaqHMlE » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]