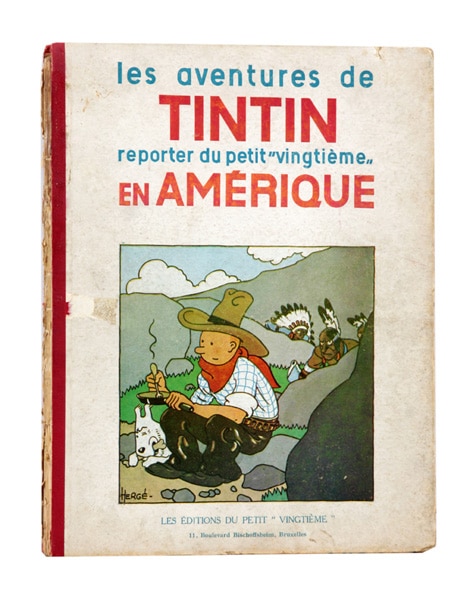DJ Network est le premier centre de formation de DJ en France, présent dans quatre villes : Paris, Lyon, Cannes et Montpellier. L’école délivre un « Titre certifié de niveau 3 » reconnu par l’Etat. Son fondateur, Jean-Pierre Goffi, l’a ouvert en 1994. Si autrefois le DJ pouvait se former « sur le tas », avec juste une bonne oreille et un mentor, aujourd’hui cela ne suffit plus. L’avancée des nouvelles technologies liée à la multitude de nouveaux sons demande davantage de connaissances, en plus des secteurs de la production, de la diffusion, de la communication et des règles de droit qui y sont liées. Terminées les soirées payées en billets cash au jour le jour, les Mix et les Demos enregistrés dans la chambre ; la concurrence est rude et le métier de plus en plus technique et pointu. Le DJ ne se produit plus dans les vieux dépôts abandonnés mais dans des clubs, des centres de vacances renommés, des festivals, pour des soirées d’entreprises. La musique électronique a gagné ses galons. Elle n’est plus Underground mais fait désormais partie intégrante du paysage sonore dans les médias. Ce qui était une passion est devenu une profession, celle de « DJ Producteur de Musiques Actuelles ».
INTERVIEW
IC : Bonjour, quel est le profil des stagiaires de votre Centre de Formation ?
Fl : Il est possible de s’inscrire dès l’âge de 17 ans et 2 mois car il est nécessaire d’atteindre la majorité pour faire le stage obligatoire qui clôt la formation de dix mois et se déroule dans le milieu de la nuit. La plupart du temps, les parents de mineurs suivent et signent sans difficulté le contrat de formation car ils savent que le centre est sérieux et délivre un Titre reconnu par l’Etat. Le Centre dispose d’une salle de cours multimédias pour les enseignements théoriques, d’une régie DJ individuelle pour chaque étudiant et d’espaces ouverts en libre accès pour les Travaux Pratiques.
IC : Quelles formations propose l’école ?
Fl :
✓ des stages de vacances
✓ des ateliers en soirée
✓ des cours particuliers
✓ des formations courtes (Mixage – DJ – Production MAO – Communication – Program Programmation musicale) pour 960 à 1 840 euros
✓ des formations longues (DJ Producteur sur 10 mois ou DJ MAO sur 8 mois) pour 7 000 euros
IC : Quel est ce titre que délivre le centre ?
Fl : Il s’agit du Titre certifié de niveau 3. Notre centre délivre une formation professionnelle reconnue. C’est ce qui explique en partie son succès et sa notoriété. Pour répondre à votre question précédente, il y a deux types de stagiaires :
✓ Les jeunes qui veulent apprendre ce métier et toutes les facette de celui ci pour faire du club et ou de l’événementiel )
✓ Des DJ déjà pro mais qui souhaitent suivre un stage afin de redonner un coup de fouet à leur pratique, se former aux nouvelles technologies.
Parmi eux, certains seront « DJ généralistes », passeront tous types de musiques en boîte de nuit, pour animer des soirées, en centres de vacances ou dans des soirées d’entreprises. Les autres souhaiteront passer à la création et la production de leurs propres morceaux. On peut aussi faire les deux. L’offre de Djing est très ouverte en ce moment en France.
IC : Justement, quels sont les débouchés ?
Fl : Ils sont nombreux : depuis trois ou quatre ans, l’offre d’embauche a explosé. 89 % des sortants entrent dans la vie professionnelle dans les six mois. On recherche de très nombreux DJ pour toutes sortes d’événements qui permettent même à celui qui le souhaite de ne travailler que le jour, pour des raisons familiales par exemple : du mach de foot (même l’Equipe de France a son propre DJ) aux festivals, en passant par une manifestation sportive, un gala, une soirée privée (anniversaire, mariage), une ouverture de magasin, un bar éphémère, une soirée d’entreprise (le lancement d’une voiture par exemple), un vernissage, une fête sur la plage. Le DJ est partout présent maintenant. Le DJ n’est plus seulement en club. c’est un métier qui a évolué et s’est diversifié.
IC : Quelles sont les qualités d’un bon DJ ?
Fl : C’est un métier qui demande de la rigueur et du travail, une bonne culture musicale pour la programmation, des qualités de créatif et des connaissances en matière de communication pour se vendre, la maîtrise de la MAO et des techniques du Mix. Mais en plus de tout cela, il faut aujourd’hui des connaissances solides en matière de droit, droits d’auteur et droit du travail. Le DJ est un chef d’entreprise.
Il faut avoir la tête sur les épaules et mettre de l’argent de côté car il n’y a pas de caisse de retraite pour les DJ. Un DJ peut gagner de 100 à 5 000 euros pour un Set (une prestation) ou 40 0000 pour une star, tout dépend du nombre de personnes que vous drainez. Certains commencent en auto-entrepreneurs mais si les revenus dépassent 32.900 euros par an, alors ce statut ne suffit plus. Certains montent leur agence de booking, ou passent par une société de portage dont ils seront salariés, auront ainsi des fiches de paye et un CDI. Les DJ ont deux emplois : l’un, alimentaire et l’autre de DJ. Il appartient à chaque DJ de bien négocier son contrat afin qu’y soient inclus tous les frais : de déplacement, de bouche, l’hôtel si besoin etc…
IC : Quel est le rêve de tout DJ ?
« Le rêve du DJ, c’est de faire LE morceau qui va cartonner pour faire danser les gens, comme le dernier gros carton « Animals » de Martin Garrix en 2013. »
[youtube id= »gCYcHz2k5x0″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
A 17 ans, il est probable qu’il a créé ce morceau dans sa chambre avant de le mettre sur une plate-forme comme YouTube. Il publiait des sons sur SoundCloud pour uploader ses créations. Quelqu’un d’une maison de disques a remarqué ce son et l’a embelli.
IC : Martin Garrix est Hollandais. Il a été classé en 2015, seulement deux ans après la sortie de son tube « Animals » en 2013, 3ème meilleur DJ du monde par DJ Mag. Il a une base de musicien : il joue de la guitare depuis l’âge de six ans. Il dit avoir souhaité faire ce métier en voyant Tiësto mixer lors des Jeux Olympiques. Il s’achète alors un logiciel pour composer ses propres morceaux.
IC : Peut-on parler de « chasseurs de talents » ?
Fl : Le DJ créateur est important, mais le découvreur l’est tout autant, de même que l’étape du mastering audio. Un tube, c’est plusieurs étapes.
✓ Un DJ doit avoir des connaissances, l’oreille musicale et de la technicité pour mixer.
✓ Une maison de disque apporte au morceau tout le travail effectué par l’ingénieur du son car un son non masterisé va être plat. Même si l’idée du son trouvé est bonne, sans mastering, il ne percera pas.
✓ Il faut ensuite une bonne communication et une diffusion maximum sur les radios et sur internet.
IC : On entend souvent parler de « nouveau son » . On parle du « son des Daft Punk ». Qu’est-ce que cela signifie ?
Fl : Le métier de DJ ne dure pas que le temps d’un Set, 2 à 5 heures, le soir en boîte ou ailleurs. Ce sont aussi des heures à écouter de la musique sur internet, à chercher des nouveaux morceaux, des idées. Puis d’autres heures passées sur un logiciel à mixer des sons pour essayer de créer un morceau (c’est la production) . On utilise des synthétiseurs virtuels ou non qui peuvent être a modulation afin de créer un son en partant d’une onde.
Le Dubstep est un exemple de « son » différent (distorsion). Backermat a lancé la mode de la Deep House avec un son saxophone et ça a marché. Aujourd’hui, le dernier « son » à la mode est la « Tropical House » avec un son flûte de Pan (Kygo : « Stole The Show »). Chaque nouveau courant s’éteint au fur et à mesure.
[youtube id= »BgfcToAjfdc » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Kygo est un pianiste norvégien de 24 ans. Il s’est lancé dans la production de musique électronique à l’écoute de « Seek Bromance » d’Avicii qui le contactera pour composer des reprises officielles de ses morceaux et faire la première partie de son concert à Oslo en 2014. Il s’est fait connaître grâce au upload sur Soundcloud et YouTube : 80 millions de vues sur internet.
Un son est nettoyé, travaillé pour qu’il ait du corps. A l’oreille, le son semble très simple et basique. Mais pour un professionnel, il est « plein » d’une centaine d’autres sons ajoutés en arrière-plan afin de le rendre plus riche et moins plat. On va par exemple augmenter les volumes, nettoyer les fréquences…
IC : Est-ce donc la Technique qui différencie le Mix de 1990 et celui de 2015 ?
Fl : Avant les années 1970, ce sont des orchestres ou des musiciens qui animent les soirées dansantes en boîte de nuit, dans les bals ou les clubs. Petit à petit, les DJ remplacent les orchestres et les musiciens car moins chers et jugés moins capricieux. Ils réussissent à faire danser le public de manière plus intense par la création d’une ambiance. Les tout premiers DJ sont apparus dans le milieu du hip hop. Les danseurs avaient besoin d’un DJ pour assurer la boucle musicale en fond.
IC : DJ Kool Herc, un Jamaïcain émigré aux Etats-Unis, est un pionnier. Il fut le premier à introduire des coupures de rythme (breakbeat) et à mixer deux disques réglés sur le même tempo. Il remarque que le public réagit davantage aux passages où les instruments rythmiques jouent seuls. Cela lui donne l’idée du sample : il passe en boucle un même extrait de chanson sur lequel ne sont présentes que la basse et les percussions.
Fl : Avant le mix était plus simple : il suffisait de passer d’un disque à un autre. Les gens ne possédaient pas beaucoup de disques. C’était le rôle du DJ que de se tenir au courant des nouveautés pour les diffuser et les faire découvrir au public.
IC : C’est ainsi que Laurent Garnier a ramené l’électro de Manchester par exemple quand il était DJ Résident à l’Hacienda.
Fl : Avant on allait en boîte pour écouter le son d’un DJ. Aujourd’hui on va y danser sur les tubes qu’on entend à la radio.
« Aujourd’hui tout le monde télécharge de la musique du monde entier. Un bon DJ ne se reconnaît donc plus uniquement à l’originalité de sa programmation musicale. Le métier est aussi bien plus technique. »
Avant, on avait deux platines et une table de mixage. On s’entraînait des heures pour trouver le tempo de création et mettre la musique A à la même vitesse que la musique B. Aujourd’hui on a des logiciels. De même, la musique électronique n’est plus un courant mais toute une famille musicale. Avant, on gravait des démos sur des vinyles. Aujourd’hui, tout est numérique : les DJ utilisent des plates-formes de téléchargement légales comme Soundcloud, YouTube, Amazone. Curieusement, on n’a jamais autant vendu de vinyles dans le monde depuis sa création qu’en 2014 !
IC : Que reste t-il des pionniers des années 1990 ?
Fl : Les vieux briscards sont toujours des mentors pour les jeunes un peu plus pointus qui se sont intéressés au mix et ont fait l’effort de connaître l’histoire du Djing à travers, par exemple, le livre de Laurent Garnier « Electrochocs » (qui a été réédité avec une suite prolongeant l’histoire jusqu’en 2015). On observe un grand retour des soirées type années 1990, mais dans un cadre légal, cette fois. Des tas de boîtes d’événementiel cherchent des lieux atypiques où recréer cette ambiance underground réservée à des initiés. C’est cet aspect « secret », réservé à quelques-uns, qui marche très bien. On a l’impression de faire partie d’une communauté restreinte et privilégiée. Le public visé a entre 20 et 30 ans. Cette nouvelle tendance rompt avec la jet set des clubs privés dans lesquels une tenue de soirée est exigée. Là, peu importe la tenue, l’âge, la classe sociale. On en revient à ce mélange de population des débuts qui faisait la réputation des fêtes.
On observe également une nouvelle tendance dans les clubs privés. Ces dernières années, ils servaient de location de salle. Ces derniers temps, certains retrouvent l’envie de se doter d’une direction artistique avec des têtes d’affiche connues, comme ce fut le cas dans les années 1990 avec David Guetta au Palace par exemple. C’est le cas au Red Light. Certains clubs comme le Badaboum abandonnent les codes vestimentaires obligatoires et la parité homme/femme. Tout est une question de mode, de cycle. Ca va et ça vient. Ca change tous les dix ans.
IC : Qui sont les DJ d’aujourd’hui ?
Fl : Il y a deux mondes :
✓ Celui des grandes stars comme David Guetta ou les Daft Punk
✓ Celui plus underground de DJ très connus dans le milieu du Djing, mais peu médiatisés et pourtant tout aussi bons. Certains font le tour du monde et sont réclamés dans les plus grands clubs.
Un nouveau courant, le « Boiler Room » est parti de Londres en 2010. Il s’agit d’organiser des sets à audience réduite, de les filmer afin de les diffuser ensuite sur le net via Ustream. Le DJ est au centre de la piste de danse et le public peut le voir, lui parler. Prenons l’exemple du DJ « Kink » : il est peu connu du grand public mais c’est un monstre dans le domaine du set de musique électronique technique : les fans peuvent observer comment il fait pour passer d’un morceau à un autre, ils peuvent voir sa sélection musicale et sa technique de mix. Il utilise des machines qu’on n’a pas l’habitude de voir. Il utilise des synthés en « Live ». Il a une platine vinyle pour la base rythmique, la table de mixage où toutes les sources audio arrivent (un mélangeur), puis des surfaces de contrôles pour gérer le logiciel de création musicale (séquenceur) et des synthétiseurs. Il fait tout en « Live », il recréé en live.
Vidéo d’un set de Kink en mode « Boiler Room » :
IC : Ce sont les fameux DJ Sets Live ?
Fl : En effet. Soit le DJ vient au club avec sa clef USB sur laquelle il a préparé son set. Soit il joue en direct et fait de la création en live. La musique est créée face au public. C’est ce que fait Paul Kalkbrenner. Ces sets en Live se font souvent devant un public d’érudits peu nombreux d’environ 200 personnes dans des clubs comme le Panic Room. Il y a très peu de promo ; il faut se renseigner sur internet, s’abonner aux pages facebook. Ce sont souvent les fans eux-mêmes qui font la promo de ces soirées Live par le bouche-à-oreilles. Ce côté intimiste, réservé à une poignée d’initiés fonctionne très bien. Ca donne de l’attrait à la chose, un peu comme les raves autrefois.
IC : Comment expliquez-vous que cette musique ait fédéré autant de monde ?
Fl : Parce qu’elle est efficace et simple. Il n’y a pas de paroles, on peut danser. On trouve trois types de public :
✓ Les early adopters : ce sont des fans de musique, d’un courant ou d’un artiste. Ils vont écouter les nouveautés , s’impliquer et participer à leur diffusion. Ce sont des passionnés prêts à suivre leur artiste préféré partout.
✓ Les middle adopters : ce sont ceux qui vont en club, aiment la musique mais ne sont pas fans au point de suivre l’artiste. Ils vont écouter la musique en club, en festival, programmée en playlist ou en poadcast.
✓ Les late adopters : ce sont ceux qui écoutent la musique à la radio, 2 mois après sa sortie.
La Tech-House a une rythmique très développée qui passe mal à la radio. Pour la radio et pour plaire au grand public il faut des sons moins techniques, plus mélodieux… Cela a pour conséquence le développement de pseudos. Certains DJ ont ainsi deux à trois pseudos derrière lesquels se cache en fait la même personne. Un DJ utilisera un pseudo pour le côté commercial, un second pour la production underground sur le net et un troisième encore plus confidentiel pour des mix très techniques réservés à un public averti sur des « webzine », des sites pour initiés early adopters. Ce système de pseudos permet à l’artiste qui commence à avoir du succès de pouvoir faire de la musique commerciale (qui se vend bien) avec des notes majeures formatées, avec toujours le même schéma, tout en continuant à produire de la musique électro plus difficile d’accès musicalement parlant avec des sons à tendance underground masterisés, gras et mélancoliques qui ne pourraient pas passer en radio et toucher ainsi un autre public.
Un exemple : « Pryda ». Il a quatre pseudos :
✓ Eric Prydz pour le grand public (DJ suédois de 39 ans, 30ème au classement DJ Mag)
✓ « Pryda » pour ne pas se laisser enfermer par ses fans.
✓ Cirez D
✓ Sheridan
Il est même capable de remixer un morceau d’un autre pseudo pour se faire de la pub. C’est l’un des rares artistes DJ à avoir eu l’autorisation de reprendre un morceau des Pink Floyd « Another Brick in the Wall » pour le remixer.
Vidéo Eric Prydz / Pink Floyd
[youtube id= »IttkDYE33aU » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
IC : Après le Royaume-Uni puis la France et Berlin, où se trouve l’avenir de la Techno en Europe ?
Fl : Dans le Nord ça bouge très bien, ils sont proches de l’Angleterre et de la Belgique où la musique est moins sectorisée qu’en France. On y trouve d’énormes fêtes. Beaucoup de Français montent là-bas faire des soirées. Les soirées belges et hollandaises sont très réputées.
[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Reportage Arte : « Techno Story »
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] DJ Network