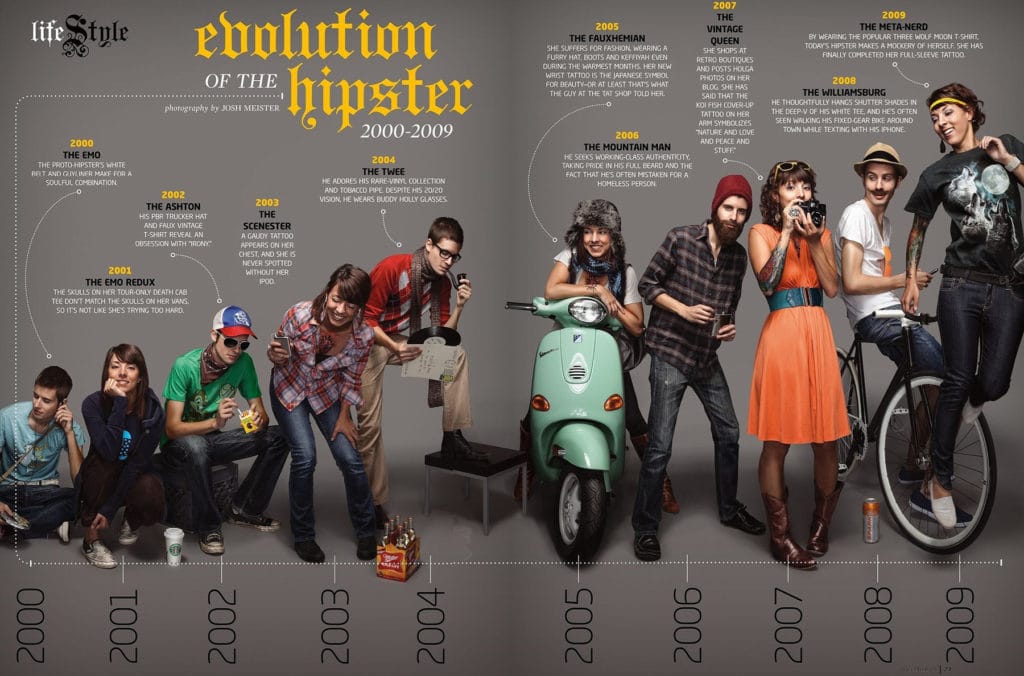[kleo_pin type= »circle » left= »yes » right= » » top= » » bottom= » »] « FOCUS »: un article de fond sur un thème que nos rédacteurs ont sélectionné.
« City Life » est une œuvre du compositeur américain Steve Reich. Très bien. Mais encore ?
Partie intégrante d’un large mouvement artistique venu tout droit des États-Unis, nommé « Musique Minimaliste », l’œuvre de Reich, inscrite dans ce que l’on appelle la « Musique Répétitive », est en elle-même originale dans le sens où depuis la fin des 60’s, le compositeur a inventé, développé, perfectionné un style qui lui est propre : le « Phasing ». Le déphasage, in French. Non pas que le monsieur soit lui-même déphasé, bien au contraire, et encore que, mais comme tout artiste qui se respecte ou se trouve respecté, Steve Reich conçoit et pense la musique, (les arts en général), dans sa réalité sociale.
Déphasage et réalité sociale, donc. Une interprétation. La mienne. Mais il n’y a pas que cela… D’autres œuvres peuvent différer, un peu, pas trop non plus, faut pas exagérer.
Steve Reich a mis de coté ses études en philosophie pour se consacrer à la musique. Musique qu’il a toujours connue. Papa est compositeur à Broadway, maman est chanteuse. Le fiston, féru de jazz, deviendra batteur, dans un premier temps. Depuis sa plus tendre enfance, il navigue entre New-York, où vit son père, et San Francisco, où vit sa mère. Il en fera état dans son œuvre « Different Trains ». Premiers déphasage ? Pour ses études en musique, pareil. La Julliard School of Music de New-York et le Mills College à Oakland, près de S.F.
Bon. Mais encore ? Eh bien, ses rencontres. Celles de Philip Glass, d’abord, puis de Terry Riley. L’un sur la coté Est, l’autre sur la cote Ouest… Le grand écart, encore. Autre chose, il participe en 1964 à la musique « In C », l’œuvre fondatrice du mouvement minimaliste répétitif, composée par Riley. Et puis, hop, c’est parti. Il fonde son propre ensemble en 1966, le « Steve Reich and Musicians » et ainsi commence sa carrière.
« City Life », pour revenir au sujet, est une œuvre majeure dans la musique de Reich. Elle date de 1995. Steve Reich a presque cinquante ans. C’est une œuvre de pleine maturité, donc. Maturité artistique, maturité philosophique, maturité spirituelle, maturité humaine. Elle met en œuvre le mélange de musique instrumentale et de sons préenregistrés. On nomme cela « Musique Mixte ». Elle met aussi en scène la ville de New-York et plus précisément un univers sonore de Manhattan.
[kleo_divider type= »short » double= »yes » position= »center »]
Dans la note de programme, le compositeur nous dit ceci : « contrairement à mes précédentes compositions, Different Trains (1988) et The Cave (1993), les sons préenregistrés sont joués ici en direct sur deux claviers échantillonneurs. Il n’y a pas de bande magnétique dans la performance, ce qui ramène à cette petite flexibilité habituelle de tempo, caractéristique de la performance live ». Tiens ! J’ai déjà lu quelque chose comme cela lorsque Beethoven parlait du métronome…
On y entend ainsi, mélangés aux instruments, des sons de klaxons, claquements de porte, carillon de métro, des alarmes de voiture, des battements de coeur, sirènes de bateau et de police, des discours (notamment les échanges entre pompiers lors du premier attentat du World Trade Center le 26 février 1993). Tout ceci faisant partie intégrante du tissu générateur de la pièce.
« City Life » s’ouvrant sur : « Check it out » et se concluant par : « Be careful », il est souvent écrit dans les différentes analyses que l’œuvre est à la fois reflet et rejet de la société. Qu’en nous plongeant dans un premier temps au centre de Manhattan, traduisant ainsi la vie trépidante, fourmillante qui y règne ; puis, en assombrissant peu à peu le ciel new-yorkais, Steve Reich cherche à mettre l’accent sur une vie citadine de plus en plus stressante, correspondant à une vision plus sombre qu’il aurait de la ville. Preuve à l’appui, le « Attention » concluant la fin de l’œuvre. Qu’en outre le regard du compositeur nous montre sa fascination/aversion pour la ville. Et pour finir qu’il s’agit en quelque sorte d’un documentaire sonore sur New York.
City Life part. 1 :
[youtube id= »Y5ntMwLKuG4″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Ce n’est pas mon interprétation de l’œuvre… Steve Reich n’est pas, à mon avis, dans cette forme de démonstration. Certes, la dualité existe en lui (ce fameux phasing). Certes, des forces opposées s’affrontent. Non seulement en nous, mais également dans notre monde (consonance/dissonance). Certes il expose, il figure mais il ne démontre pas (une forme en arche) *. Il témoigne, s’interroge et nous laisse à notre propre compréhension. L’homme est philosophe, spirituel. En cela, il n’impose pas, ne résout rien, nous laisse dans l’ambiguïté.
Dans ses œuvres, Reich utilise des matériaux volontairement réduits, musique minimaliste oblige : répétition continuelle de courtes phrases musicales (ostinato), écriture en canons rapprochés (déphasage graduel en boucle). Il y adjoint l’insertion de bruits plus ou moins musicalisés. En fait, souvent musicalisés.
Sa recherche sur les cycles rythmiques infinis, le sens de toute son œuvre (il a étudié les percussions à l’Institut des Études Africaines à l’Université d’Accra, au Ghana ; puis de retour aux Etats-Unis, il a étudié la technique des gamelans balinais) témoigne non seulement d’un goût prononcé pour le rythme (son coté batteur de groupes de jazz – il a aussi une prédilection pour Parker Charlie et Davis Miles) mais aussi d’une vision circulaire du temps. Un peu comme dans la philosophie Bouddhiste (j’dis çà, j’dis rien non plus).
[kleo_divider type= »short » double= »yes » position= »center »]
Pourtant, c’est là que réside la clef de son œuvre. Tous les compositeurs n’ont pas cette vision temporelle. Tu parles ! Nos sociétés occidentales ont une vision du temps… linéaire. En cela, dans leur musique, il devient difficile de se séparer de ce que nommait John Cage « la colle ». Comment se séparer de cette colle qui colle aux notes ? Un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock… Reich à sa réponse. Les minimalistes de sa génération ont tous peu ou proue la même. Un compositeur comme Morton Feldman en a une autre. Ça me fait penser qu’il faudrait que j’aille réécouter James Brown.
D’autres musicologues font état, comme pour essayer de nous rassurer, d’une logique dans cette volonté d’inscrire des bruits dans la musique instrumentale ; et ils nous disent que Reich a repris l’idée de Gershwin dans « Un Américain à Paris ». Pour le klaxon. Ah… Ouf ! Si Gershwin l’a fait… Peut-être. Mais que ne parle-t-on alors de Varese, Satie, Berlioz, Mozart (le père, pas le fils) ou bien Janequin (compositeur de François 1er) ? De tous temps, les compositeurs qui inscrivent leur œuvre dans leur réalité sociale, dans la vie, dans la ville, ont abordé le sujet. Il y en a bien d’autres sous d’autres formes.
« Tout est bruit pour qui a peur », nous dit Sophocle. Steve Reich ? A pas peur, lui… Il prend des risques. En sculptant la matière brute, il fait état du tumulte de la ville, de la vie. Ses « bruits », musicalisés, suggèrent des réponses instrumentales en contrepoint des klaxons, freins pneumatiques, dérapages et autre pile-driver. Le bruit n’est pas traité comme une simple illustration, il est la matrice de la pièce. En cela, « City Life » n’est pas un documentaire sonore, elle est le reflet d’une part de notre vie, de ce que nous engendrons. Et si maux il y a, dans Manhattan ou ailleurs, ils sont le miroir des nôtres, Inside us. Les battements de cœur qu’il nous fait entendre, notre pulsation à nous, notre musique, est aussi cette pulsation urbaine sur laquelle nous évoluons. En contrepoint, vous dis-je… Pour Reich, c’est à nous de réfléchir, voire d’agir sur notre environnement.
Auteur: Vincent Dacosta
[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]
Pour une connaissance plus technique sur le plan harmonique, par exemple, quoi de mieux que de se référer aux mots du compositeur. On peut trouver cette analyse sur le site de l’IRCAM.
* Une forme en arche : une forme musicale qui symbolise le cycle de la vie. Elle se présente ainsi : ABCB’A’ (ABC étant des thèmes et développements musicaux).
En 1998, l’album « Reich Remixed » est un hommage rendu par le gratin des artistes de la musique électronique. DJ Spooky, Tranquility Bass, Mantronix, Nobukazu Tekamara et autres Coldcut, ont créé à partir d’une ou plusieurs pièces de Steve Reich, un nouveau morceau. En écoute ici :
[youtube id= »-r7bOjI93hY » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
[youtube id= »eQIF_QE0TGk » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Entre 1996 et 1999, le groupe Sonic Youth, par l’intermédiaire de son propre label SYR, sort une série de quatre albums expérimentaux. Avec SYR4, datant de 1999 : « Good Bye 20th Century », Sonic Youth donne la parole aux compositeurs américains du vingtième siècle en reprenant des morceaux de Cage, Cardew, Reich, Wolf, etc.
SYR1 / Anagrama :
[youtube id= »_eSq9IkmtgA » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
SYR4 / Good Bye 20th Century :
[youtube id= »7SLAQdEiWhU » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
L’un des grands maîtres du chant polyphonique, Clément Janequin, Chantre du Roy François 1er, écrit en 1530 « Les Cris de Paris ». Point de samplers, mais une ambiance, celle de Paris et de ses camelots.
Les Cris De Paris :
[youtube id= »FiPhbS_ZlRk » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Steve Reich : Influences (Entretien avec Bloc.)
[arve url= »https://vimeo.com/42962767″ align= »center » title= »Steve Reich : Influences (caught by Bloc.) » maxwidth= »900″ /]
PARTENAIRES :