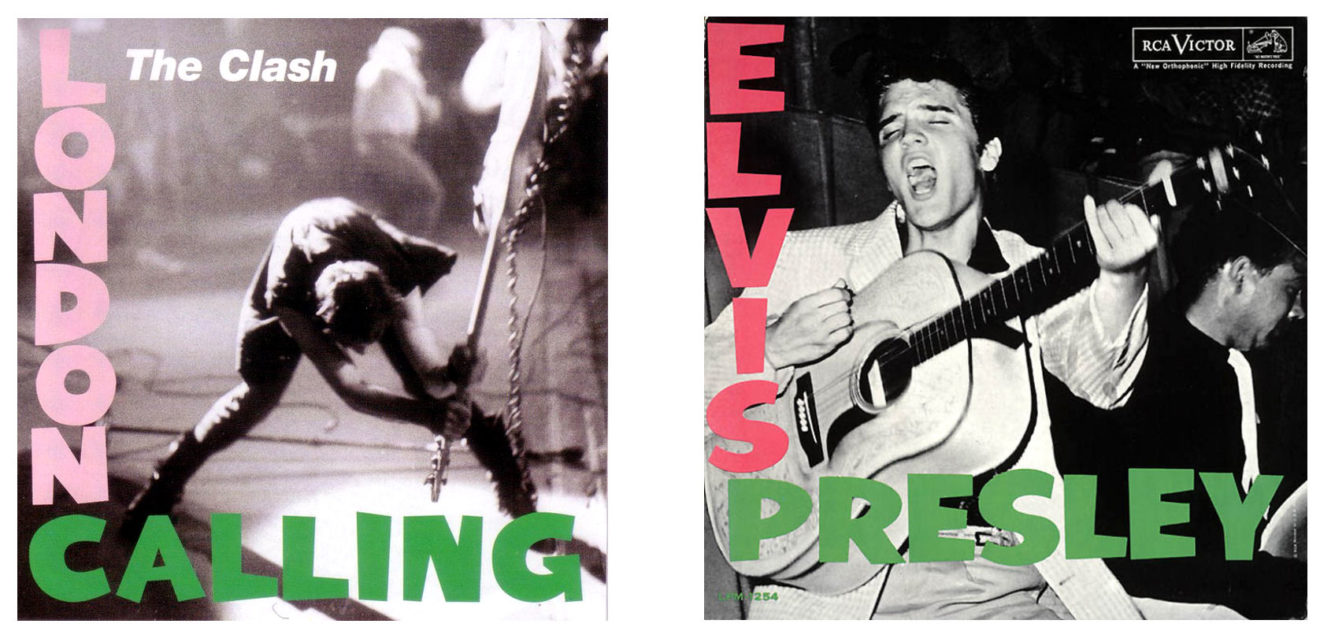[kleo_pin type= »circle » left= »yes » right= » » top= » » bottom= » »] « FOCUS » : un article de fond sur un thème que nos rédacteurs ont sélectionné.
L’année 1979 est définitivement une année-charnière, comme la fin d’un cycle. Elle scelle le sort des dernières utopies. Le monde prend une pelle et enterre à la hâte les cadavres encore fumants de nos illusions perdues. Après 1979, rien ne sera plus vraiment comme avant…
Coincée à la fin d’une décennie qui paraît un peu creuse, durant laquelle les dirigeants politiques semblent manquer de charisme (le pâle Carter face au cowboy médiatique Reagan, VGE après De Gaulle et Pompidou), l’année 1979 n’attire décidément pas les flashes. Et pourtant… Que d’événements considérables ont eu lieu cette année-là, autant de tremblements qui ont marqué la face du monde et dont on ressent encore les répliques quarante ans plus tard.
Révolution iranienne, arrivée de Saddam Hussein au pouvoir en Irak, début de la Guerre d’Afghanistan qui mènera à la chute de l’URSS et à l’apparition du terrorisme islamiste, second choc pétrolier et crise économique mondiale, paix entre Israël et l’Egypte, fin des Khmers Rouges… Il n’est pas insensé de penser que 1979 a en réalité été l’année la plus importante de l’après-Seconde Guerre Mondiale.
Cette année 2019 est ponctuée de deux anniversaires. Il y a 50 ans, du 28 février au 2 mars 1969, les « Halles Centrales » partaient à douze kilomètres de Paris, à Rungis. Dix ans plus tard, le 4 septembre 1979, était inauguré le Forum des Halles, en présence de Jacques Chirac, Maire de Paris.
Il y a soixante ans, le 6 janvier 1959, au terme de longs débats, le Conseil des Ministres décide par ordonnance de transférer les Halles de Paris à Rungis et à la Villette. Malgré la mobilisation d’une partie de l’opinion en faveur du maintien des pavillons de Baltard in situ, leur démolition commence en 1971, deux ans après le déménagement des Halles Centrales et l’ouverture du nouveau marché de Rungis, au sud de Paris, devenu le plus grand marché de produits frais au monde en approvisionnant plus de 18 millions de personnes.
Pour mieux appréhender ce microcosme et ses usages avant qu’il ne disparaisse à jamais, Daniel Karlin partait en 1969 à la rencontre de ces travailleurs du marché des Halles Centrales, aussi surnommées par Zola « le Ventre de Paris ». On y croisait ces témoins de métiers aujourd’hui disparus : une approvisionneuse qui vendait les produits qu’elle achetait aux maraîchers, un tasseur qui montait des tas de légumes sur le carreau des Halles, Marius dont le bistrot était face au Pavillon de la Marée ou encore le plus ancien mandataire de viande, arrivé aux Halles en 1915.
Mémoires d’un vieux quartier | ORTF | 08/10/1969 (Images d’archive INA)
[youtube id= »HOcxel8ma2w » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Suite au déménagement en 1969 des Halles de Paris, installées depuis le 12ème siècle en plein coeur de la capitale, dans l’actuel 1er arrondissement, vers la banlieue de Rungis (Val-de-Marne), des habitants du quartier, d’anciens commerçants, vendeurs et « Forts des Halles » témoignent, avec nostalgie, de cette époque révolue où, du fait de sa localisation au centre de Paris, il existait une réelle ambiance et confraternité entre les résidents des Halles. Commentaire sur images factuelles et d’archives, interviews, témoignages et explications de ce qui sera construit à la place des anciennes Halles, sur fond de travaux publics, d’ouvriers, de chantier des nouvelles Halles et d’images du quartier, constituent la base de ce reportage tourné en 1977.
Images d’archive INA | 19/12/1977
[youtube id= »Oz-RwqGjCn0″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Ce déménagement permet ainsi de concevoir une vaste opération d’urbanisme au cœur même de la capitale, pour redynamiser le centre de la rive droite. Le projet du Forum des Halles voit le jour, afin de créer une véritable ville souterraine, liée aux transports en commun et comportant des équipements commerciaux, culturels, sportifs et de loisirs. Cette orientation est confirmée par la décision gouvernementale d’y réaliser le point central d’interconnexion du RER, le Réseau Express Régional, situé à plus de 20 mètres sous terre.
Durant l’été 1971, la démolition des Halles Baltard est donc rendue nécessaire afin de créer, à ciel ouvert, la gare souterraine du RER. Le vide et l’espace vacant laissé sur la partie ouest du site reçoivent rapidement le surnom de « Trou des Halles ». Au cinéma, le site sert, en 1973, à la transposition en plein Paris des aventures de Buffalo Bill, du général Custer et des indiens dans « Touche pas à la Femme Blanche », interprété par Marcello Mastroianni et Philippe Noiret. On l’aperçoit également dans « Les Gaspards », ayant pour thème les grands travaux de cette époque.
Ce « Trou des Halles » symbolisera durant plusieurs années cette France en pleine mutation, entre traditions séculaires et modernité, et marquera l’entrée du pays dans la société de consommation et des loisirs. Malgré les résistances, c’est un monde qui disparaît avec la fin des « Halles Centrales ». La faune du quartier des Halles dans ces années 70, entre petits maquereaux, receleurs, dealers et punks, s’accroche à ses dernières chimères…
Aujourd’hui Magazine | Antenne 2 | 19/12/1977 (Images d’archive INA)
[youtube id= »NDMLrzaU_qM » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
A partir de 1979 et l’inauguration du Forum des Halles, le quartier des Halles verra déferler massivement, grâce à l’interconnexion du RER, une jeunesse en mal de consommation et de loisirs, fuyant l’ennui des cités-dortoirs. Les petites frappes de la décennie précédente se voient supplantées peu à peu par la nouvelle délinquance à la mode « banlieue », bâtissant la triste réputation du quartier jusqu’à sa nouvelle réhabilitation dans les années 2010.
L’inauguration du Forum des Halles a lieu le 4 septembre 1979, en présence de Jacques Chirac, maire de Paris. 190 enseignes s’installent sur 43.000 m2 répartis sur quatre niveaux. L’ensemble de cette première tranche comprend 70.000 m2, auxquels il faut ajouter 50.000 m2 de parcs de stationnement.
Sources : Wikipedia / Ina Vintage