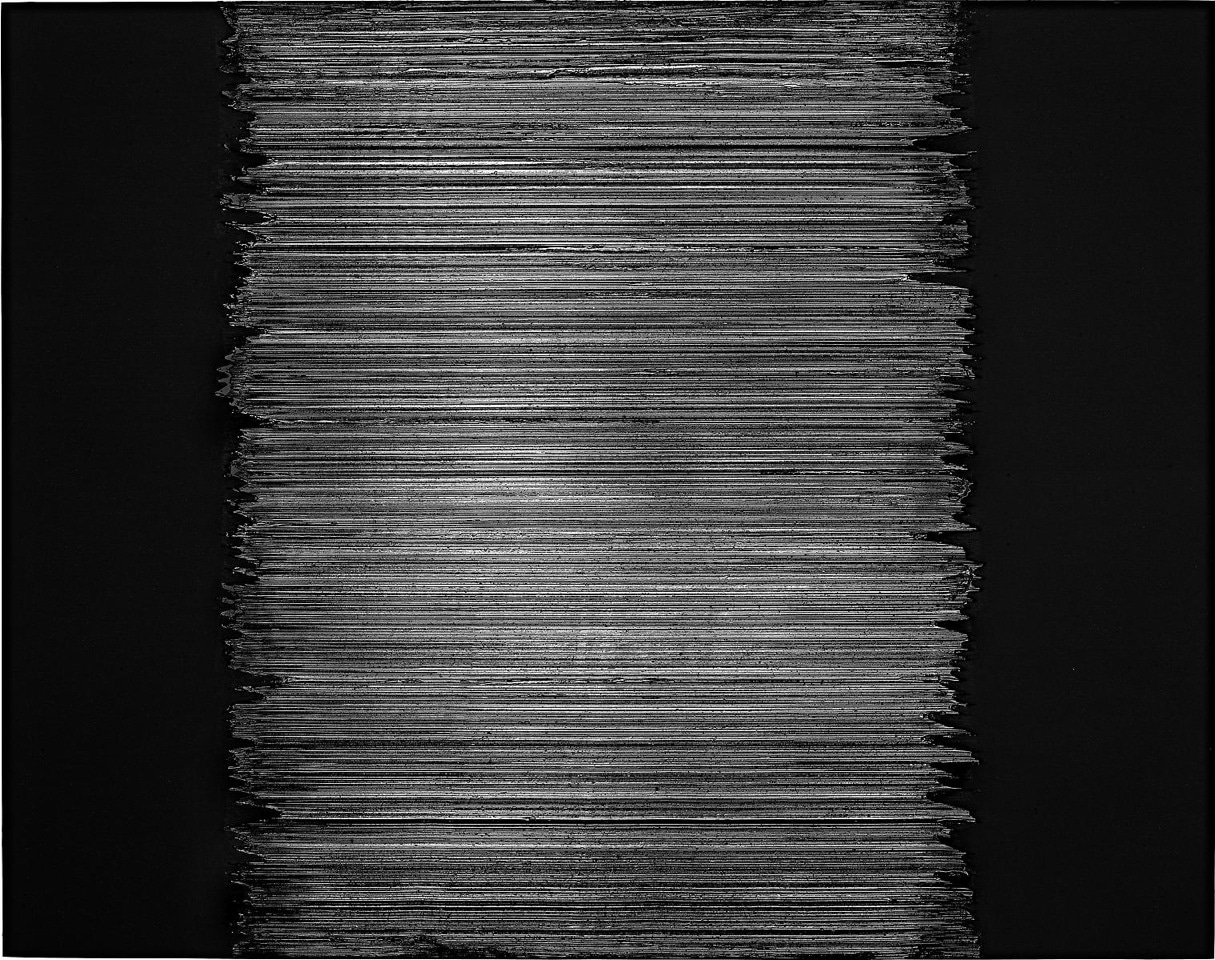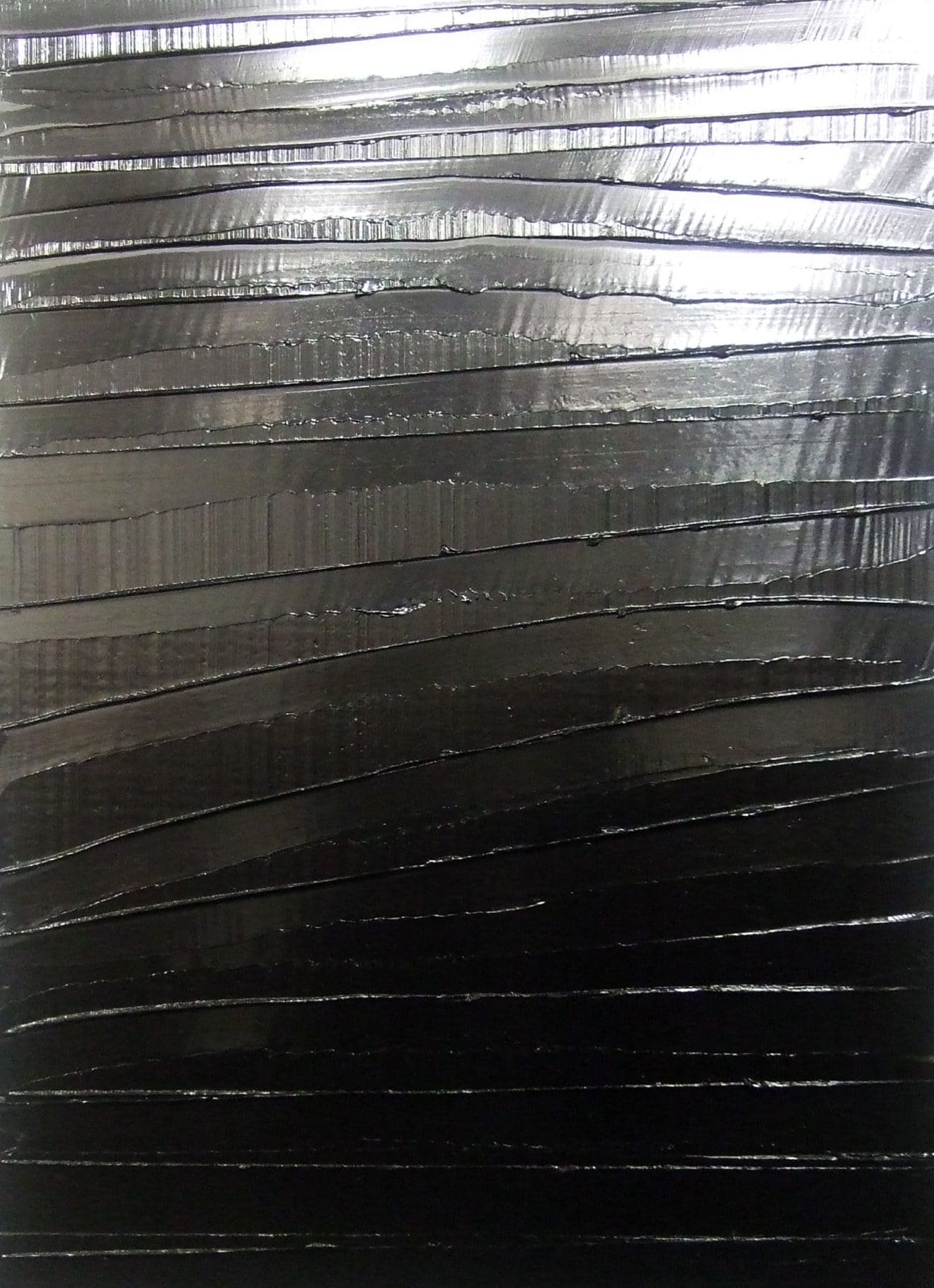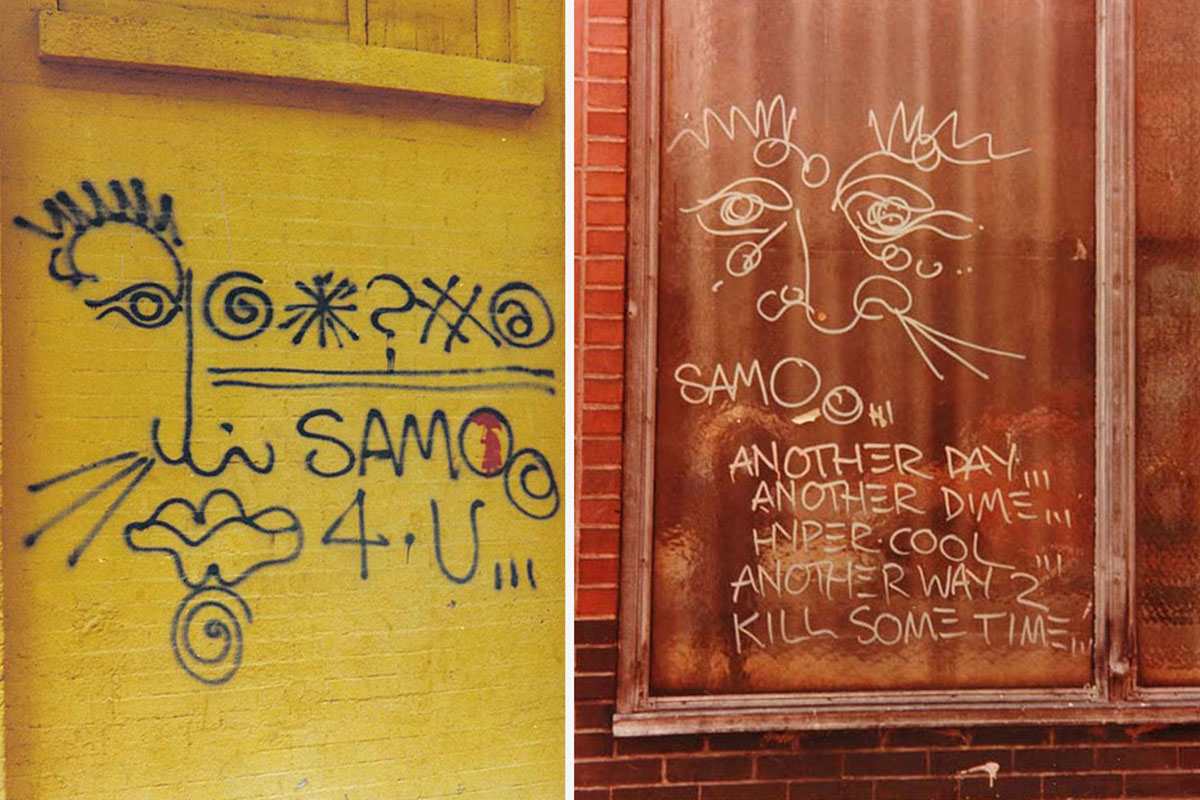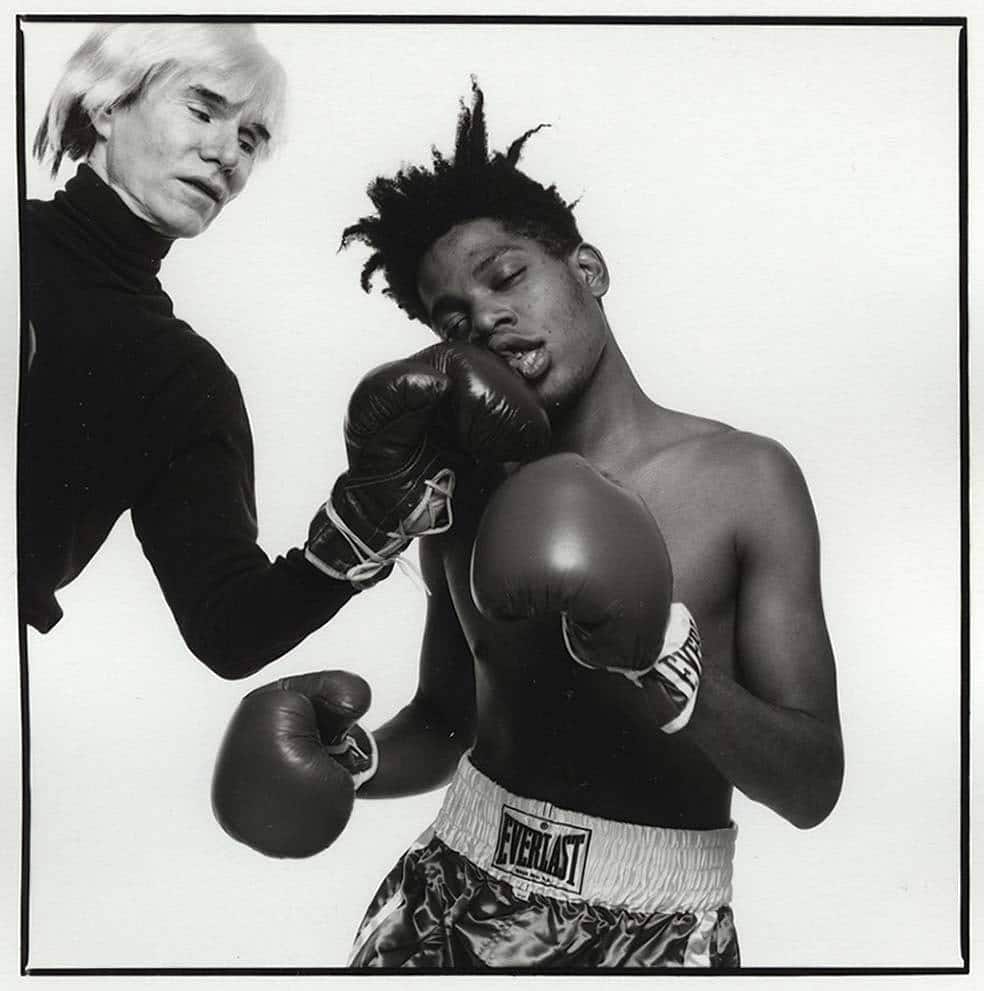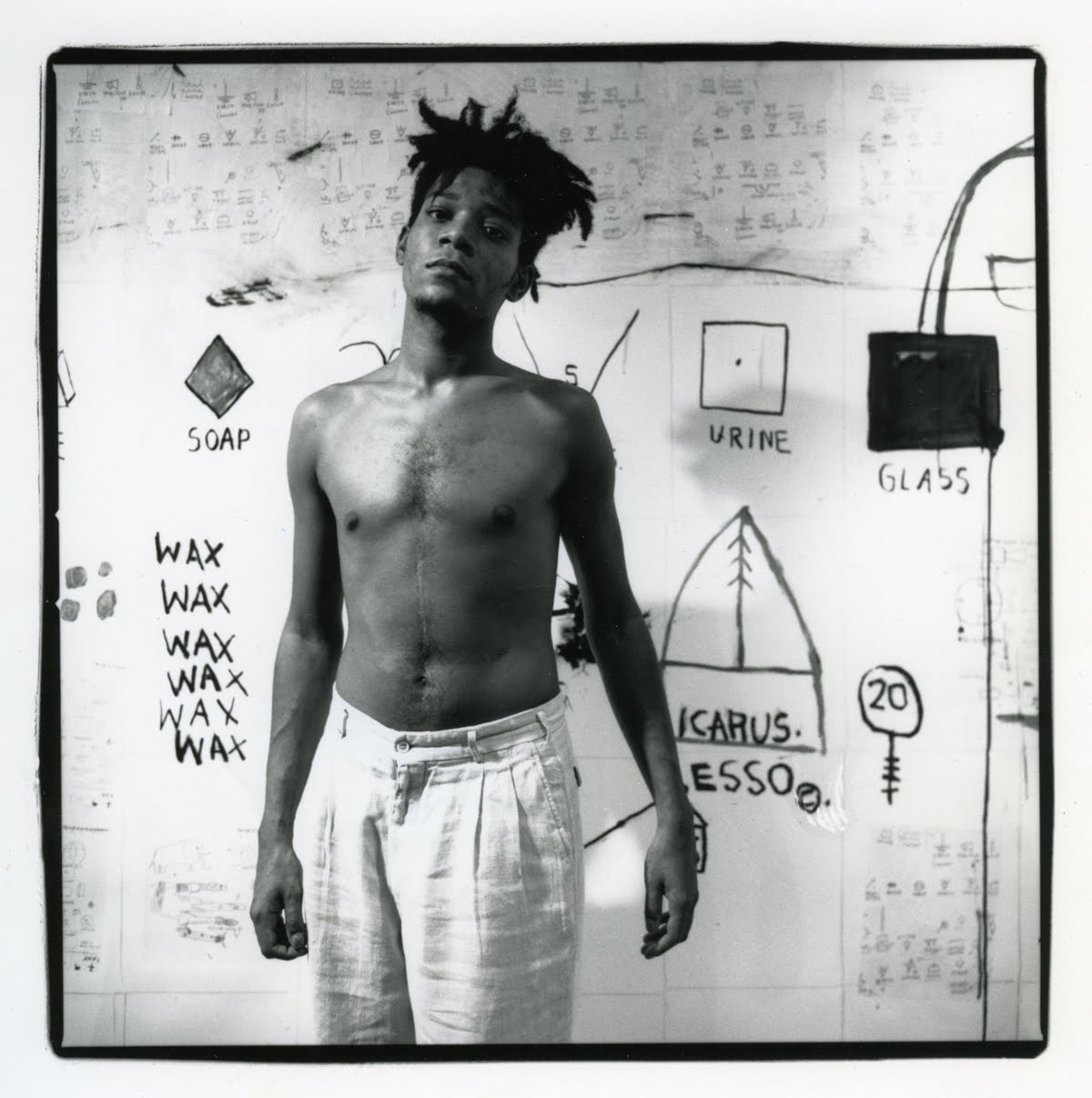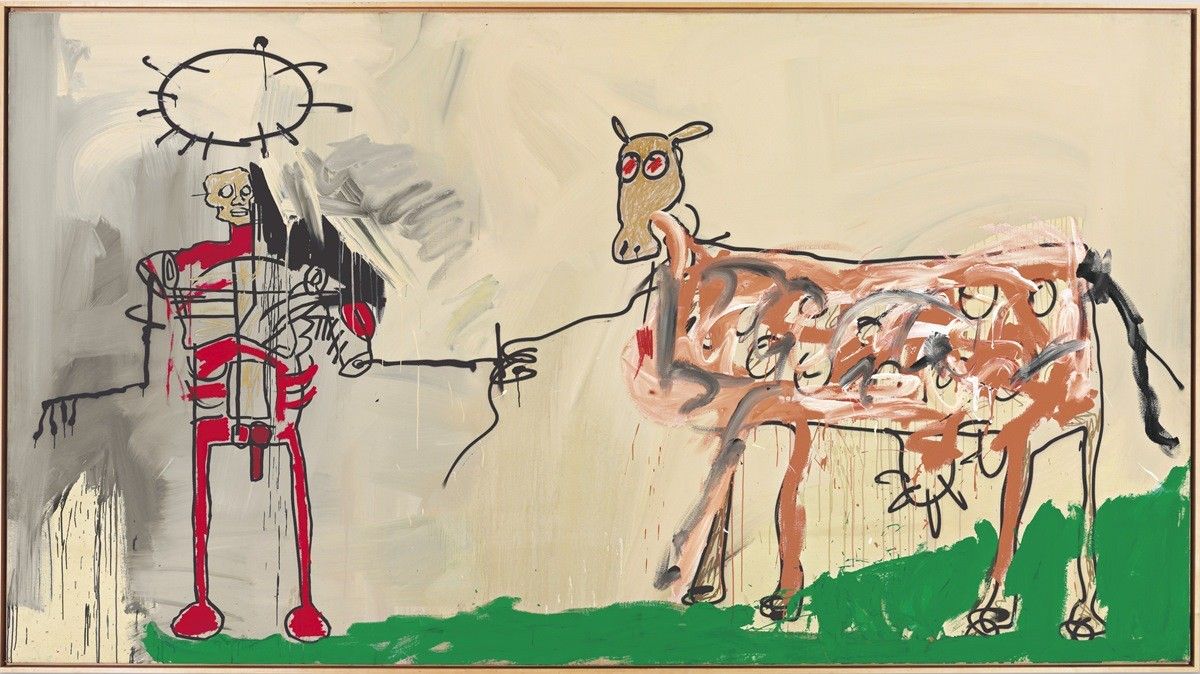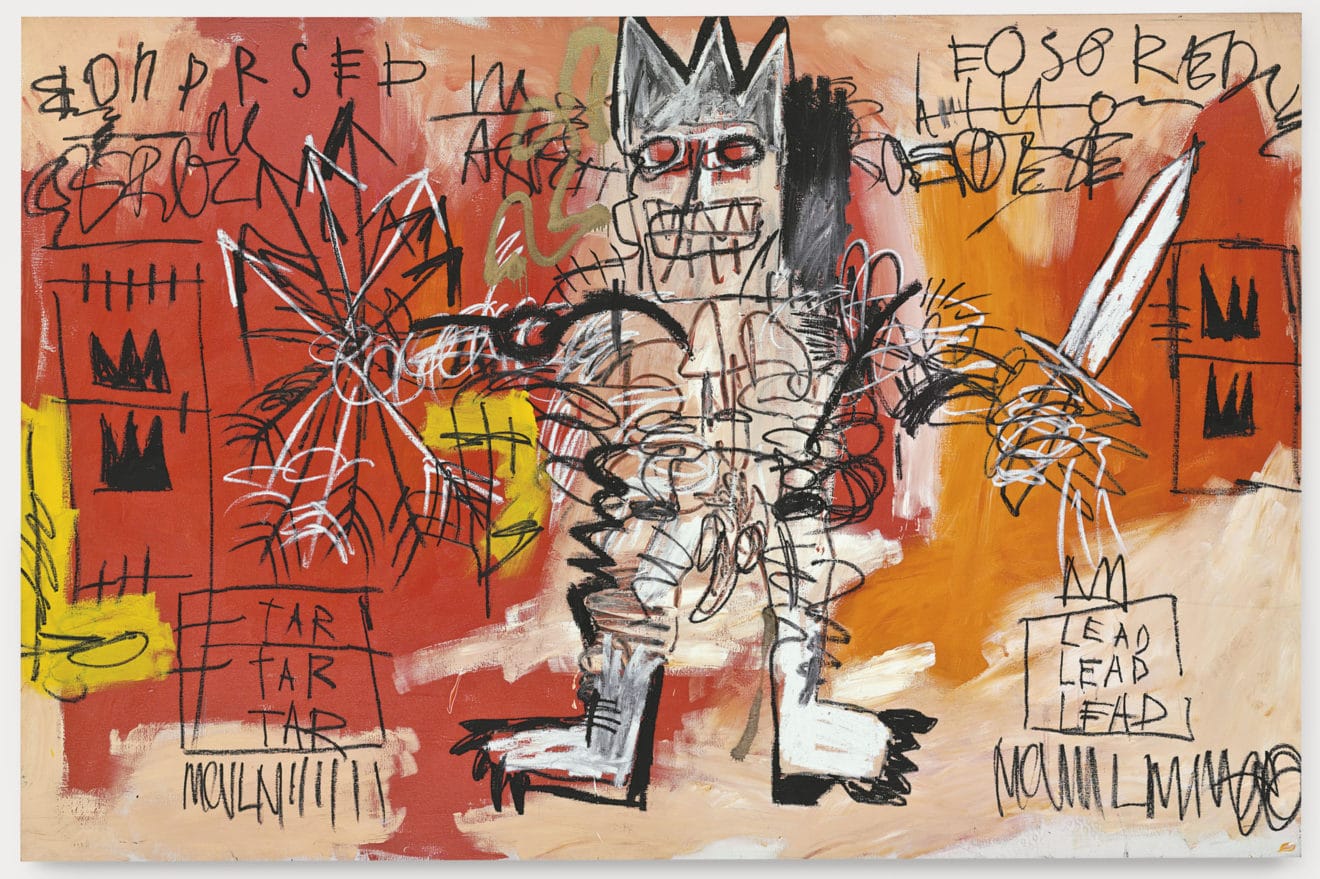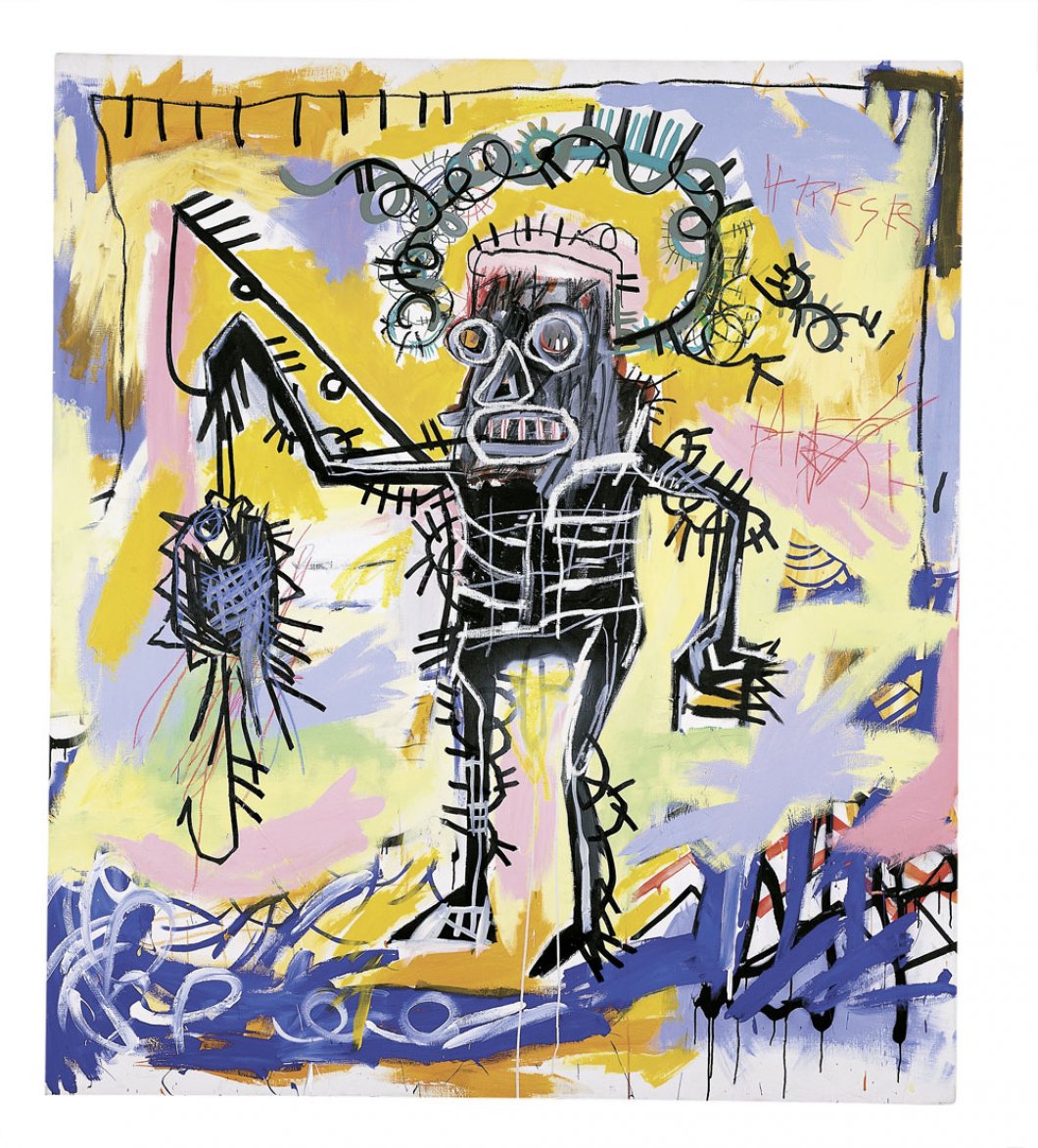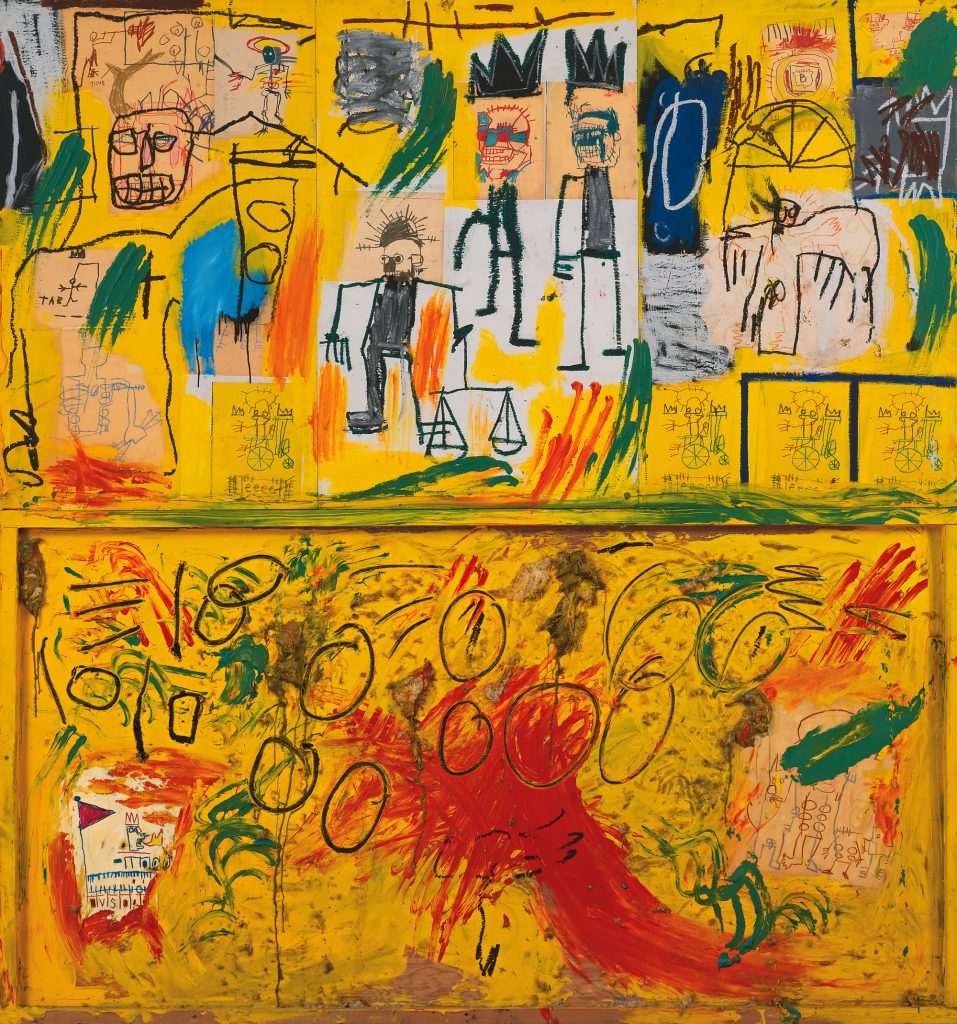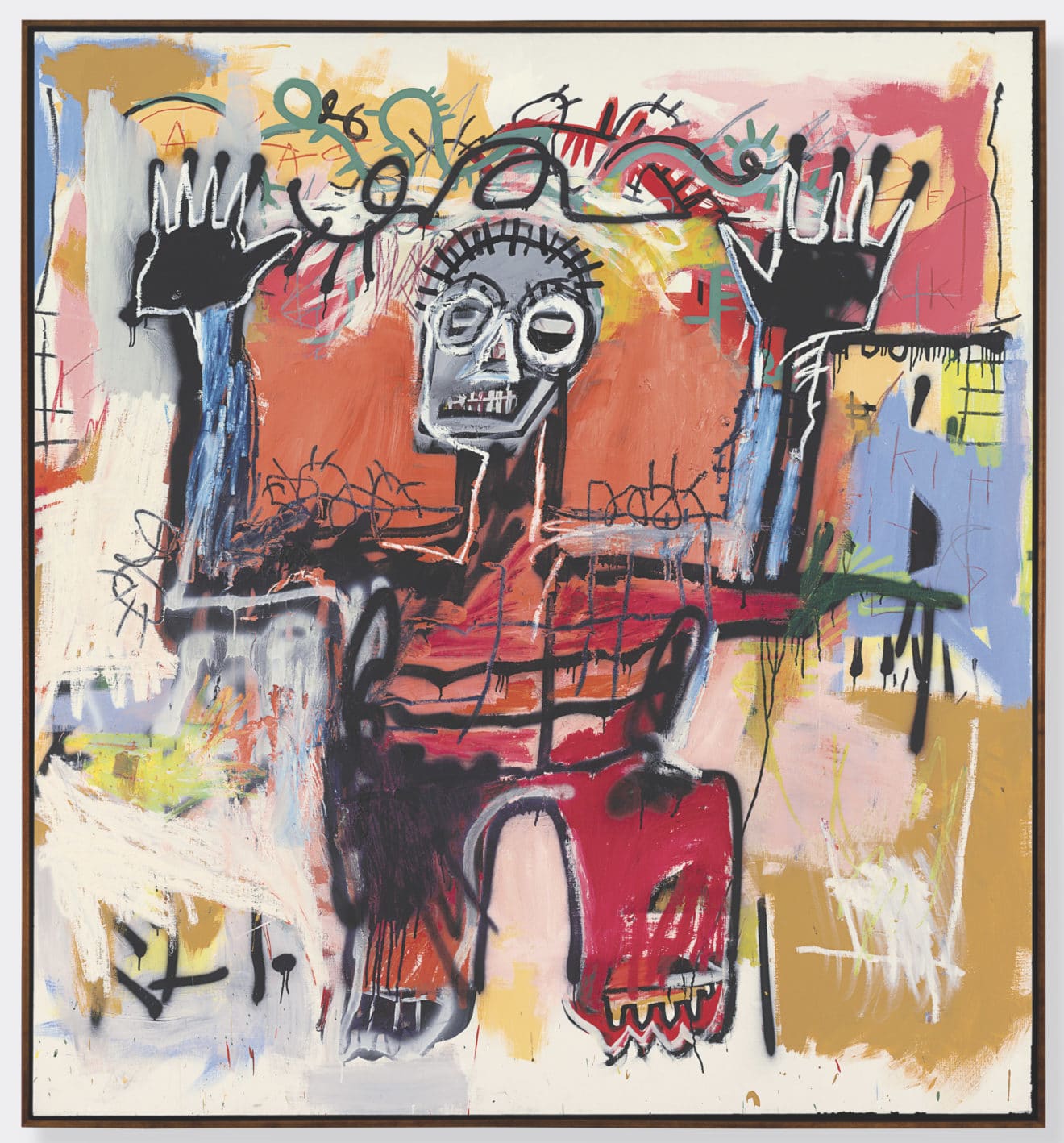Honneur aux Renoir père et fils au Musée d’Orsay. L’exposition met en regard l’oeuvre du peintre, Auguste Renoir, et celle du cinéaste Jean Renoir.
Entre deux artistes, père et fils, entre un peintre et un cinéaste, la relation a toutes les chances d’être féconde. C’est ce que nous montre l’exposition consacrée à Auguste et Jean Renoir au Musée d’Orsay, « Renoir Père et Fils », jusqu’au 27 janvier 2019. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour découvrir ces tableaux, photographies, extraits de films, affiches ou costumes.
Le peintre Pierre-Auguste Renoir a 53 ans lorsque naît son fils, Jean. Il est déjà un maître incontesté de l’Art français. Quant au réalisateur de « La Grande Illusion », il n’a que 25 ans lorsque son père disparaît en 1919, il y a cent ans. Tous deux partagent une profonde humanité et un goût affirmé de la liberté.
Le Musée d’Orsay propose une exposition familiale inédite, un dialogue entre un père et son fils. Retour sur une filiation artistique unique… Auguste Renoir, le célèbre peintre impressionniste, à qui l’on doit, entre autres, « Le Déjeuner des Canotiers », et Jean Renoir, le réalisateur de quelques uns des plus grands classiques du cinéma français, comme « La Règle du Jeu » en 1939.
« Les relations entre Jean Renoir et son père évoluent au fil du temps. Il dira d’ailleurs qu’il a passé sa vie entière à déterminer l’influence de son père. Il alternait, dit-il, des périodes durant lesquelles il se gavait de formules qu’il croyait tenir de lui, et d’autres périodes où il a rejeté en bloc cet héritage. » (Sylvie Patry, Commissaire de l’Exposition)
« Jean fut assez vite mis en pensionnat, et il voyait assez rarement son père. Il conservait néanmoins un contact privilégié à la création, puisqu’il a posé à une soixantaine de reprises pour son père. » (Sylvie Patry, Commissaire de l’Exposition)
Jusqu’à la mort d’Auguste Renoir en 1919, les modèles défilent dans son atelier, notamment Catherine Hessling. Jean Renoir tombe sous son charme et l’épouse en 1920.
« Jean Renoir a vu Catherine Hessling poser pour son père quand il était jeune homme, et il a pu effectivement la désirer. La voir là, avec cette manière de capter la lumière, quelque chose de si important pour son père et qui deviendra tout aussi important pour lui… Rien d’étonnant que Catherine Hessling devienne ensuite sa muse inspiratrice, celle pour qui finalement Jean Renoir aura envie de faire des films… » (Matthieu Orléan, collaborateur artistique de la Cinémathèque de France)
Il prétendra plus tard qu’il est venu au cinéma uniquement car il voulait faire de sa femme une vedette, simplement parce qu’elle était passionnée de cinéma. Mais il se trouve que lui aussi était tout aussi passionné. Ils allaient d’ailleurs voir beaucoup de films ensemble, d’Erich Von Stroheim, de Chaplin. Le cinéma fut un trait d’union entre eux, pour devenir ensuite un projet commun, avec en toile de fond un besoin profond de créer.
« On a du mal à voir la même femme, entre les tableaux la représentant, peints par Auguste, et les films dans lesquels elle joue ensuite, car d’un côté, elle tend vers l’idéal pictural renoirien, avec cette beauté presque « antique », quand de l’autre, elle se métamorphose dans les films de Jean, pour devenir un corps moderne, différent, presque grotesque, qui a du beaucoup surprendre le spectateur de l’époque. » (Matthieu Orléan, collaborateur artistique de la Cinémathèque de France)
De 1924 à 1928, Jean et Catherine tournent six films ensemble, notamment « Nana » en 1926, tiré du roman d’Emile Zola, dont Auguste Renoir était très proche. Jean Renoir reste encore très influencé par les références culturelles paternelles, ainsi que par les nombreux dialogues qu’il a pu nouer avec les amis de son père, ou dans son entourage proche, parmi les peintres ou les écrivains.
« La Fille de l’eau », Jean Renoir (1924)
[youtube id= »kg6pMvjoNfo » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Mais Jean s’intéresse aussi beaucoup à l’art de son propre temps… Sa grande culture s’est éminemment forgée au contact d’artistes plus contemporains qu’il rencontrera sur sa route, tels que le photographe Henri Cartier-Bresson ou l’écrivain Georges Bataille. Renoir a su en tout cas catalyser toutes ces influences dans ses films.
Jean Renoir s’émancipe enfin de l’influence paternelle, et va réaliser en l’espace de trois ans, entre 1937 et 1939, ses trois grands chefs d’oeuvre, rentrés depuis au panthéon du cinéma français : « La Grande Illusion », « La Bête Humaine » et « La Règle du Jeu ».
Dans cette partie plus « politique » des années 30, on est assez loin de l’impressionnisme renoirien… Au début du second conflit mondial, fort de son succès d’avant-guerre, Renoir décide de rejoindre les Etats-Unis, où il tournera sept films.
Jean Renoir rentre en France en 1946, pour « un retour aux sources » justifié par un certain nombre de raisons, la maturité, la vieillesse, la douleur de l’exil, et c’est un peu comme s’il ressentait de nouveau le besoin de remettre ses pas dans ceux de son père. Avant la guerre, « Partie de Campagne » sorti en 1936 en était déjà probablement le symptôme le plus visible, avec certaines scènes du film en résonance avec les tableaux d’Auguste. Après la guerre, c’est avec « French Cancan » en 1954, et le Montmartre de son père qui resurgit sur le plateau de cinéma, que le dialogue reprend…
« Et de nouveau, l’approche de la création les réunit ; le fait que l’artiste soit avant tout un artisan, cet attachement au modèle, une certaine conception de la nature, dans une forme de panthéisme. Et puis, évidemment, ce travail autour de la couleur et de la lumière, et cette volonté de donner une impression de naturel… » (Sylvie Patry, Commissaire de l’Exposition)
En deux siècles, donc, les Renoir père et fils auront révolutionné la peinture et le cinéma. De grandes familles d’artistes, il y en eut, mais chez les Renoir, la singularité, c’est que nous avons affaire à l’un des plus grands peintres de l’histoire, comme à l’un des plus grands cinéastes… Et que chacun ait apporté une pierre significative à l’édifice de leur art respectif.