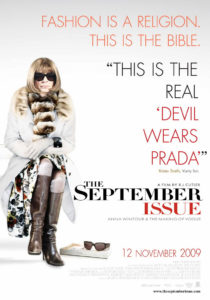Un peu de numérologie et d’histoire…
Ce sont pratiquement quarante années qui séparent l’épisode Star Wars (« A New Hope ») de celui qui vient tout juste de sortir, « The Force Awakens ». Quarante années qui embrassent aussi quatre générations, quatre réalisateurs et quatre scénaristes différents. Si vous aimez la numérologie à ce point, « La Guerre Des Étoiles » sortie en 1977 est devenue, dans la chronologie de la fresque globale, l’épisode 4. Bon, c’est George Lucas qui est le grand ordonnateur de tout cela. Le fondateur, le grand manitou, le gros bonnet, le boss quoi…
Ce barbu grisonnant à l’allure dégingandé et timide, arborant une sorte de banane à la Dick Rivers et adepte des chemises à carreaux imagina un jour un mix improbable du « Seigneur des Anneaux » dont il n’avait pas pu acheter les droits à l’époque et de « Flash Gordon », un sérial comme on appelait ce genre de productions dans les années 50. Il crée en superposant toutes ces références, qu’elles soient littéraires (« LOTR », les Récits Arthuriens, ainsi qu’Asimov et Franck Herbert), télévisées (« Flash Gordon ») ou cinématographiques (Les films d’aventure et de cape et d’épée de l’âge d’or d’hollywood ou bien encore Kurosawa et ses films de sabres), le tout lié à la farine Joseph Campbell (un romancier historien spécialisé dans la mythologie) et obtient au final ce qui allait devenir l’ultime représentation de la pop culture mondiale, soit une vulgarisation des grands mythes fondateurs de notre histoire fondue avec de la religion Bouddhiste.
L’identité Star Wars était née, modelée par les mains de l’alchimiste Lucas, et allait perdurer à travers les décennies suivantes, avec ou sans films nouveaux d’ailleurs, mais grossir, s’étendre et faire toujours plus de nouveaux adeptes. Le titre initial avec ce logo en grosses lettres jaunes sur fond de nuit galactique était devenu une formule magique, pas seulement pour tous ceux qui avaient compris assez tôt, comme Lucas lui-même, qu’il y avait beaucoup d’argent à se faire avec ces deux mots-là, mais aussi pour des enfants à l’époque qui grandiraient avec Ce et bientôt Ces différents films dans les yeux et dans le cœur.
La force de cette saga, si je puis dire, c’est qu’à la différence du « Seigneur des Anneaux » ou de « Harry Potter » qui sont d’abord des œuvres littéraires à succès, pour devenir par la suite aussi des films acclamés, la première trilogie de Lucas vient quant à elle de nulle part. Rien qui ne précède ce phénomène de société devenu instantanément mondial… Dans l’histoire de la littérature et du cinéma, ou de tout autre support artistique d’ailleurs, c’était sans précédent. Star Wars, au delà de ces représentations cinématographiques que l’on connaît, peut aujourd’hui évoluer et continuer à grandir toujours dans l’imaginaire des fans, des concepteurs de jeux vidéo, des illustrateurs, des fabricants de jouets, de textile, de mugs ou des romanciers en mal de lecteurs.
C’est un monde sans limite, sans contour, sans début et sans fin.
C’est pour cela qu’il génère autant de passions, de débats, de haine et d’amour. Georges Lucas a enfanté un monstre qu’il a fini par ne plus pouvoir maîtriser du tout. Lui, reconnu justement comme un obsédé du contrôle absolu, de la fabrication de ses films de A à Z jusqu’au suivi des produits dérivés et du merchandising, finit par comprendre que cet enfant allait un beau jour se retourner contre son père.
Lorsqu’il proposa sa nouvelle trilogie en 1999, « La Prélogie », qui situait l’univers de la saga antérieure à celle que l’on avait découvert en 77, il ne s’attendait sûrement pas à tout ce déchainement de gentils fans dociles devenus incontrôlables et acrimonieux. Pourtant Il avait déjà du faire face à la vindicte de ses « fans » lorsque bien mal lui en prit de vouloir « retoucher » sa première trilogie, en remaniant et boostant des plans ou des scènes entières qu’il jugeait avoir en partie ratés à l’époque de leur fabrication. Avec l’évolution des effets spéciaux, l’avènement du numérique et des images de synthèse, il pouvait enfin obtenir ce qu’il avait en tête depuis que Star Wars émergea de son cerveau… Mais profaner le temple, c’était comme insulter dieu lui-même ou ce que cela représentait de sacré pour des adeptes devenus entre temps fanatiques et donc radicaux.
Il mit donc de côté cette première incitation à la révolte et ferma les yeux sur ces rebelles. Fort de tout ce que désormais proposaient les avancées en terme de modélisation gérée par ordinateur, c’est donc avec une ambition renouvelée et assez folle que Lucas souhaita enfin raconter l’histoire d’Anakin Skywalker, qui deviendrait Darth Vader. C’est avec les moyens technologiques dont il avait toujours rêvé qu’il allait enfin pouvoir faire tout ce qu’il désirait, tout montrer, tout concrétiser : sa fameuse guerre des clones.
George Lucas, en créant Star Wars en 1977, ne voulait pas seulement raconter une épopée surannée, avec l’éternel combat des forces du bien contre celles du mal, mais se servir de tous ces thèmes forts et fédérateurs pour pourvoir surtout innover, surprendre et être à chaque fois le pionnier en termes d’effets spéciaux, de son et d’avancée technologique. Toujours plus audacieux, George Lucas tenta le pari de sublimer Le Star Wars tel qu’on l’aimait, mais cette fois en traitant aussi de politique, des arcanes du pouvoir et de ce qui amène une république à choisir un tyran plutôt que des solutions démocratiques. Bref, un pari à haut risque et surtout naïf que de croire en l’intelligence des masses endormies qui se réveillaient elles juste dès la moindre évocation du titre « Star Wars » sur un emballage de céréales.
En essayant également de renouveler l’image que l’on connaissait de cette saga, d’avancer, d’innover, aussi passionnante qu’était la démarche intrinsèque de Lucas, il se heurta fatalement, violemment, au prosaïsme de tous ces gardiens du temple. Les épisodes I, II et III paradoxalement situés avant « Un Nouvel Espoir » faisaient trois bons en avant en explosant toutes les limites qui avaient jusqu’à présent frustré l’inventeur du son THX. Jamais une série de films ne fut autant décriée, conspuée, détestée par des fans qui, trois autres films plus tôt, ne juraient que par cet homme à l’allure débonnaire. Ces mêmes fans à qui il fallait désormais rendre des comptes et qui criaient à la trahison et au sacrilège en oubliant d’abord que celui qui leur proposait ces nouveaux films était pourtant George Lucas lui-même, le propriétaire intellectuel de toute cette histoire.
Ce que l’on comprend et que l’on retient donc est sans appel.
Star Wars ne peut pas évoluer, se transformer, devenir autre chose que ce qu’il a toujours été. Il doit se contenter d’être Star Wars, soit une certaine esthétique avec des canons biens définis et des personnages qui rentrent également dans un moule établi, un monde, un univers qui ne peut en aucun cas se modifier ou changer d’aspect. Immuable, un monde sous cloche et Lucas, passé de réalisateur à inventeur visionnaire, devait à présent endosser selon les ordres donnés par les « fans », la défroque d’un taxidermiste.
Cependant, si on enlève Jar-Jar Binks, quelques mauvais dialogues de ci de là, des scènes de batifolage à la Sissi Impératrice entre Anakin tout niaiseux et sa dulcinée, il reste trois films aux idées sublimes, une certaine démesure, des batailles épiques et grandioses, des duels titanesques et une vision de cinéma assez euphorisante comme il était peu commun de voir cela même en ces fin du 20ème et début du 21ème. Et c’était bien du Star Wars que Lucas nous proposait, avec une esthétique autre, certes, des moyens qui avaient évolué, un aspect plus sérieux, mais c’était bel et bien le même homme qui était derrière cette entreprise. Un homme qui ne voulait en tout cas certainement pas faire du surplace et resservir les mêmes plats indéfiniment. Une nostalgie réchauffée au micro-ondes, très peu pour lui. C’est pourtant ce que ses fans semblaient vouloir malgré tout. Du lyophilisé…
Walt Disney, en rachetant à George Lucas son bébé pour la modique somme de 4 milliards de dollars (ah tiens, encore ce chiffre 4…), n’allait pas se contenter de faire de Star Wars juste un objet pour quelque happy few ou d’anciens fans nostalgiques. Marvel ou bien encore Pixar, la compagnie tel un ogre jamais rassasié engloutit tout ce qui suscite le rêve et veut faire main basse sur ce qui représente la pop culture aujourd’hui. Et que nos rêves deviennent, se transforment, en billets verts. Amen !… En tout cas, la grosse firme à oreilles de Mickey a bien reçu et étudié le message des adorateurs de Star Wars, et le compte-rendu des financiers aux sorties des réunions était fort clair : donner à ce public ce qu’il attendait depuis 1983.
Star Wars, la vieille chimère de George Lucas, qui conçut cette saga sur un malentendu et qui crut longtemps que sa création était et serait le refuge pour tous ceux dont l’imaginaire n’avait pas de limite. Ce fût une erreur amère et Lucas dut ravaler ses ambitions quand il comprit en fait que ce public passé présent et futur ne voulait voir juste que toujours la même chose et qu’on leur resserve en boucle le même plat « à la façon de ». Les films, les dessins animés, les livres et les jeux vidéos, créés par des fans zélés ont rendu Star Wars universel. George Lucas finit par être chassé de sa propre création tant des esprits plus jeunes et plus alertes se sont vite emparés de l’œuvre pour y mettre à leur tour leurs propres névroses, leurs propres fantasmes. Aujourd’hui, après moult rebondissements et trahisons, L’œuvre perdure en échouant entre les mains d’une multinationale que l’on sait ne pas vraiment s’embarrasser d’état d’âme.
Cet épisode 7 sera donc décortiqué pièce par pièce et ce sont ses fans d’avant ou de maintenant qui combleront tout ce qui nous a échappé ou laissé dans l’expectative. Chaque film est devenu la petite pointe isolée d’un iceberg. Dessous se trouvent des quantités d’autres éléments qui rendent le tout cohérent.
Et ce nouveau film, alors ?
On a déjà tout entendu à son sujet. Un décalque de l’épisode 4, une refonte du mythe, un copié-collé de la première trilogie, etc… Ce qui est avant tout surtout une grossière erreur, c’est d’avoir fait abstraction de la Prélogie en se concentrant uniquement sur ce qui avait fait Star Wars entre 1977 et 1983. Oui mais c’est ce que les fans désiraient. Alors… Alors oui, tous ces fameux nostalgiques sont comblés en effet, tant on leur ressert la soupe qu’il avait adorée à grand renfort d’objets, de visuels et d’atmosphère proche des films originaux. Mais ce n’est pourtant pas à un bain de jouvence auquel on nous convie, mais plus à un musée poussiéreux ou un gardien nous ferait la visite en radotant. Il y a bien-sûr ce même plaisir de revoir des vieilles photos qu’on aurait scannées et qui se retrouvent non plus dans un album en dur mais dans un dossier archivé sur son ordinateur.
J.J. Abrams n’est pas un manchot pour autant et n’a rien à envier à George Lucas en terme de réalisation. Sauf que Lucas prônait un grand classicisme qui collait plutôt bien à la Saga, lui apportant élégance et majesté, abandonné ici au détriment de cadrages plus serrés et plus télévisuels. A un montage académique et des plans où l’on prend le temps de montrer ce qui s’y passe, une succession de plans rapides avec la peur d’ennuyer les nouvelles générations de spectateurs. Le film s’autorise également un peu trop facilement les citations et les hommages appuyés à d’autres films de guerre, au lieu de renouveler et continuer à créer de la pure mythologie Star Warienne comme Lucas le faisait. Ici on nous sert du « Il Faut Sauver Le Soldat Ryan » ou plus tard un plan tiré d’« Apocalypse Now »… Le film souffre donc de ce manque d’ampleur et on ne retrouve plus tout l’aspect iconographique qui faisait la marque de fabrique des précédents opus plus ou moins bons. Dans tous les épisodes de Star Wars passés, vous pouvez empiler le nombre de plans somptueux qui jalonnent les films. Ce 7ème épisode n’en possède que très peu. Les plus beaux plans se situent au début du film, lors de l’exposition du personnage de Rey, pilleuse d’épaves, lorsque s’enchainent avec une certaine grâce une succession de jolis plans qui apportent enfin le fameux frisson attendu, mais qui ne sera plus ressenti jusqu’à la fin du film.
Je n’avais pas encore parlé de musique… Pour toutes ces scènes introduisant cette future nouvelle héroïne, le thème composé par un John Williams essoufflé donne ici tout le crédit que l’on accorde à ce vieux compositeur qui n’a plus rien à nous prouver. Le thème s’inscrit immédiatement dans l’univers. C’est une gageure. Ce sera le seul. On cherche après désespérément une mélodie qui accroche, emblématique et qui puisse nous emporter. Mais ce ne sont que les airs que l’on reconnaît des thèmes de Leia, puis Han et Leia, ou encore celui de Luke et La Force, qui nous rappellent au bon souvenir que nous sommes bien en train d’assister à un nouvel épisode de Star Wars. Si la musique est à l’image de ce à quoi nous assistons, alors oui, John Williams n’est pas si vieux que ça et sait donc faire la différence entre du lard et du cochon. Où sont les envolées de cuivre d’« Un Nouvel Espoir », les Violons saccadés de la Marche Impériale de « L’Empire Contre Attaque », les chœurs sombres et puissants du combat entre Obiwan, Qui Gon Jinn et Darth Maul, le thème d’Anakin et Padmé, le thème de Yoda, Le duel entre Obiwan et Anakin sur la planète de lave, etc, etc, etc… Pour Star Wars VII, c’est une partition anémiée que nous propose là le compositeur d’E.T. et d’Indiana Jones.
Mais on apprécie aussi cet épisode VII pour ces nouveaux personnages joués par des acteurs convaincus et convaincants qui heureusement finissent par supplanter les anciens venus transmettre le témoin et qu’on espère voir disparaître dans le prochain épisode. De bons dialogues et une bonne énergie d’ensemble permettent de ne jamais se sentir mal à l’aise durant les scènes en général, même si elles s’avèrent tièdes ou téléphonées. On se souvient des moments douloureux entre Anakin et Padmé dans « L’Attaque Des Clones », lorsque les deux acteurs devaient réciter des phrases absolument ineptes (Anakin à Padmé : « Je n’aime pas le sable. Il pique et s’insinue partout », ou encore Mace Windu dans « La Revanche des Sith », lors du combat contre Palpatine : « C’est lui le traitre » puis réponse de Palpatine « Non, c’est lui »… Embarras.
Mais ne nous méprenons pas…
Si beaucoup considèrent La Prélogie comme un ratage ou une insulte de George Lucas proférée à son public chéri, sa première trilogie tellement acclamée est loin d’être une réussite non plus. Elle a juste l’avantage de contenir le meilleur film de toute la Saga, « L’Empire Contre Attaque », et n’ayons pas peur de le dire, meilleur film tout court de tous les temps. En revanche, « Un Nouvel Espoir » souffre d’un manque de rythme assez carabiné, avec toute sa première partie et cette succession de plans avec C3PO et R2D2 dans le désert qui n’en finissent pas de marcher. Quant à « Le Retour Du Jedi », c’est l’exemple éclatant du renoncement et du manque d’ambition pour clore avec panache cette trilogie, avec déjà ce goût du recyclage tous azimuts (retour de l’Etoile Noire comme innovation scénaristique majeure). Sans doute le pire épisode des sept films, où l’Empire se fait renverser grâce et à l’aide d’oursons pelucheux qui, contre des blasters, des armes puissantes, proposent des frondes, des lance pierres et des rondins de bois. Le film en tout cas est le moins audacieux des sept, avec des héros tous encore vivants à la fin, qui se congratulent autour d’un feu de camp, les doigts dans le nez, en dansant sur de la musique d’Ewoks. Là oui, peut-être, on pouvait parler de la part de Lucas d’un sacré super foutage de gueule. Alors qu’est-ce qu’un Jar Jar Binks à côté ? Juste un idiot du village, un simplet apportant la dose de légèreté pour un premier film qui affiche très vite des intentions scénaristiques moins fun que précédemment.
Chacun aime Star Wars, son Star Wars, avec à chaque fois des raisons différentes. « The Force Awakens » tente donc le pari de réconcilier tout le monde. Mais le pouvait-il vraiment ? Le film cartonne. C’est un immense succès à travers le monde. Oui car il correspond exactement aux attentes suscitées par le plus grand nombre. Resservir du Star Wars sans aucune prise de risque, attraper un public désireux de se replonger dans ce douillet lit où les rêves sont déjà définis pour vous, incrustés dans l’oreiller. Il faudra donc attendre 2017 pour se faire une opinion véritablement tranchée. Savoir si Walt Disney peut respecter malgré tout toutes les ambitions premières de George Lucas, ou bien juste s’en tenir à un rôle de sinistre industriel cynique et sans vergogne.
L’ironie de tout cela, que d’avoir comparé longtemps George Lucas à ce jeune réalisateur sans avenir devenu avec un pari fou un nabab se servant de Star Wars comme poule aux œufs d’or. Lucas qui ne voyait avec cette entreprise qu’un moyen d’inventer de nouvelles choses (T.H.X, Skylwalker Ranch, I.L.M, …) et d’être tourné vers l’avenir. Sa déconvenue de constater que Sa création ne servira plus désormais qu’à produire toujours et encore le même plat sans saveur, sans âme. Mais après tout on s’en fiche. Star Wars est en partie en nous. Qu’il soit réussi avec des histoires nouvelles ou jetables, avec les mêmes moules à madeleine, Star Wars c’est nous et cette petite lueur tout au loin que l’on voudrait toucher du doigt mais qui s’éloigne dès que l’on s’en approche. Un amour impossible…
[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Dévoreur Hubertouzot
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Hubert Touzot : Photographe dévoreur d’images