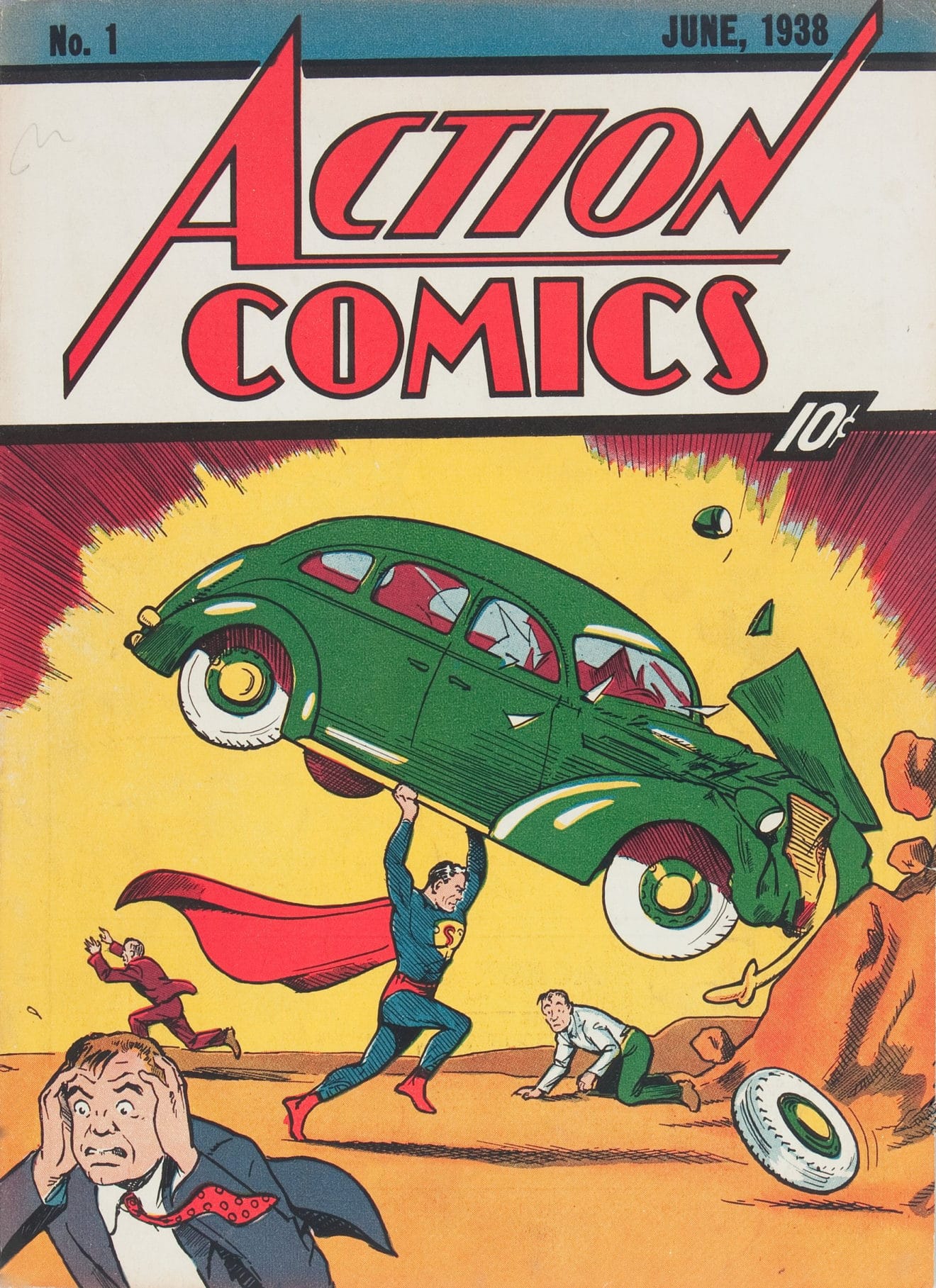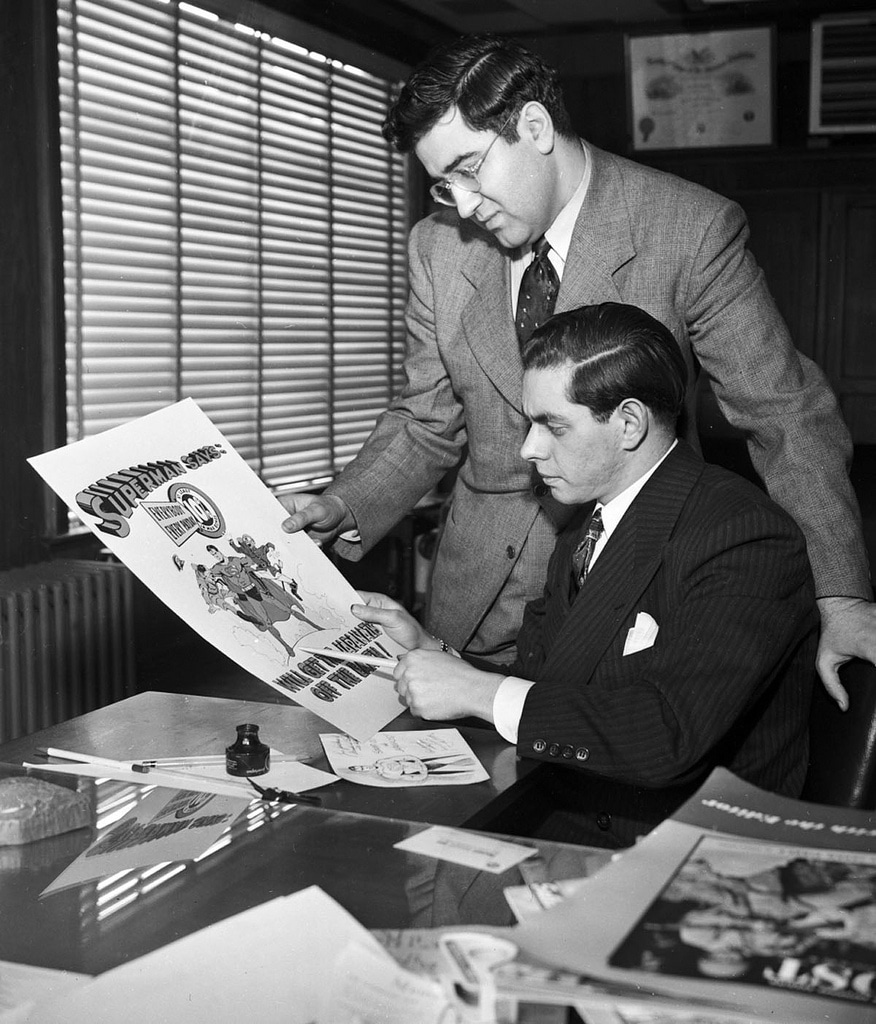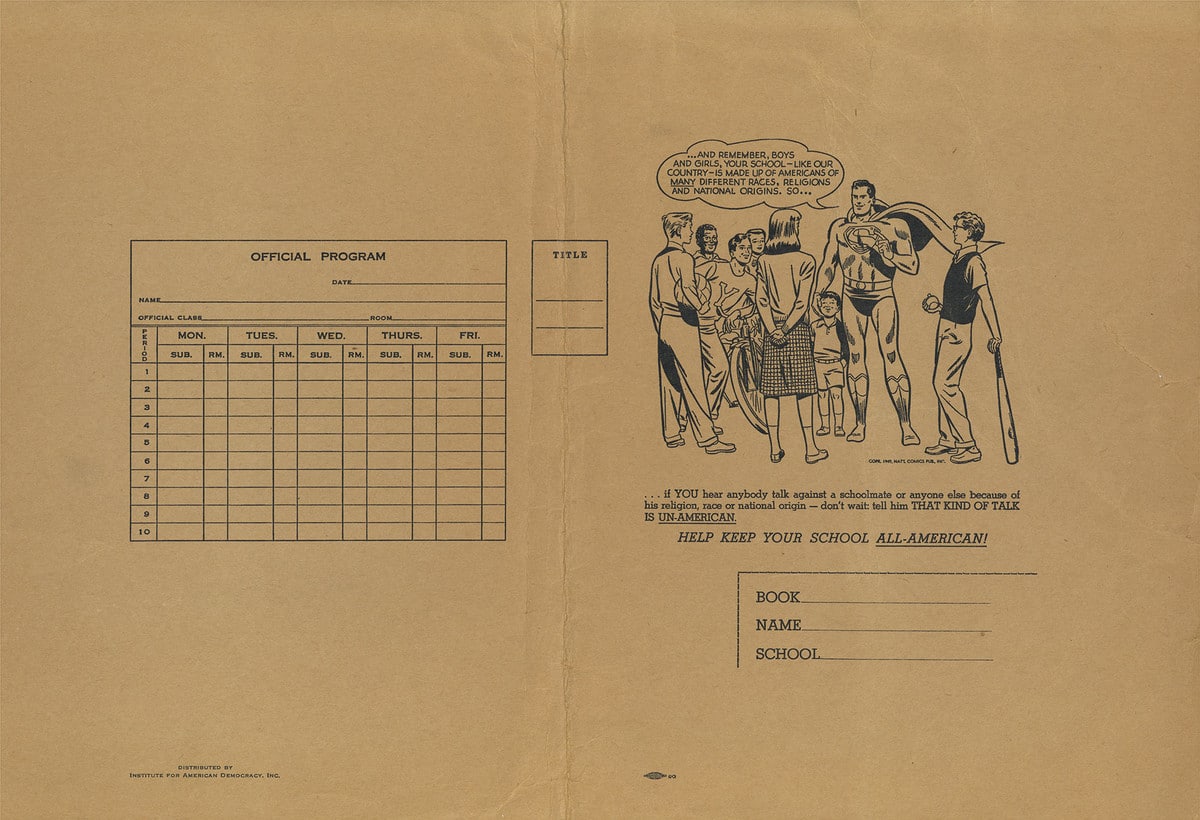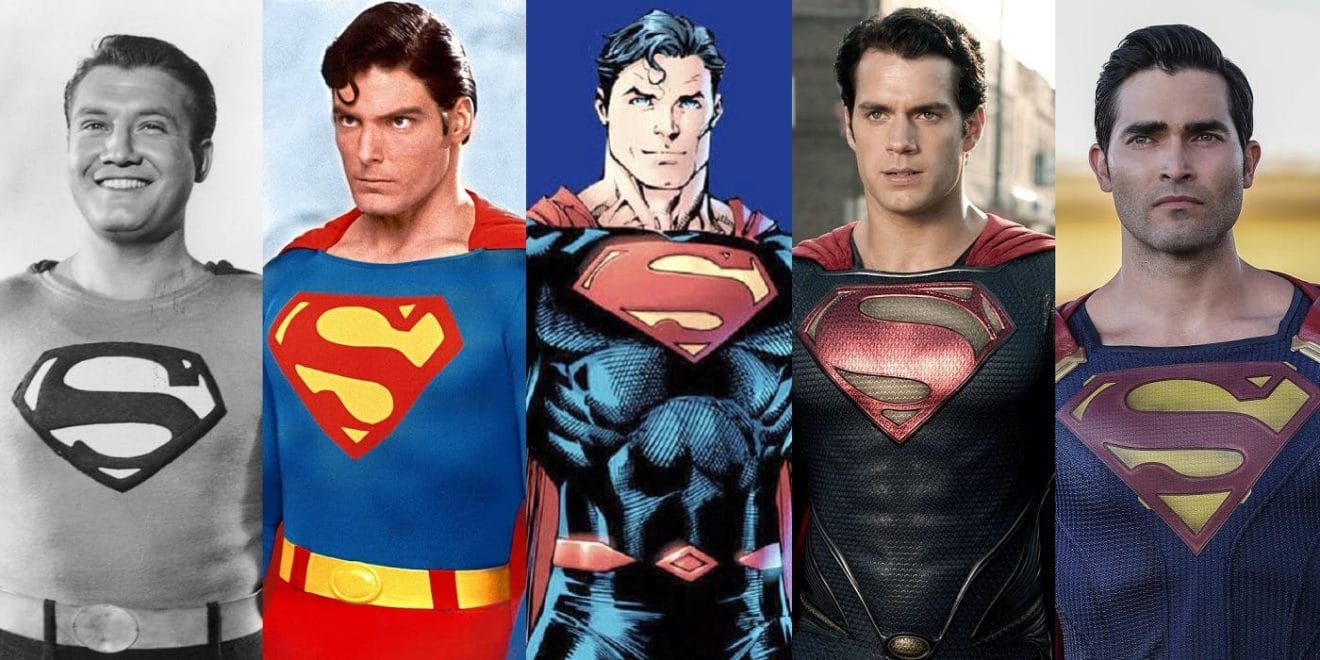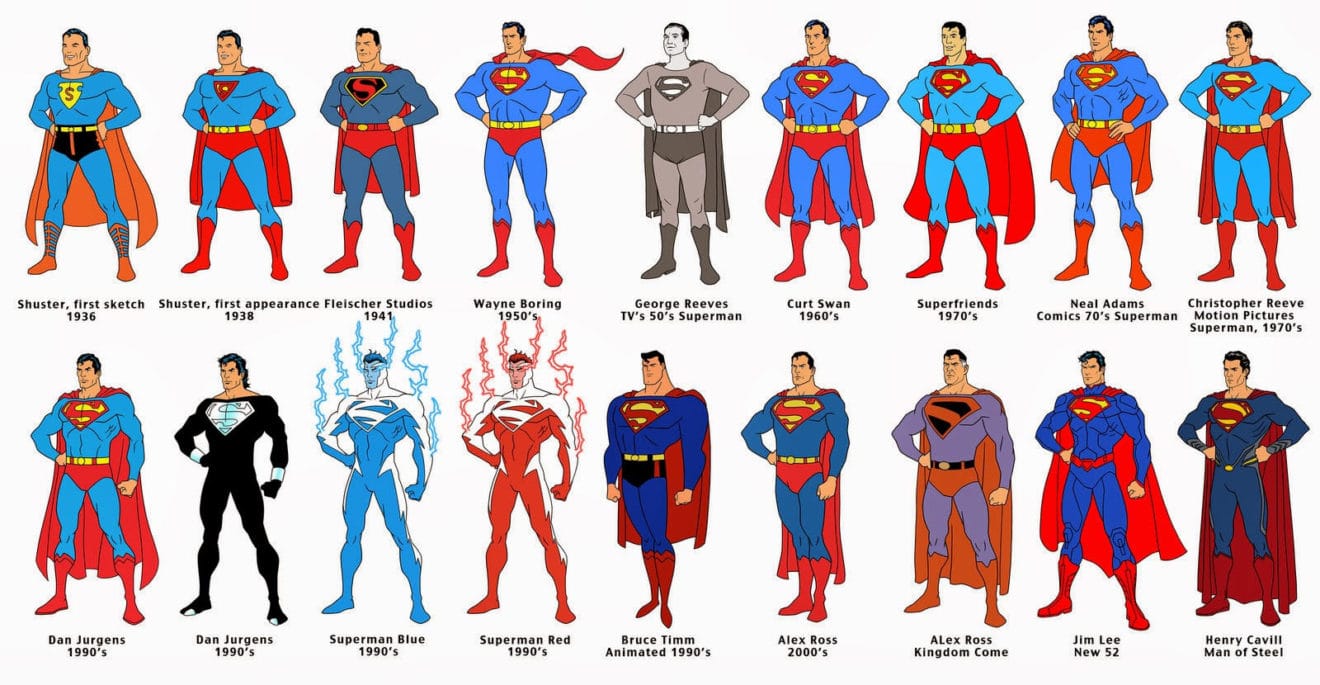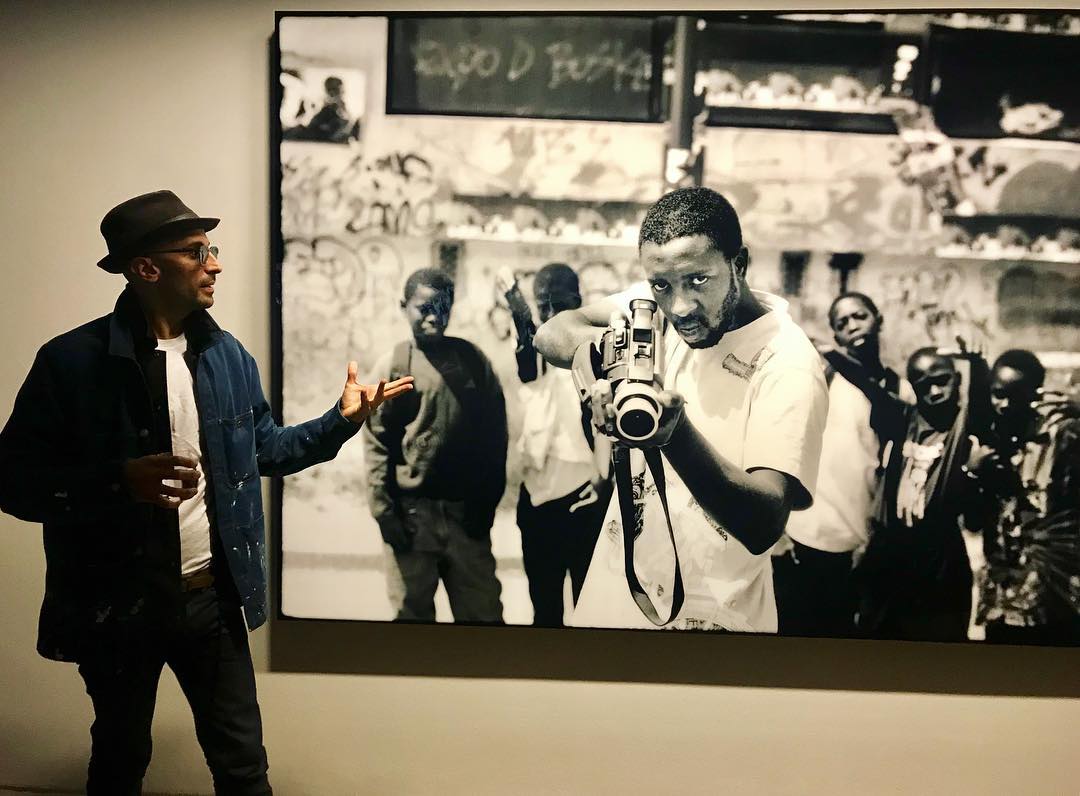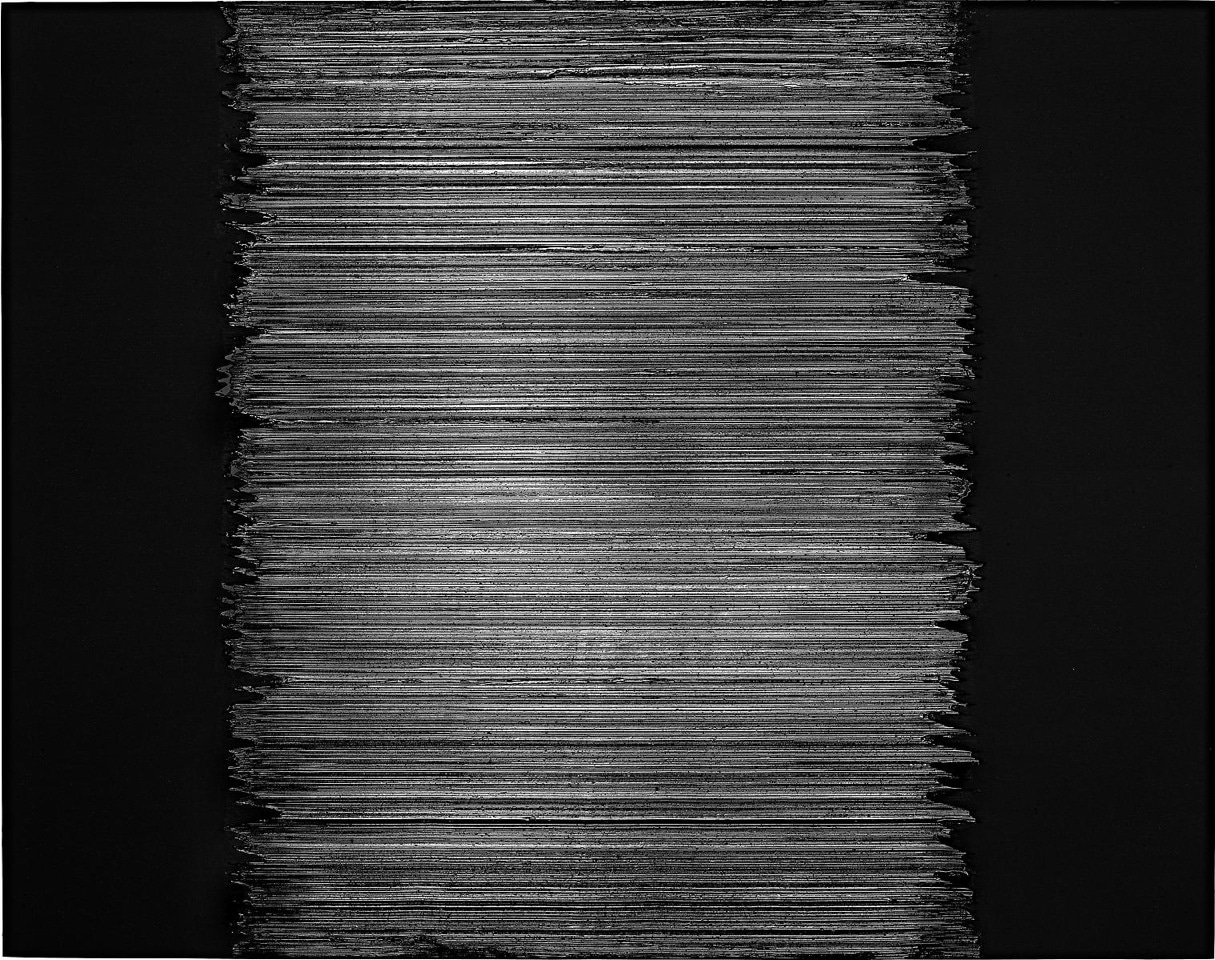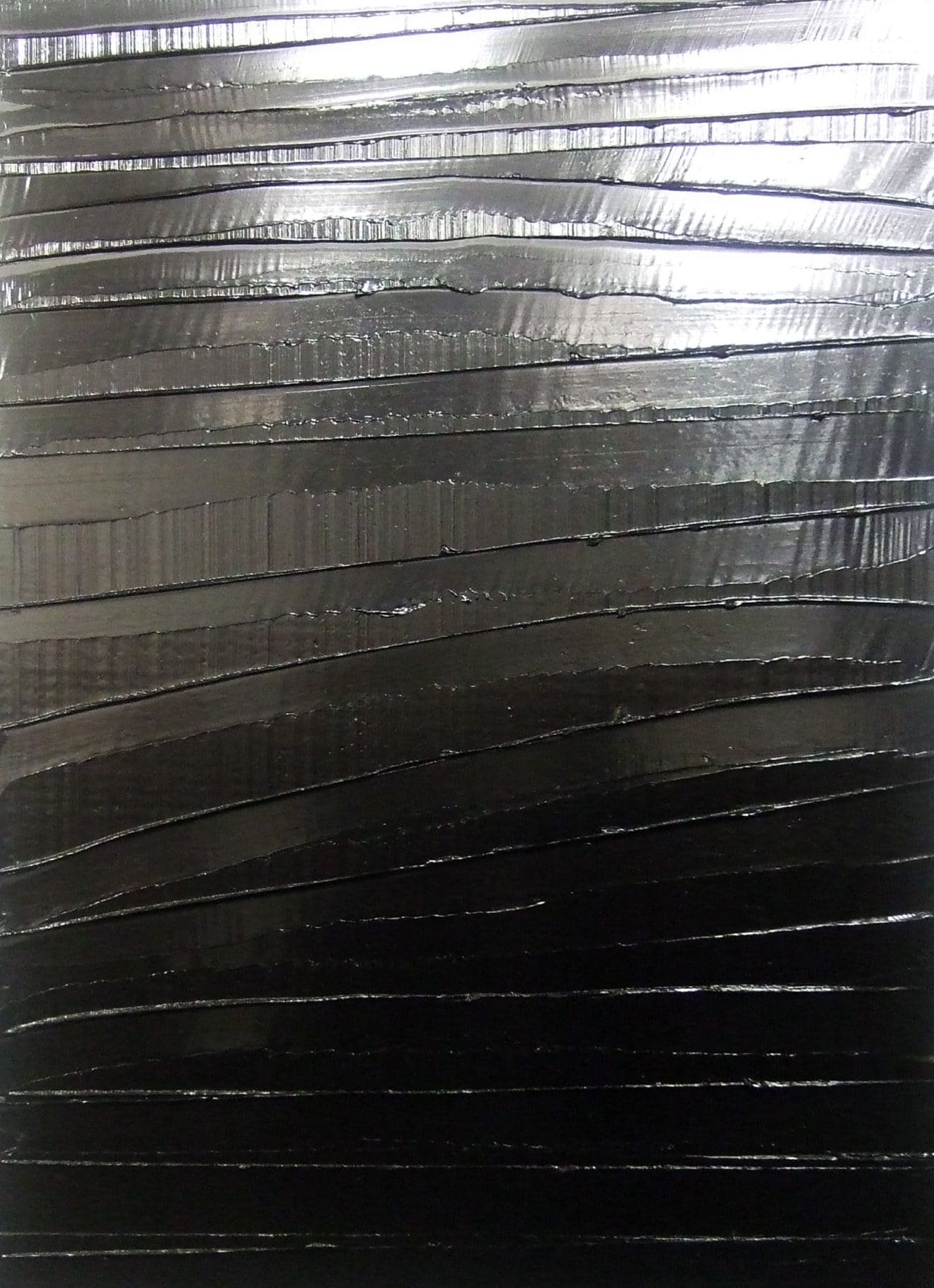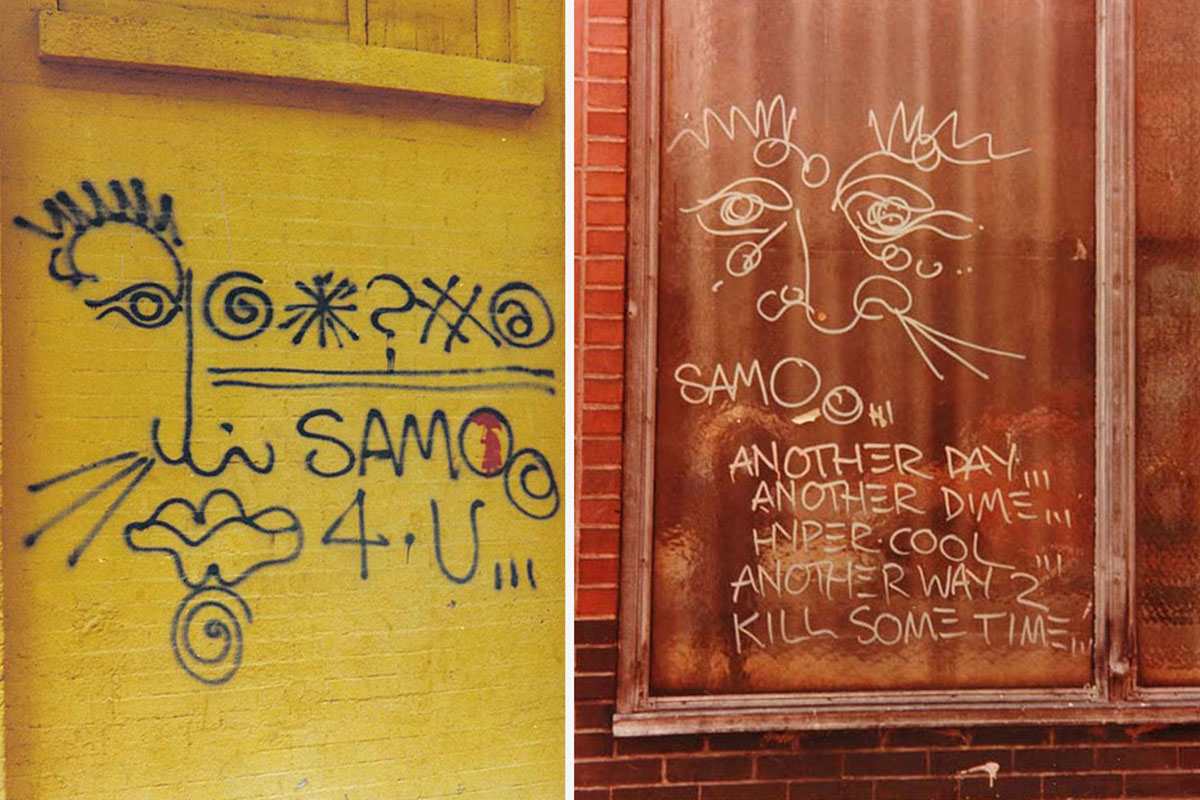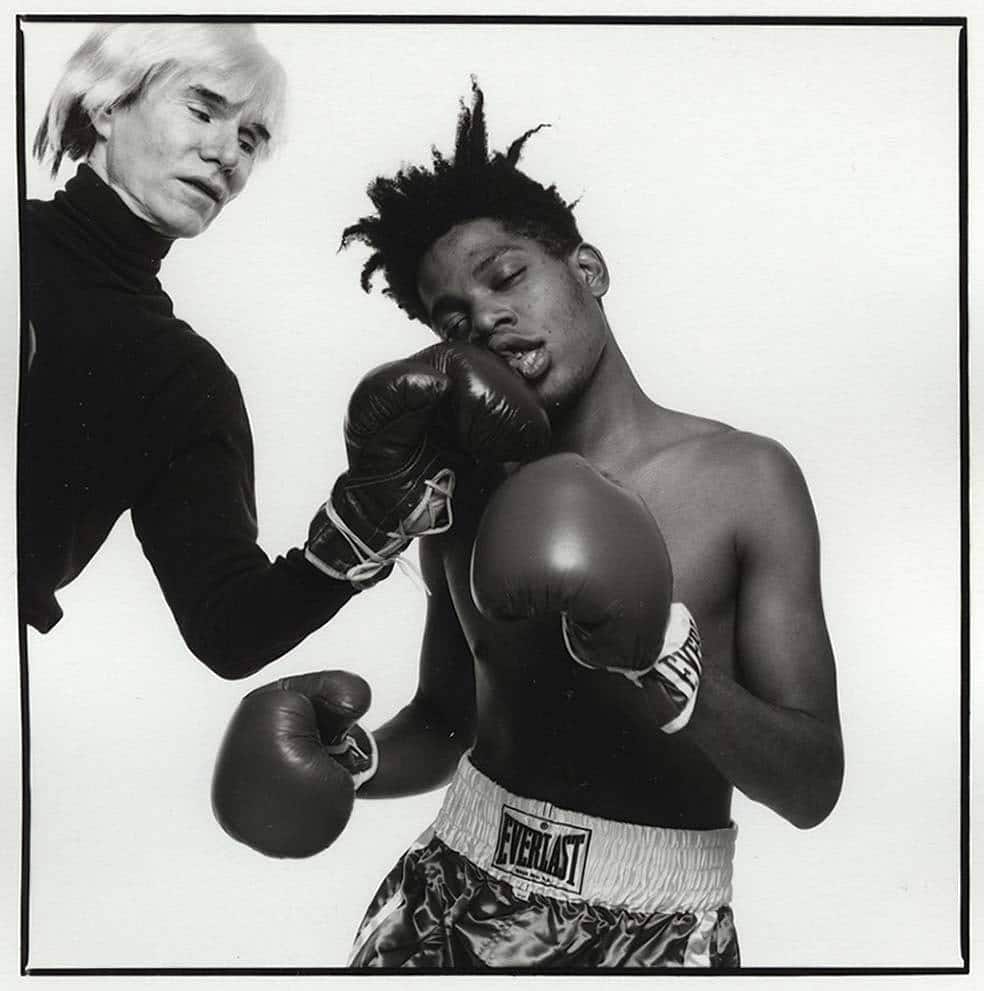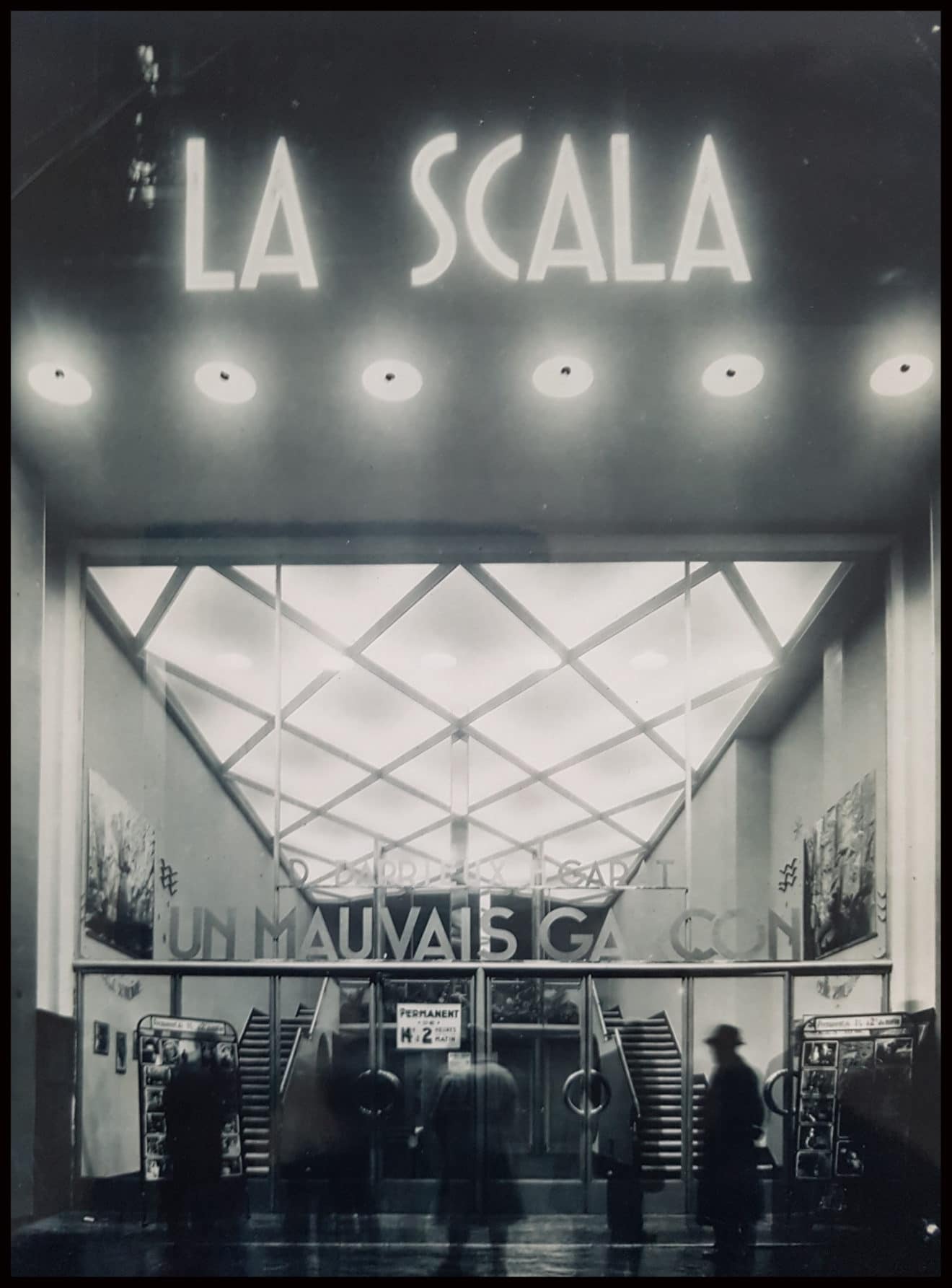Bob Marley fut un artiste engagé, et trente-sept ans après sa mort, le roi du reggae reste le représentant incontesté de la musique du tiers-monde, mais aussi le symbole de l’émancipation de ces métis jamaïcains socialement rejetés.
Mort très jeune, Bob Marley a eu le temps, toutefois, d’imposer en Occident cette musique au tempo lascif et ses tubes planétaires. L’album hommage titré « Tribute Bob Marley, la Légende » paraissait le 10 juin 2016.
Car il y a le reggae et il y a Bob Marley… Le rastaman superstar de la Jamaïque est décédé le 11 mai 1981. Trente-sept ans plus tard, son album « Legend » reste l’un des disques les plus vendus au monde.
Alors comment ce gamin de la misère, enfant illégitime, métis et socialement rejeté, a su gagner une audience planétaire ? Réponse avec le musicien et fan Tété et le journaliste Bruno Blum.
« Au départ, le jeune Robert Nesta Marley quitte sa campagne pour le ghetto de Trench Town. A Trench Town, il commence la musique en jouant avec Peter Tosh, car celui-ci est un des seuls mecs du ghetto qui possède une guitare. Ce sont les tout débuts, avec les Wailers. Bien avant qu’ils ne se renomment Bob Marley and The Wailers. A l’époque, ils commencent à jouer du rock-steady. » (Tété)
« Le premier album des Wailing Wailers, comme ils s’appellent au moment de la sortie du disque en 1965, c’est du pur ska. Sur cet album figure le titre « Rude Boy » qui sera un de leurs tout premiers hits. » (Bruno Blum)
[youtube id= »DQaIOZPkoH8″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Après plusieurs No 1 en Jamaïque, Marley, loin de rouler sur l’or, décide d’émigrer aux Etats-Unis en 1966.
« Marley fait Woodstock. Sauf qu’il ne participe pas au festival en tant que musicien, mais il va y vendre des petits colliers de perles pour se faire un peu d’argent. L’histoire de Marley, c’est la survie. En 1979, Marley sort son morceau « Survival« , et ça n’est pas surfait, pour la peine. La Jamaïque, il faut le rappeler, ça n’est pas du tout l’image qui figure sur les cartes postales. La Jamaïque est ultra-violente et le Jamaïcain n’est pas cool. A tel point que dans les bals du samedi soir, les mecs buvaient de la bière. Enormément de bière… Et quand vous avez une musique un petit peu électrique, et un tempo assez enlevé, les mecs finissaient par se battre. Le premier tube de Marley, c’est « Simmer Down » en 1964. Simmer Down, ça veut dire « Hé mec, reste cool ». Et en fait, il y a un mec qui a l’idée géniale de ralentir le tempo. Le reggae, c’est juste ça, du rock-steady dont on a ralenti le tempo. » (Tété)
[youtube id= »R91b5saK5z0″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
[youtube id= »hqfbJaYvbiw » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Le tournant international dans la carrière de Marley, c’est sa rencontre avec le producteur Chris Blackwell à Londres en 1973. Blackwell dit : « Moi, je la comprends, cette musique, mais les gens ne vont pas la comprendre, car le principe du reggae, c’est que les temps sont à l’envers. Nous, on a l’habitude, les 2, les 4, comme on dit. Avec le rythme one-drop, vous avez le charley qui fait tss tss tss tss, et sur le 3ème temps, vous avez la grosse caisse qui fait boum, et la caisse claire qui fait clac… »
Le coup de génie de Chris Blackwell, c’est de vendre Marley comme un artiste de rock, et non comme un artiste de reggae. On ajoute des solos de guitare, une image plus rock. Marley apparaît sur les photos avec ses musiciens, alors qu’en Jamaïque, les groupes de rock, ça n’existe pas. Plus qu’un simple pape du reggae, Bob Marley est surtout celui qui a occidentalisé le genre.
« Ce qui marche dans le monde à l’époque, c’est le disco. Marley veut partir à la conquête du monde. Et surtout, il veut être numéro 1 aux Etats-Unis. « Could You Be Loved », en 1980, c’est la version de Marley du beat disco. Si on se remet le morceau en tête, on y trouve le même charley que sur un track disco. » (TéTé)
La consécration pour Marley, c’est un concert enregistré à Londres en 1975, qui fera l’objet d’un album live, et sur lequel figure le morceau « No Woman No Cry ». Cette chanson, c’est l’histoire d’une femme qui a perdu son gamin, décédé dans une tuerie au milieu du ghetto, et Marley dit à cette femme qu’il ne faut pas pleurer, que tout ira bien. Ce message d’espoir devient l’hymne absolu de la musique reggae. Numéro 1 partout dans le monde, sauf aux US, on ne compte plus le nombre de reprises, des Fugees à Boney M, en passant même par Joe Dassin, avec « Si tu penses à moi »…
[youtube id= »mZ6VezKMoRY » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
« My right, I know what that is. You see ? And I don’t care who the guy is, because my right is my right »
Représentant du mouvement Rasta, Bob Marley devient aussi un symbole universel de contestation et d’émancipation. Avec des chansons comme autant d’hymnes aux opprimés, Marley a réussi avec sa musique de paysan illettré à conquérir la planète. Chez Marley, il y a le combat politique, d’émancipation, la lutte des classes, mais aussi son voeu pour le fameux « One Love », à savoir de réunir les gens au rythme de son universalité.
[youtube id= »e7eXCkdImsY » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
[youtube id= »J2pDMGHQxRA » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Bob Marley Official
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Bob Marley Biography