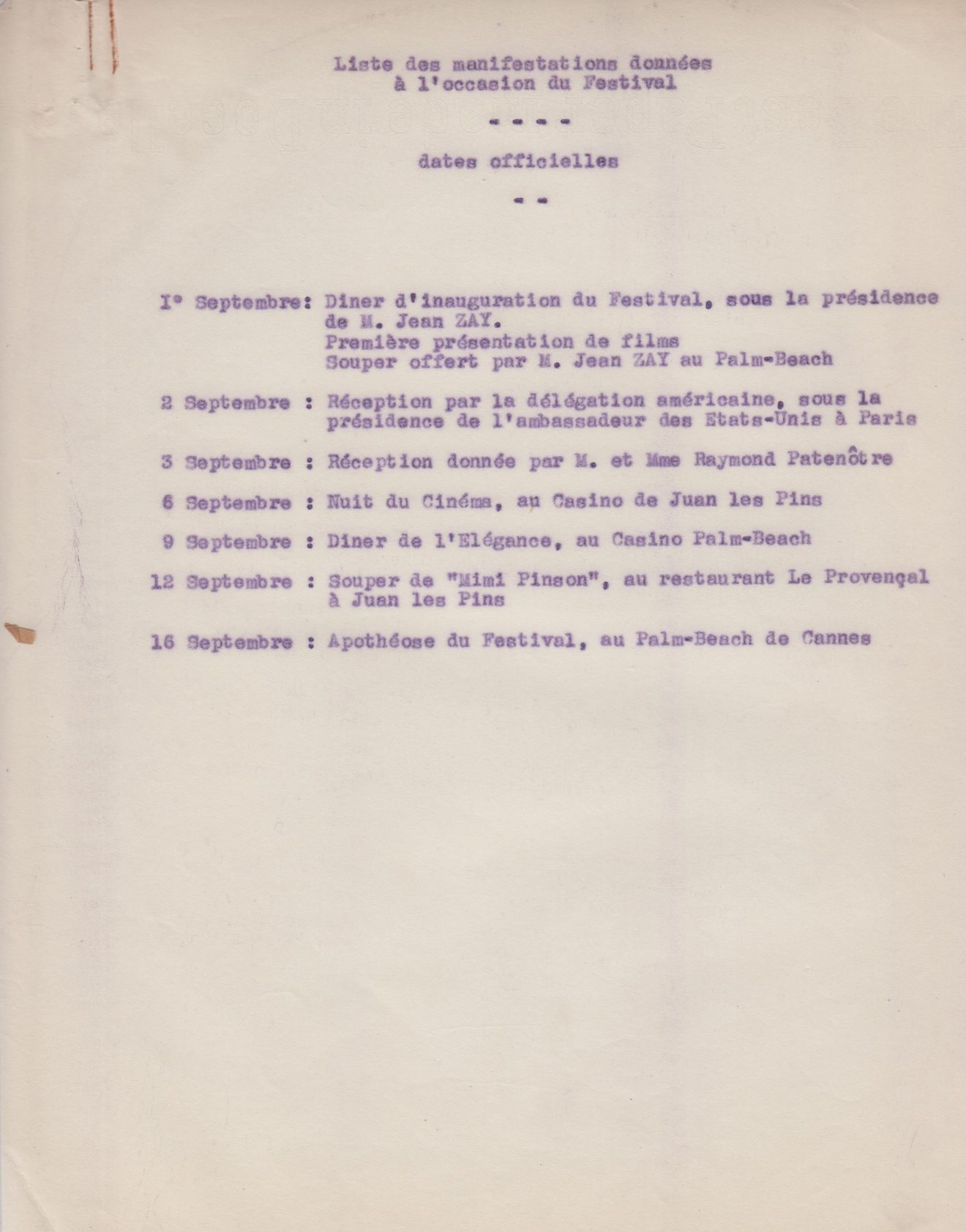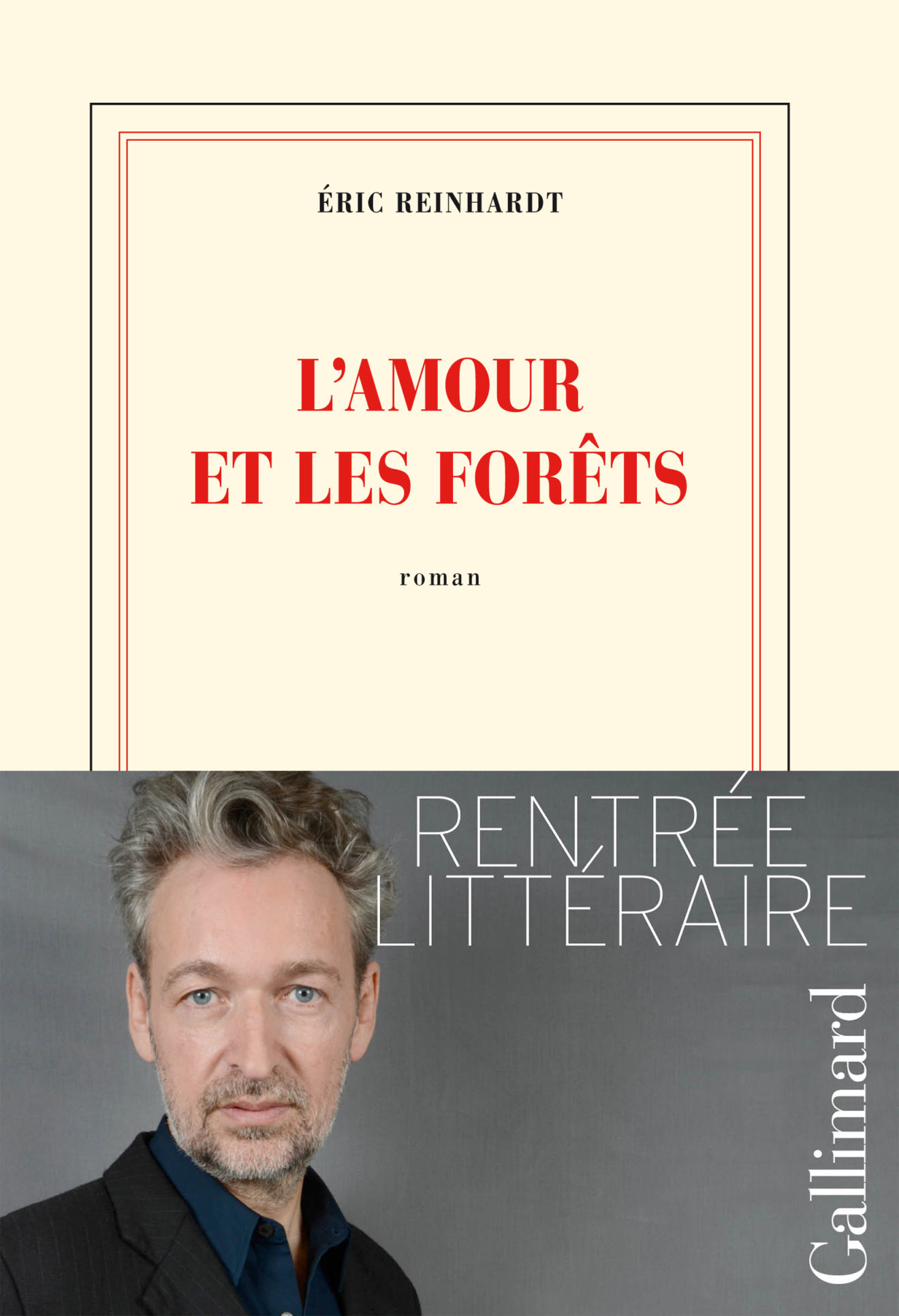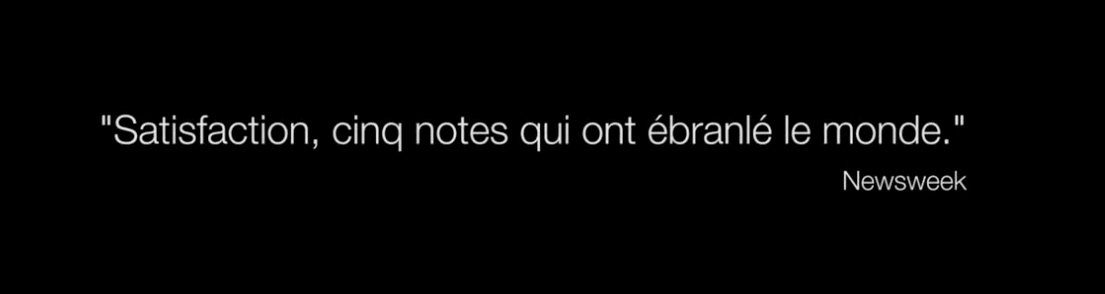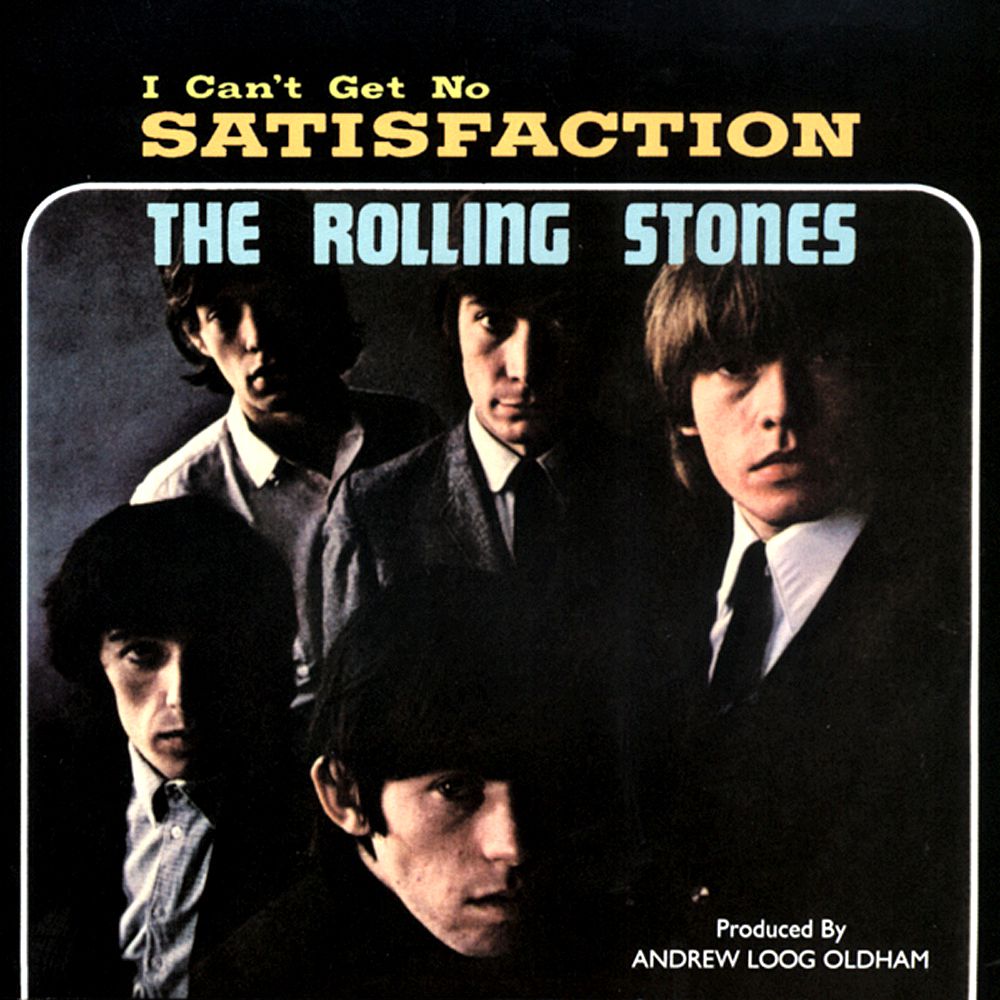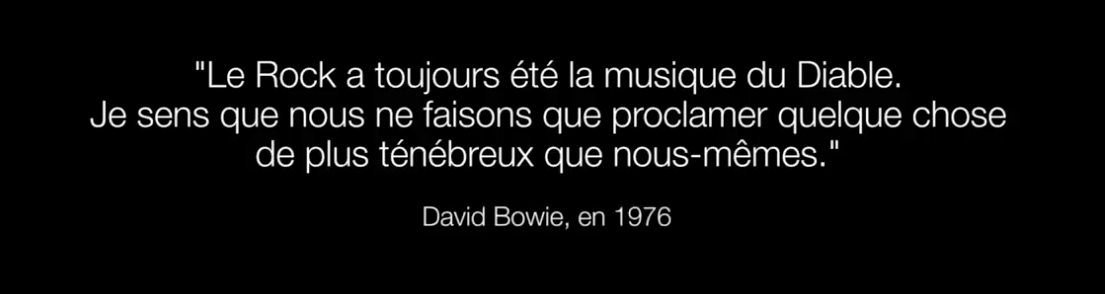Jerry Goldsmith pourrait être le pendant de cet autre grand compositeur et mélodiste qu’est John Williams, car lui aussi a tant œuvré pour le cinéma à Hollywood, en contribuant à rendre immortels de nombreux films, avec ses scores reconnaissables entre tous.
Mais si John Williams l’Américain a d’abord reçu une formation de jazzman, pour Jerry Goldsmith, c’est plutôt du côté du classique qu’il faut aller chercher technique et musicalité. Ses origines juives ashkénaze de Roumanie auront été infusées au fil du temps dans des influences profondément ancrées du côté de la musique d’Europe de l’est, qu’elle soit classique ou populaire et folklorique.
C’est donc ici que la comparaison avec son illustre homologue s’arrête, car si Williams, le compositeur de « Star Wars », a su avec brio rebondir de thèmes emblématiques en envolées légendaires, il est toujours resté confortablement calé entre jazz et orchestration néo-classique, hormis peut-être pour deux ou trois scores surfant parfois sur le sériel et la dissonance (« Rencontres du Troisième Type », « Images » ou même « La Guerre Des Mondes »).
Quand Jerry Goldsmith fut capable tout au long de sa très longue carrière de se réinventer sans cesse… Le compositeur à la queue de cheval a exploré et expérimenté, en utilisant pour étoffer ses œuvres à peu près tout ce qui pouvait émettre un son ; de l’électronique, dont il fut l’un des précurseurs au cinéma (« The Illustrated Man » en 1969 ou « Logan Run » en 1976), au bol de cuisine, en passant par un sifflet d’enfant ou encore des croassements de corbeaux (« Damien : La Malédiction 2 »)
[youtube id= »xcG6Wd5bKXY » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Avec les musiques de « Patton », « Gremlins », « Papillon », « Basic Instinct », « Star Trek », « Chinatown », « Alien », « Rambo », « Poltergeist », « Legend » ou « Le 13ème Guerrier », Goldsmith impose sa patte. Autant de genres et de styles différents pour un compositeur hautement prolifique…
Arrêtons-nous un moment sur une de ses œuvres en particulier, « La Planète des Singes » de Franklin J. Schaffner sortie en 1968. Sûrement son score le plus fou, le plus ambitieux et le plus mémorable. C’est là où réside toute la versatilité de Jerry Goldsmith qui compose un an plus tôt, en 1967, pour le film « In Like Flint » avec James Coburn, une pop Jazzy et désinvolte, avant de faire un grand écart absolu l’année suivante avec la musique de « The Planet Of The Apes »…
Jamais percussions furieuses, maelström de cuivres et de sonorités inquiétantes, brutes, n’auront aussi bien collé à des images. Plus que la simple illustration sonore du film, la musique de « La Planète des Singes » constitue une œuvre singulière et puissante, digne de Stravinsky, Ligeti ou Bartok. Si le film de Schaffner est une réussite totale et un véritable ovni dans le paysage cinématographique de l’époque, c’est sans conteste grâce à Jerry Goldsmith qui signe le plus génial des scores du 7ème Art.
[youtube id= »EPoPewWdM24″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Mais Jerry Goldsmith, ce furent aussi souvent des musiques magnifiques composées pour des films pas forcément tous bons…
La trilogie de « La Malédiction » avec le fameux Damien, l’Antéchrist, en est le parfait exemple. Car ce ne sont pas forcément des chefs d’œuvre impérissables. Et ces succédanés s’inscrivent plutôt dans la vague opportuniste des films de l’époque qui ont surfé sur le carton mondial de « L’Exorciste ». Il n’en reste pas moins que même si les trois films sont moyens, ce que Jerry Goldsmith a composé pour les habiller nous fait véritablement tomber à la renverse.
Si vous écoutez les trois scores dans l’ordre chronologique, vous vous apercevrez qu’ils recèlent en eux une logique musicale propre, qui rappelle à certains égards de grandes œuvres classiques, comme dans une symphonie, lorsque l’orchestre se déploie petit à petit pour finir par exploser, alliant la puissance des choeurs au gigantisme du son. Le célèbre thème principal « Avé Satani », scandé par ces chœurs lugubres, en dit long sur la ferveur et le premier degré qui habitaient le compositeur de « Outland ».
En évoquant le grand Jerry Goldsmith, ce que l’on gardera en mémoire, au-delà de ses compositions mythiques, c’est évidemment cette faculté à sans cesse se renouveler, cette puissance musicale inimitable (« La Momie », « Total Recall », « Capricorn One »), ses inventions (« Logan Run », « The Illustrated Man »), ses fulgurances pour le Space Opera (« Star Trek », « The Last Starfighter », « Explorers ») et un souffle romanesque inégalable (« Chinatown », « L.A. Confidential », « Medecine Man »).
En substance, l’infatigable inspiration d’un génie discret, artisan magique tant au service des films que des oreilles mélomanes… Et au vue des œuvres composées et de cette facilité à réinventer les poncifs, tout en les sublimant, Goldsmith volait décidément bien au-dessus de la mêlée.
[youtube id= »_B5a-lsMwSI » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]