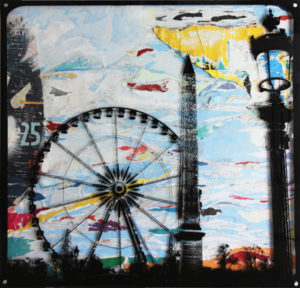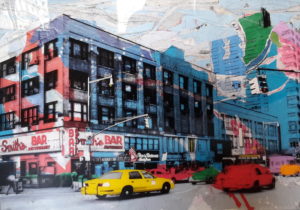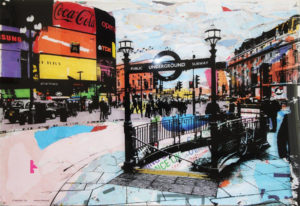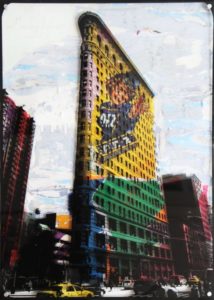Cette enfance… Pour toutes celles et ceux qui ont grandi, biberonnés à Pierre Tchernia, Jacques Rouland et leurs émissions « Monsieur Cinéma » puis « Mardi Cinéma », « La Séquence du Spectateur » ou « Le Film du Dimanche Soir », dont le jingle en préambule, composé justement par Cosma, déroulait une musique aux accents disco et tonitruants, avec ces étoiles qui semblaient traverser la lucarne du téléviseur et annonçaient une super soirée en perspective… Cette enfance avait ce parfum doux et sucré qu’ont les desserts et la crème fouettée.
Car ces émissions constituaient des rendez-vous incontournables, en mettant à l’affiche tous ces films populaires et grand public sortis à cette époque bénie. Tout au plus une quinzaine d’années, comme une parenthèse enchantée, durant laquelle Jean-Paul Belmondo, Pierre Richard et Louis de Funès tenaient invariablement le haut du pavé. Chacune de leurs apparitions au cinéma, puis à la télévision, attirait ainsi les foules dans les salles ou devant leur poste. Des noms qui devenaient magiques, à leur seule évocation par les speakerines ou Michel Drucker…
« Les Aventures de Rabbi Jacob », « L’Aile ou la Cuisse », « L’Animal », « Le Distrait »… On se souvient de tous ces films, qu’ils eussent été bons ou médiocres, déjà pour leur générique ; une musique, un ton, ces mélodies accrocheuses dès la première écoute, et souvent le même nom derrière toutes ces compositions : Vladimir Cosma. Avec ces films, c’était toujours la promesse d’une fête, d’une irrésistible joie conférée, un moment où notre rire devenait un antidote.
[youtube id= »4Yw9apKUNWY » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Vladimir Cosma, violoniste d’origine roumaine, issu de surcroît d’une grande famille de musiciens, aurait pu se contenter d’exercer une activité plus prestigieuse et surtout moins hasardeuse… Il avait en effet entamé sa carrière comme compositeur-musicien, avec déjà à son actif un certain nombre de contributions tant au classique qu’au jazz. Mais en 1968, Yves Robert le sollicite pour composer la musique de son nouveau film, « Alexandre le Bienheureux », d’abord proposée à Michel Legrand, que celui-ci décline finalement, trop accaparé par moult autres projets ; Michel Legrand, qui jouissait déjà à l’époque du même prestige que des Georges Delerue ou Antoine Duhamel…
Pour Vladimir Cosma, il s’agit bien à ce moment précis de prouver beaucoup, au risque de tout perdre. Ce qui frappe, à la première écoute du score de ce film avec Philippe Noiret et Marlène Jobert, c’est que Cosma s’inspire assez des musiques de Michel Legrand et du chemin créatif que ce dernier aurait probablement emprunté pour illustrer les images du film. Le ton romanesque, positif et clair de la musique de cet « Alexandre le Bienheureux » rappelle en effet immédiatement d’autres partitions du compositeur d’« Un Été 42 », « Les Mariés de l’An II » ou « La Vie de Château ».
Mais lorsque Michel Legrand puise souvent dans le jazz et s’avère toujours plutôt audacieux dans ses créations, Vladimir Cosma préfère quant à lui miser, dans le cadre de cette première expérience pour le cinéma, sur un certain classicisme, avec des tonalités vives, simples et fraîches comme le cour d’un ruisseau.
[youtube id= »FWKcFjNDDRI » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
« Alexandre le Bienheureux » marque en tout cas le début d’une collaboration fructueuse entre Cosma et Yves Robert, qui durera autant qu’ils s’apprécieront. « Clérambard », « Le Grand Blond avec une Chaussure Noire », « Salut l’Artiste », « Un éléphant ça trompe énormément », « Nous irons tous au paradis », « Courage, Fuyons », « Le Bal des Casse-pieds », « La Gloire de mon Père », « Le Château de ma Mère », autant de films qui scelleront l’amitié entre les deux compères. Mais « Alexandre le Bienheureux » marque surtout, pour celui qui commença par écrire des partitions pour Chet Baker ou Marie Laforêt, des débuts prometteurs dans la composition de musique de films, avec plus de 300 œuvres au compteur cinquante ans plus tard.
Longtemps cantonné au simple rôle d’aimable illustrateur de comédies familiales sans réel relief, Vladimir Cosma, qui deviendra également le compositeur attitré de Francis Veber (« Le Jouet », « La Chèvre », « Les Compères », « Les Fugitifs », « Le Dîner de Con »…), a pourtant excellé dans bien d’autres registres que celui de la seule comédie. Car nous avons vite oublié ou sommes simplement passés à côté de bon nombre d’œuvres aussi différentes les unes que les autres. Mieux prêter l’oreille, c’est alors se rendre compte de la grande diversité dont il a pu faire preuve tout au long de sa carrière, mais aussi de cette propension à toujours se réinventer.
[youtube id= »hZCdWDNsnCA » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Pour s’en convaincre, dès 1973, avec le film « L’Affaire Crazy Capo » (avec Maurice Ronet et Jean-Pierre Marielle), Vladimir Cosma compose la musique d’un polar fiévreux, d’une telle qualité intrinsèque que son intérêt dépasse de loin celui du film même. Au premier abord, en ignorant qu’il en est l’auteur, on pensera plutôt à Ennio Morricone, voire même à John Barry. C’est pour dire si l’aisance naturelle de Cosma s’affiche éhontément sur ce film, avec une orchestration ample que l’on retrouvera dans bien d’autres musiques de films qu’il composera, comme pour « Le Jaguar » de Francis Veber. Là encore, son travail sur l’écriture ou sur la direction d’orchestre supporte aisément la comparaison avec ses illustres confrères.
[youtube id= »bXwOWgB3fx8″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Si Vladimir Cosma enchaîne dans les années 70 et 80 tous les grands succès publics du cinéma français, avec des mélodies plus ou moins inoubliables et des collaborations à répétition avec Edouard Molinaro, Pascal Thomas et surtout Claude Zidi, il ne faut cependant pas occulter les musiques qu’il compose également pour la télévision (génériques de feuilletons, téléfilms et émissions).
Dès 1969, le compositeur rentre ainsi dans le cercle très fermé des compositeurs de musiques de films à succès. Et c’est d’ailleurs lui qui ouvre les portes d’un nouvel univers avec l’avènement des années 70. Il va y régner de manière quasi monopolistique. Un règne sans partage… Sa musique deviendra un genre en soi, immédiatement reconnaissable.
En 2010, François Ozon (réalisateur français entre autres de « Huit Femmes », « Sous le Sable », « Grâce à Dieu »…) n’hésite pas à demander à son compositeur Philippe Rombi de lui écrire pour les besoins de son nouveau film « Potiche » une musique et des arrangements que Vladimir Cosma aurait très bien pu composer lui-même à l’époque où se situe l’histoire du film. Dès le générique, lorsqu’on aperçoit Catherine Deneuve faire son footing dans une forêt et que retentissent les premiers accords de la mélodie, avec le sifflement, on est persuadé qu’il s’agit d’un emprunt, extrait tel quel d’un film que Vladimir Cosma aurait illustré musicalement.
[youtube id= »b_Zw3dK65m4″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Vladimir Cosma a bel et bien créé un courant musical spécifique qui s’impose tout au long de ces années 70 ainsi que sur une partie des années 80, comme ce fut déjà le cas dans les années 60 avec Raymond Lefèvre ou Gérard Calvi, compositeurs des musiques de certains des plus gros succès de la décennie, entre « Les Grandes Vacances », « Le Gendarme de Saint-Tropez » ou « Le Petit Baigneur » ; que des comédies populaires avec à l’affiche l’indéboulonnable Louis de Funès. Sauf que pour tous ces films, ils sont en fait plusieurs à se partager le gâteau : Lefèvre, Calvi, évidemment, mais encore Jean-Michel Defaye, Georges Delerue (« Le Corniaud ») ou Alain Goraguer.
Vladimir Cosma, quant à lui, ne partagera pratiquement rien. Sa filmographie est hallucinante, lorsque l’on se met à égrener la liste de tous les réalisateurs qui ont loué ses services pour un ou plusieurs films, toutes générations confondues. On peut ainsi citer Gérard Oury, Ettore Scola, Jean-Jacques Beinex, Yves Boisset, Claude Pinoteau et Jean-Pierre Mocky, avec qui il travaillera sur la quasi totalité de tous ses derniers films, et ce depuis les années 90. A noter que ce sont à chaque fois des univers et des films différents.
On peut s’arrêter un instant sur le diptyque d’Yves Robert, constitué des deux adaptions consécutives de livres de Marcel Pagnol. Pour ces deux films, Cosma convoque toute l’entièreté de son talent et de son imagination, dans le but de concevoir une œuvre symphonique qui existe en tant que telle. Sa musique y regorge ici de prouesses et d’envolées d’une très grande richesse mélodique. Les thèmes au piano y sont magnifiques. Pour le deuxième film, l’accent est d’ailleurs encore davantage porté sur la mélancolie. Le thème principal avec en fond le son des cigales est un pur bonheur musical. C’est sans nul doute l’œuvre de Vladimir Cosma la plus accomplie.
[youtube id= »830jEZuvrxI » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
À propos de mélancolie… Si on prend le temps d’écouter (ou de réécouter…) ces musiques, qui pour la plupart d’entre elles ont marqué notre enfance, telles des bornes, des repaires jalonnant une époque où tout nous semblait forcément plus léger et primesautier, nous ressentirons alors une impression diffuse, qui semblait nous avoir échappé de prime abord dans ces temps doucereux.
Je vous parle de cette mélancolie sourde… Car même sous des dehors rutilants et enlevés, très souvent, les mélodies du compositeur du « Père Noël est une ordure » sont conçues comme des mini-symphonies ou de petits concertos, avec un premier mouvement enjoué (allegretto) puis une seconde partie plus nuancée (adagietto), adoucie, durant laquelle on ressent comme un léger pincement. C’est là toute la force et surtout la longévité que l’on accorde aux créations de ce compositeur, forcément empreint de culture slave.
À l’instar d’un Morricone, d’un Barry ou des autres grands compositeurs français (François de Roubaix, Michel Magne, Georges Delerue…) ayant reçu tous les lauriers car leur musique était jugée plus ambitieuse ou bénéficiant d’une plus grande exposition à l’international, Vladimir Cosma n’a pourtant pas démérité, dans ses perpétuelles recherches et remises en question.
Certes, beaucoup de ses musiques garderont toujours ce parfum suranné et un peu toc, surtout lié aux films qu’elles illustraient, mais il n’empêche que Vladimir Cosma est rentré dans notre ADN comme un composant chimiquement pur, qui nous a préservés d’une certaine arrogance, d’un certain instinct de supériorité, soucieux de sentiments à transmettre et du travail toujours bien fait.