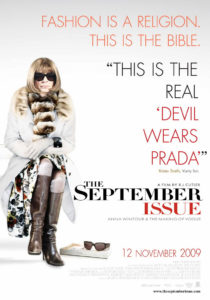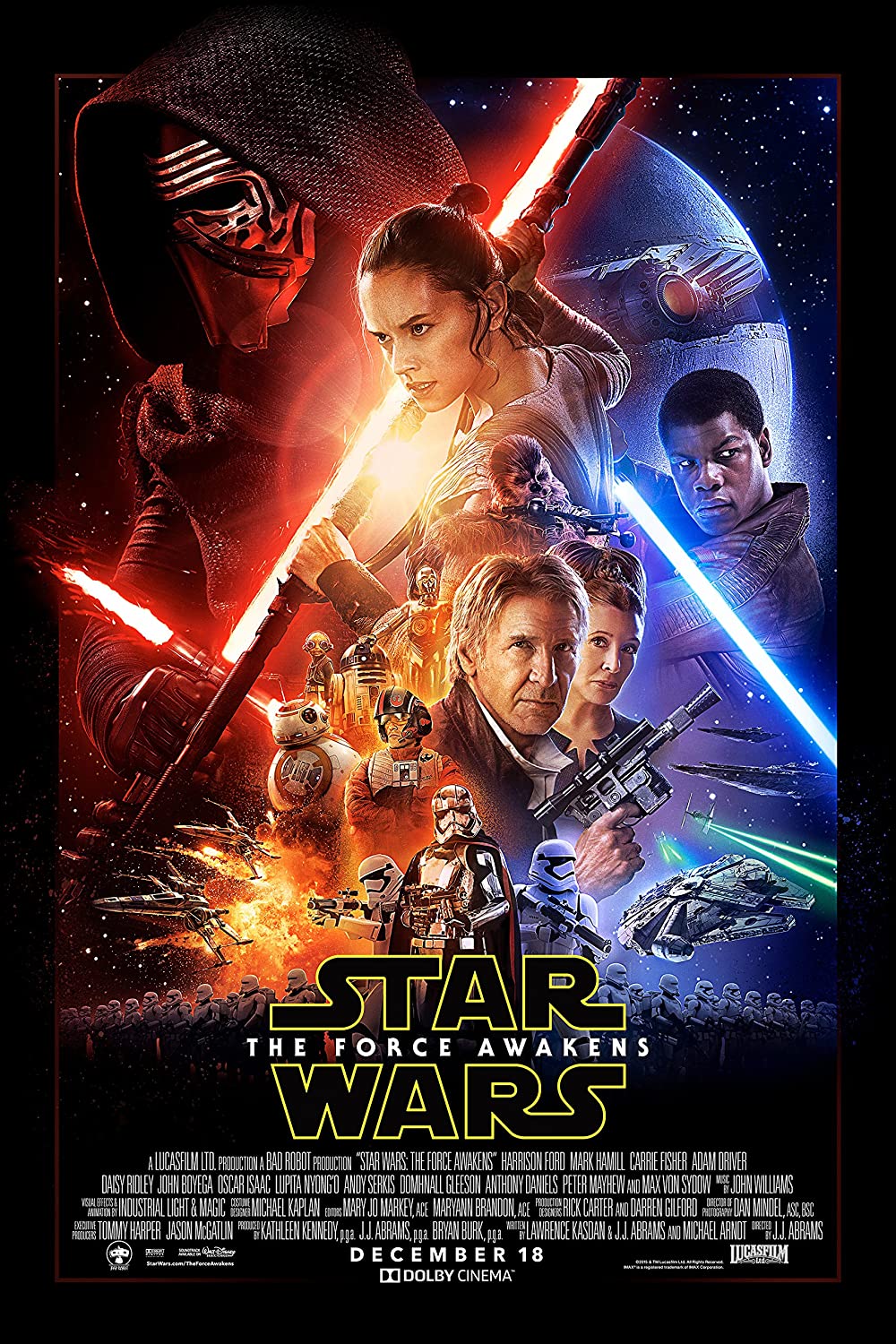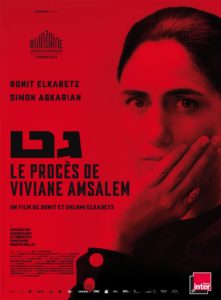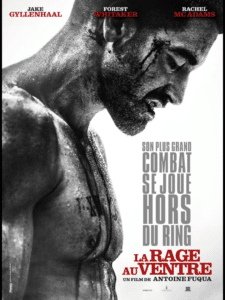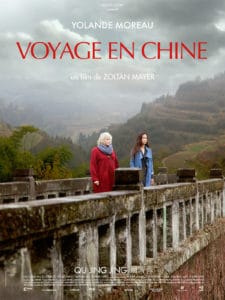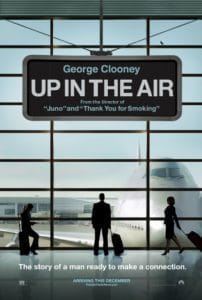La Haine : Chronique d’une bavure ordinaire
Réalisé en 1995 par Mathieu Kassovitz, son 2ème film après « Métisse » en 1993.
Avec Vincent Cassel, Saïd Taghmaoui, Hubert Koundé.
LA VRAIE FAUSSE INTERVIEW
Cité des Muguets à Chanteloup-les-vignes dans le 78 un lendemain d’émeutes. Un jeune de 16 ans, Abdel Ichaha, se retrouve entre la vie et la mort suite à une garde à vue un peu trop musclée. La bavure policière d’un inspecteur du commissariat va pousser les jeunes du quartiers, aveuglés par la haine, à crier vengeance. Parmi eux, Hubert, Saïd et Vinz traînent leur ennui de cave en cave. Le film est inspiré d’une histoire vraie, celle de Makomé M’Bowolé, zaïrois de 17 ans tué d’une balle dans la tête par un policier lors de sa garde-à-vue dans le 18ème arrondissement de Paris en 1993.
Mathieu Kassovitz : « Je me suis demandé comment le flic a pu en arriver à une telle haine pour lui tirer une balle dans la tête alors qu’il ne pouvait rien faire, c’est évident. Le policier n’a certainement pas voulu tirer mais il lui a fait peur, il a mis le flingue, il a armé le chien et je me suis demandé comment le môme a pu le mettre dans une telle situation de haine. Il y a une telle haine dans les deux camps qu’il faut au moins poser la question. Des armes, les flics en ont, et dans les cités, ils en ont aussi, mais pour l’instant, les plus sages, ce sont les mecs des cités parce qu’ils ne s’en servent pas encore ».
Tourné en noir et blanc, le film se déroule sur une seule journée, une journée particulière, effroyable, qui va inexorablement mener au drame, comme dans le film de Ryan Coogler « Fruitvale Station » en 2013. L’objectif du réalisateur est de comprendre « comment en est-on arrivé là ? » et quel est le mécanisme qui amène les personnages à commettre de tels actes extrêmes et irréversibles ?
Mathieu Kassovitz : « Le but était de raconter de manière générale quelle était l’ambiance des quartiers à l’époque et qui étaient ces jeunes-là. Je voulais comprendre ce qui, dans leur haine, était juste, quelle était leur revendication et comment ils vivaient le truc de l’intérieur. Quand j’ai vu l’histoire avec Makomé, qui a fait que j’ai eu envie d’écrire parce que la question était : qu’est-ce qui s’est passé dans la journée, dans les 24 heures qui ont précédé. Il se réveille le matin et il meurt le soir ; qu’est-ce qui s’est passé, qu’est-ce qui justifie ça ? C’est ça la question. J’ai voulu montrer le processus qui fait qu’il y a des jeunes qui se font tirer une balle dans la tête en entrant le soir dans un commissariat ».
En 1995, le film sort dans un contexte de stigmatisation de la banlieue après les émeutes de Vaulx-en-Velin en 1991. Le découpage du film en scènes qui affichent l’heure démontre l’intensité dramatique d’une situation où la tension monte au fur et à mesure des contrôles de police et des provocations de tous ordres, comme la rencontre avec les skinheads ou l’irruption dans une galerie d’art. Les jeunes de cité se retrouvent dans une spirale de mépris ressenti, tout au long de la journée, au fil des heures qui défilent jusqu’au dénouement tragique. Une caractéristique qui n’est pas sans rappeler le journal télévisé et la structure du reportage d’actualité lors d’un drame filmé en direct et suivi d’heure en heure par les journalistes.
Le film eut un important succès commercial, porté par l’énorme controverse qu’il suscita concernant son point de vue sur la banlieue et les violences urbaines, en raison du rôle provocateur de la police dénoncé par le scénario. Alain Juppé, alors premier ministre, condamne fortement l’image renvoyée par le film, présentant les agents de l’Etat comme des auteurs de violences policières.
Mathieu Kassovitz : « Il y avait un sujet spécifique qui était mondial à l’époque : c’était les violences policières entre la police et une certaine catégorie de gens du ghetto, que ce soit partout dans le monde. Le film a été reconnu dans le monde entier parce qu’il y avait le même problème partout au même moment. Les gens pouvaient s’identifier. Pourquoi ces jeunes qu’on traite de sauvages ne prennent pas un flingue pour tirer sur un flic le soir quand ils sentent l’injustice au point où ils la sentent ? J’ai vu le frère de Makomé partir en courant en disant « je vais tous vous shooter » et revenir : il n’avait shooté personne. J’ai voulu essayer d’analyser ça, cette sagesse. De même, pourquoi un flic qui arrive à la police en souhaitant rétablir la justice parce qu’il est pour la République et qu’il veut défendre les pauvres et l’opprimé se retrouve à faire l’inverse ? Est-ce que c’est lui qui est quelqu’un de mauvais ou est-ce que c’est le système qui le transforme ? »
A Cannes, tous les policiers du service d’ordre tourneront le dos à l’équipe du film lors de la montée des marches.
Le ministre de l’intérieur de l’époque, Jean-Louis Debré, renchérit en allant déposer plainte contre la chanson « Sacrifice de poulet » du groupe Ministère A.M.E.R., dont les paroles sont directement inspirées du film. Dix ans plus tard, en 2005, le film sera diffusé sur la chaîne parlementaire à titre de documentaire !
Mathieu Kassovitz : « Le rap est la musique qui m’a amené à m’intéresser aux quartiers et aux violences policières. Je suis arrivé à ce film à cause du Hip-Hop, pas parce que je suis un mec de banlieue. Il n’y a pas de musique dans le film à part celle qu’on entend dans les postes. Il y a Bob Marley au début puis c’est tout, et DJ Cut à la fenêtre. On a voulu représenter le film « La Haine » à travers un album de compilation de morceaux écrits par des groupes. On a découpé le scénario en thèmes qu’on a distribués à des groupes. »
Sous la direction de Solo du groupe « Assassin » dont Mathias Crochon, le frère de Vincent Cassel (Vincent Crochon à la ville), plus connu sous le pseudo « Rockin’ Squat », a été le fondateur, onze morceaux sont édités dont celui de Ministère A.M.E.R., « Sacrifice de poulet ». Le groupe de Sarcelles composé entre autres de Passi, Stomi Bugsy ou Doc Gyneco est connu pour son ton hardcore. Il est blacklisté par les médias et ostracisé par les autres groupes de Rap qui en 1995 vivent énormément dans la rivalité.
Mathieu Kassovitz : « J’ai insisté pour que le groupe Expression Direkt fasse partie de l’aventure. C’est le seul morceau de West Coast. Pour le reste (les paroles), la seule contrainte était un thème du film. Après, ils venaient avec ce qu’ils voulaient ; c’était pas à nous de les censurer. »
Si le Rap est à l’origine de l’idée du film, on y trouve également de nombreuses références cinématographiques : sur son site, le réalisateur annonce clairement s’être inspiré du film de Costa Gavras « Z » (1969). Autre exemple, dans une scène située à Paris, les trois jeunes passent devant une affiche publicitaire filmée en gros plan durant quelques secondes sur laquelle on peut lire « Le monde est à vous » et qui n’est pas sans rappeler la devise de Tony Montana (Al Pacino) dans le film de Brian de Palma « Scarface » : The world is yours ». Le fil rouge, c’est Vinz, fasciné par le personnage de Travis dans le film de martin Scorsese « Taxi Driver » (1976) et qui donne lieu à une scène d’anthologie dans la salle de bain face au miroir.
[youtube id= »okQJPUTQMqA » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Mathieu Kassovitz : « J’ai voulu réinventer le truc que faisait Scorsese qui présente ses personnages avec une image arrêtée, le nom en-dessous, procédé qu’a repris aussi Tarantino. Par exemple dans la scène où Saïd taggue « Saïd », ou celle avec le nom de Hubert dans la salle de boxe. »
Outre son sujet brûlant, une BO polémique, le film est aussi à l’origine de plusieurs phrases cultes telles que « jusqu’ici tout va bien », « arrête de faire ton caca nerveux » ou l’expression « moika » qui désigne une personne antillaise. Mathieu Kassovitz reprend également tel un clin d’oeil, le dialogue écrit par les Inconnus dans un de leur sketch « La Zup » : « Manu tu descends ? » « Pour quoi faire ? ».
Le film fut donc couronné de succès. Il obtint le Prix de la mise en scène à Cannes en 1995 et trois Césars en 1996, dont celui du meilleur film. Pour l’anecdote, le prix fut décerné et la statuette dorée remise par les Inconnus, mais pas à Kassovitz, absent ce jour-là. Vingt ans après, le film est devenu culte alors qu’au départ, aucun producteur ne voulait avancer un centime. Personne ne voulait du noir et blanc, du titre (transformé en « Droit de cité », ou d’acteurs jusque là inconnus. Aujourd’hui, sa portée sociale a été décuplée. Il cumule pas moins de deux millions d’entrées rien qu’en France et fit une carrière internationale. La Haine a commencé comme une histoire de potes qui avaient envie de secouer le cinéma français, allant à l’époque jusqu’à louer un appartement pour y vivre ensemble le temps du tournage à l’intérieur même de la cité.
Mathieu Kassovitz : « Le plus dur, ce n’est pas d’avoir les autorisations des mecs de la mairie, c’est d’avoir l’autorisation des mecs qui vivent dans la cité »
Il finit en symbole d’un certain cinéma, avec peut-être, une suite : à quand une Haine 2 ?
Mathieu Kassovitz : « Je ne sais pas, on verra. Peut-être ou peut-être pas, ça dépend de tellement de choses. Je ne sais plus ce qu’est le sujet de la banlieue aujourd’hui. Pour que je me remette dans le bain il faudrait que je retourne là-bas et je ne suis pas sûr que j’aie envie de faire ce chemin-là parce que c’est à des gens de l’intérieur de le faire. A l’époque, on ne connaissait pas la banlieue. J’ai fait le film pour des gens qui ne connaissaient pas la banlieue afin qu’ils puissent changer leur avis, regarder les infos d’une autre manière et éventuellement voter d’une autre façon. Les films de banlieue, c’est « Raï » et « Ma cité va craquer ». Je n’ai pas voulu faire ça. Je n’ai pas voulu faire un film de banlieue pour les mecs de banlieue et encore moins un documentaire. Je déteste ça. Je ne suis pas fan de « Boyz’N the Hood » (1991). Je ne voulais pas caricaturer la banlieue, mais au contraire l’ouvrir à des gens qui ne la connaissent pas. Pour faire un film, il faut un message, et je ne sais pas quel pourrait être le message aujourd’hui. A l’époque on n’avait pas de problème de crise économique, de frigo vide ou de communautarisme. »
Bande annonce :
[youtube id= »G65Y-yr4M4o » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Bande originale :
[youtube id= »FknVyZZjkms&index=2&list=PLECAKIxANlrVF2lOlSKXrvCyS8zWX4NCI » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Source : « On refait le Rap » (5 juin 2015)
[youtube id= »PNTIppNPHiI » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Et pour finir, vous pouvez toujours vous procurer « Les dix ans de la Haine » (Edition Collector 3 DVD)…