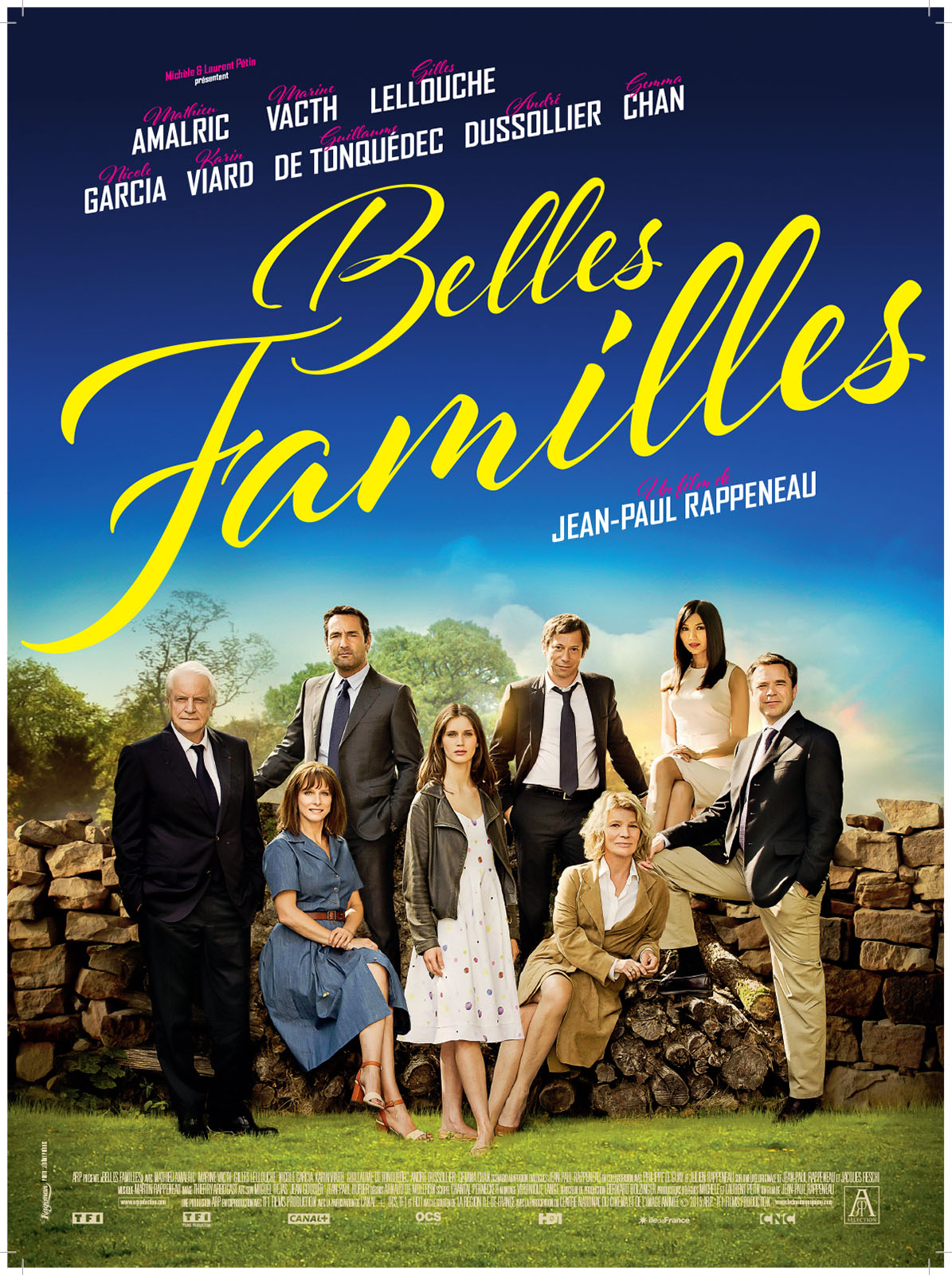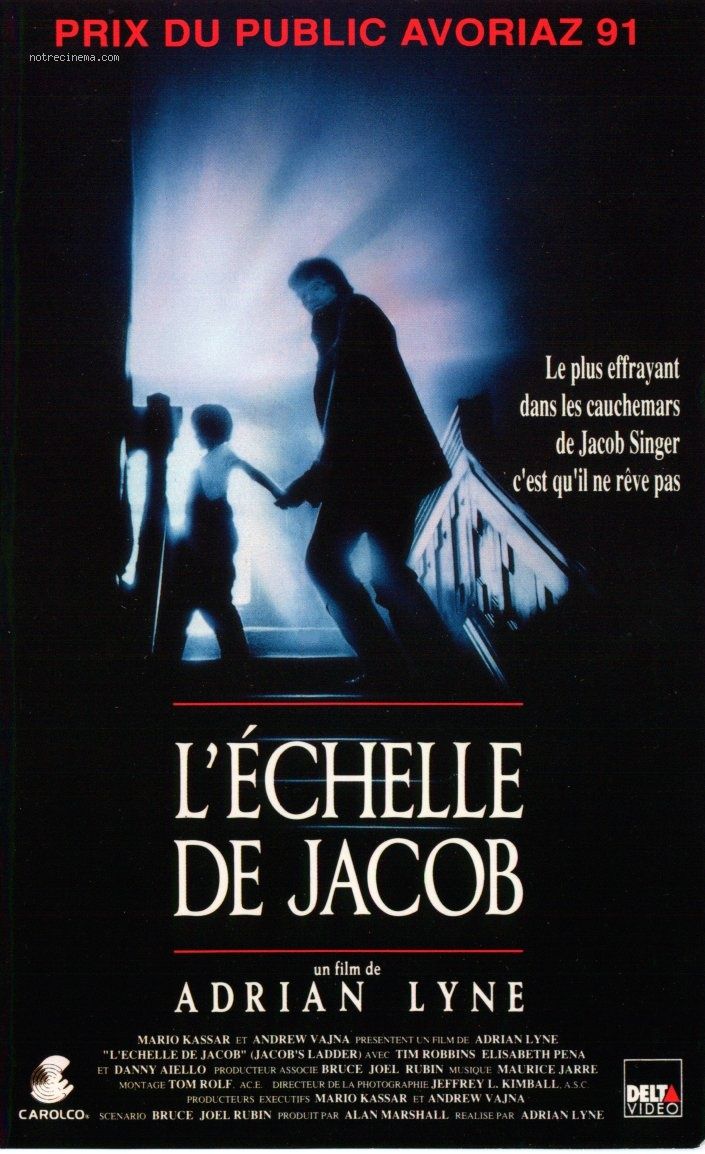C’est avec « Pee-Wee Big Adventure », sorti en 1985, que Tim Burton propose clairement en un premier film ses propres fondamentaux, avec cette lecture déviante de l’enfance, cette appréhension du monde, ce point de vue si totalement opposé à ce que Disney ou l’imagerie populaire de l’époque pouvait offrir au monde comme illustration niaiseuse et obsolète.
Avec des délais respectés et un budget serré, ce film qui est une commande du Studio Warner à la gloire de son acteur principal, Paul Reubens, est un énorme succès. « Pee-Wee Big Adventure » ouvre donc les portes des grands studios à Tim Burton, qui va avoir durant cette période encore sereine carte blanche quant à ses projets en tous genres, et plus généralement sur tout ce qu’il décidera d’entreprendre, avec bien-sûr comme seule règle de cartonner au box office.
« Beetlejuice », son deuxième film, qui cette fois épouse complètement l’esprit Burtonien, est de nouveau un succès qui accentue davantage encore l’univers très marqué du réalisateur. Vient ensuite « Edward Scissorhands », son chef d’oeuvre et autre gros succès planétaire. L’univers gothique et post-punk de Tim Burton séduit le monde, qui voit en lui un poète facile d’accès parlant des monstres, des « Freaks », comme des êtres doués d’amour et de douceur face à un monde carcan et rose, où la beauté plastique est le nouvel angle du matérialisme et du consumérisme.
Puis on offre à ce tout jeune réalisateur la chance de porter à l’écran l’une des icône de la pop-culture Américaine : « Batman ». Choix hasardeux, choix curieux, mais pourtant vrai coup artistique… Le film divise, le film scandalise, mais le film plaît… En tout cas, c’est un énorme triomphe partout dans le monde. Tim Burton devient lui-même une star, avec son univers si singulier, si « Burtonien ». Trois ans plus tard, il lui offrira une suite, « Batman Return », meilleur encore que le premier opus, et nouveau triomphe au box office.
« L’étrange Noël de Monsieur Jack » sera l’apothéose de la carrière de Tim Burton, avec au générique son comparse le compositeur Danny Elfman, qui lui offrira sa B.O. la plus réussie pour une comédie musicale, point d’orgue ajouté à l’univers du réalisateur qui sans que personne ne le sache achevait avec ce film son adolescence. Oui, on est bien là au sommet de la montagne…
« Ed Wood », douce et mélancolique variation sur un cinéma des rêveurs, des laissés pour compte de la passion, sera son dernier grand film. Suivra ensuite « Mars Attacks! », au goût du cynisme douceret et de l’aspartame. Ce film constitue aussi une réponse amusée et « Arty » à l’encombrant « Independance Day » de Roland Emmerich sorti la même année (1996).
« Sleepy Hollow » enfonce le clou mais on reste avec l’impression étrange que ce n’est plus Tim Burton qui réalise, mais un ultra-fan du réalisateur qui tenterait de le copier. Tout y est, pourtant : les clins d’oeil à Mario Bava, les ambiances à la Edgar Poe, le cinéma de genre, les afféteries, le grandiloquent… Il lui manque pourtant quelque chose d’indéfinissable. On a affaire à un film appliqué, sans défaut artistique majeur, mais qui ne passionne pas plus que cela.
Rétrospectivement, ces deux films sont pourtant à porter au crédit de Tim Burton, tant le pire est encore à venir. La dégringolade n’en finit plus et la pente semble cette fois-ci plus longue que sur l’autre versant.
Arrive donc l’horrible remake de « La Planète Des Singes ». Les fans de la première heure ne comprennent pas ce qui se passe. Mais le couperet tombera avec « Big Fish », ou comment Tim Burton dit exactement le contraire du discours qu’il tenait avec ses premiers films.
Avec « Charlie et la Chocolaterie », on se prend cependant à espérer, car même si les numéros musicaux ainsi que l’ensemble de la direction artistique sont hideux, des éléments nous renvoient pourtant aux premiers films du réalisateur, peut-être aussi grâce à Johnny Deep et cet étrange personnage qu’il campe, croisement improbable entre Michael Jackson qui détesterait les enfants et un présentateur de télé pour mouflets gavés de sucreries devenu hystérique…
« Sweeney Todd » suscite la même impression. Cette comédie musicale propose des chansons à mourir d’ennui, est extrêmement mal mise en scène, et pourtant elle retrouve par moment la fibre même de l’esprit Burton. Sombre, ironique, ricanante mais mélancolique…
A l’annonce du projet « Alice au Pays des Merveilles », on n’attendait plus grand chose, à vrai dire, tant le sujet en lui-même était une évidence. Et effectivement, le film n’a plus rien à voir avec une production dont Tim Burton serait l’auteur. Le début est pourtant assez réussi, avec notamment le passage du monde réel au monde merveilleux. Quelque chose est suspendu, on prend son temps et l’héroïne semble incarnée. On y croit. On veut y croire…
Mais une fois Alice perdue dans ce monde « magique », l’ennui est hélas de nouveau au rendez-vous. Tout pratiquement est filmé en image de synthèse, mais autant chez Cameron, ces image 3D proposent un monde que l’on croit vrai et enchanteur, autant ici, on frise l’indigence, tant l’imagination de Burton est devenue anémique. Tout y est laid et triste. Ces couleurs saturées semblent avoir comme unique fonction la liaison avec les décors pour les futures attractions des parcs à thème Disney.
L’histoire n’a aucun intérêt et les péripéties sont laborieuses et molles. On peut de temps à autre apprécier un élément, un mot, un personnage que l’on trouve intéressant, puis on se rappelle que c’est Tim Burton qui est aux manettes de l’entreprise, celui qui était capable de tout métamorphoser et qui n’avait pas besoin de se rendre dans un monde magique ou merveilleux pour justement nous faire croire au merveilleux.
Cette rencontre entre l’univers de Lewis Carroll et Burton fait donc « pschitt », comme un pet de mouche… Et soudain on se souvient que Burton avait quitté Disney, ou plutôt c’est la firme qui l’avait remercié pour incompatibilité de goût et de style. Plus de vingt ans plus tard, finalement, Tim Burton revient au bercail, mais cette fois-ci plus comme un ado rebelle mais comme un réalisateur quinqua qui se sert juste d’une marque, d’un nom, d’une étiquette.
Tim Burton n’a plus rien à nous raconter et ne semble dorénavant recycler indéfiniment son univers que par souci de rester dans un inconscient collectif. Un univers pictural qui en soi déjà revisitait tout un pan cinématographique et littéraire fantastique et science-fictionnel des années 50 et 60, passé par son prisme pour être proposé au plus grand nombre, comme la visite d’un grenier merveilleux.
Ces impressions de déjà-vu, ces univers qui nous semblaient familiers, commençaient cependant dès « Sleepy Hollow » à ne plus évoquer grand chose dans notre propre imaginaire. Tim Burton a ouvert sa boutique de « goodies »… Et que ce soit le barbier sanguinaire, la fabrique de chocolat ou le monde hideux de cette Alice chimique, tout ressemble désormais à des parcs d’attractions, nous ressassant inlassablement les mêmes bonnes vieilles recettes.
Désormais, cette saveur synthétique qui a remplacé le goût de l’étrange et du bizarre est telle que l’on se dit que c’est un fan absolu du réalisateur de Pee Wee qui tente de copier le style Burton sans jamais vraiment parvenir à donner une vision cohérente à ces nouveaux spectacles. Les projets se suivent, mais n’ont plus cette magie qui caractérisait tant « Edward aux mains d’argent », « Batman Return » ou « Beetlejuice ».
Vient ensuite « Dark Shadows », un film qui n’a plus que la peau sur les os. Exsangue, sans inspiration, sans souffle, fatigué, et qui malgré tout l’arsenal mis à la disposition de la production (effet spéciaux, décors, lumières, casting) ne changera jamais rien à ce naufrage de plus. Avec cette relecture d’une série 70’s américaine moisie alliée à la thématique du vampire que Burton n’avait jamais vraiment affronté, on assiste à toute une première partie plutôt agréable. On est content également de constater que le film n’emprunte pas trop au style comédie décalée que l’on essayait de nous vendre dans la bande-annonce.
On pense très vite aussi au cinéma de Wes Anderson. Etrange impression, tant le style indolent de la mise en scène, la présentation de chacun des personnages et des standards 70’s éculés, fait que cette nouvelle production de Tim Burton laisse présager un film tout entier construit sur ce genre tragi-burlesque, mélancolique et précieux, avec cette famille vivant sa malédiction avec dignité, renoncement et une classe divine. Il n’en sera rien, pourtant… Le scénario va s’empêtrer dans des fausses pistes qui ne mènent à rien. Burton nous laisse penser que l’on va assister à une folle histoire d’amour et en fin de compte, il s’amuse à peine lui-même de ses figures qu’il a sorties pour l’occasion de sa malle à jouets. Ce que l’on croyait indolent est en fait mou. Johnny Depp ne passionne guère en essayant de réinventer un vampire, sorte de composite de figures surannées. Le film offre pourtant encore de bien belles choses sur le plan des trouvailles visuelles. Mais à quoi bon, puisque l’histoire ne nous transporte jamais. Tout est étirée comme du chewing gum mâché qui a perdu depuis des lustres sa saveur.
Est-ce que Tim Burton peut réellement se réinventer, se renouveler, partir sur autre chose, exploiter un autre filon que celui qu’il a asséché depuis maintenant dix ans ?
« Big Eyes » sorti en 2014 essaie effectivement de remettre tout à plat, avec cette histoire de faussaire, d’identité usurpée, de peintre des années 50 ringarde. Oui, Burton tente de nous refaire du « Ed Wood ». Mais non, en fait… Le film ressemble à un téléfilm indolent et poli traitant d’un sujet dont on se contrefiche comme de notre dernière crotte oubliée au fond d’une cuvette. Alors dire qu’en 2016, nous attendions avec impatience son adaptation au cinéma du roman de Ransom Riggs, « Miss Peregrine et Les Enfants Particuliers », eut été mentir, quelque part…
Mais après tout, six films mémorables dont deux chefs d’œuvre, c’est déjà pas si mal dans une filmographie…
[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Dévoreur Hubertouzot
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Hubert Touzot : Photographe dévoreur d’images