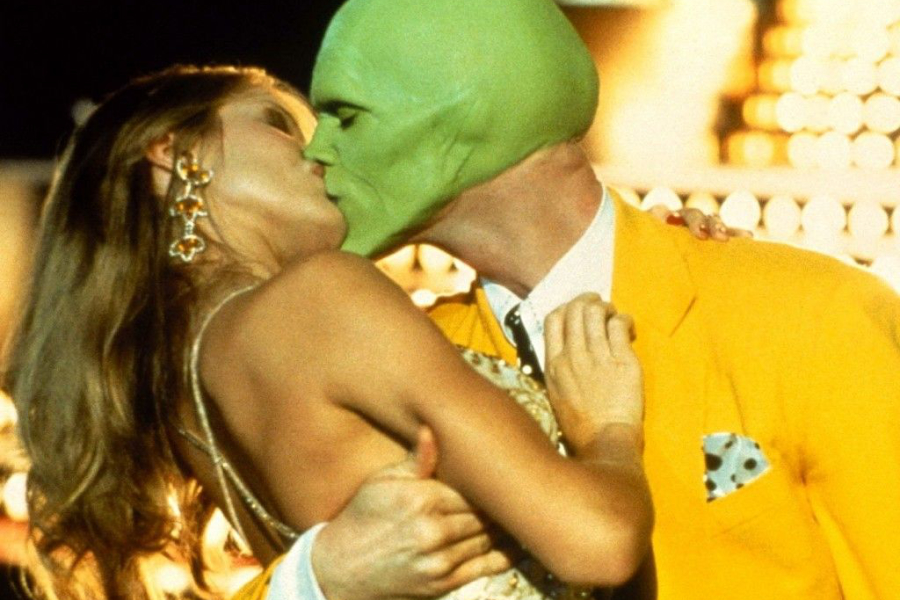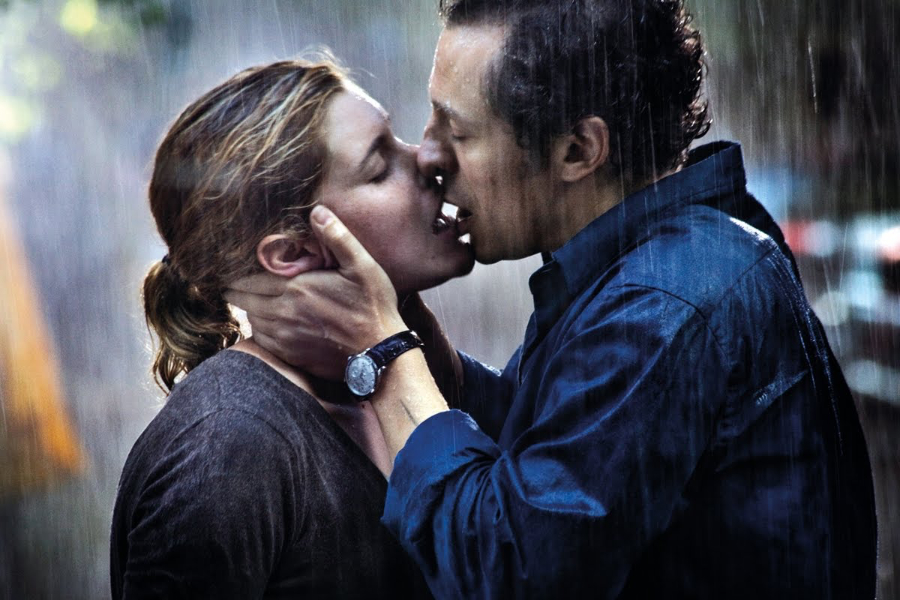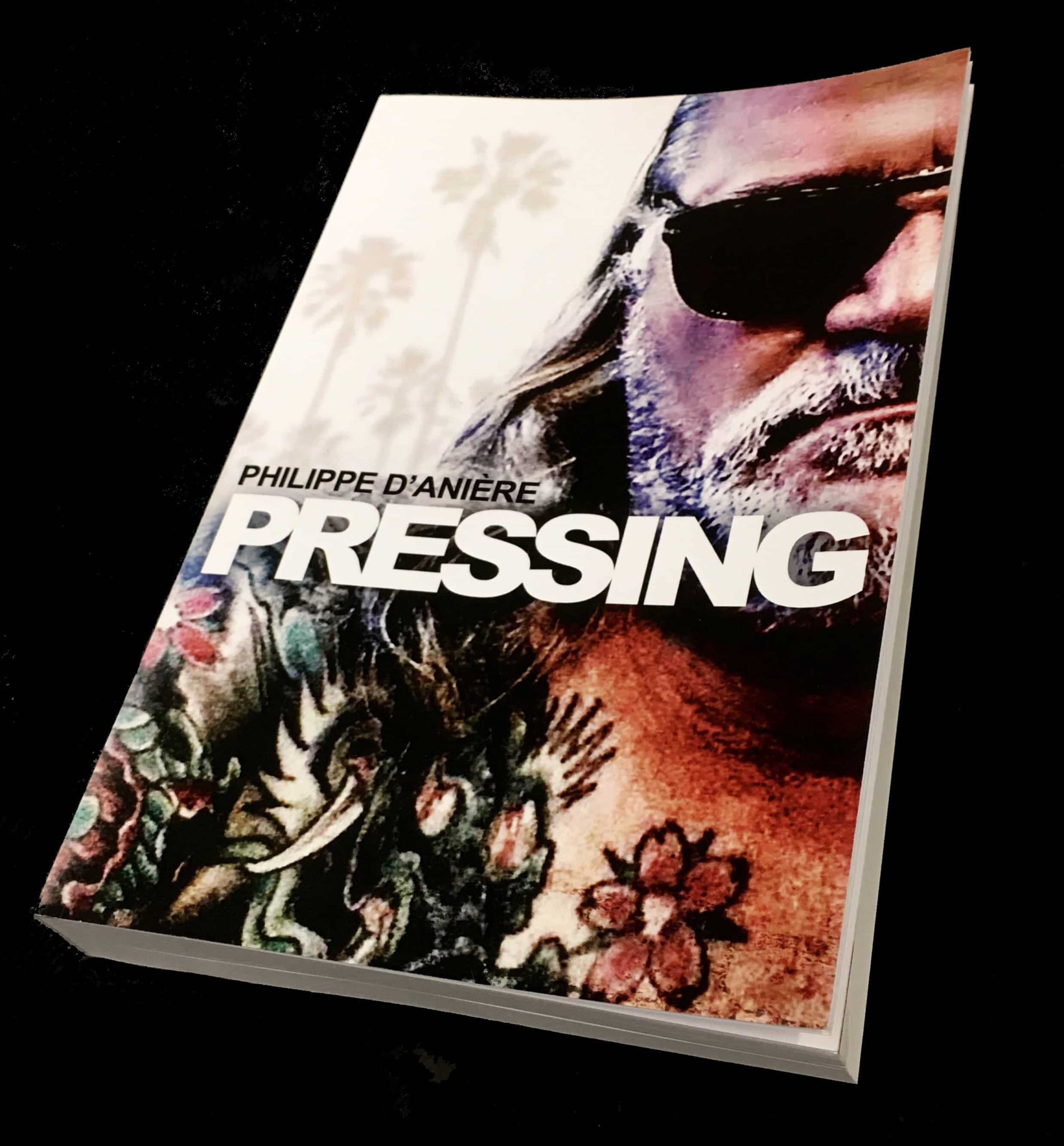« Raconter, c’est résister »… La vie de Luis Sepúlveda oscille entre ces deux actes, qu’il voulait aussi engagés l’un que l’autre. L’écrivain chilien, auteur du best-seller mondial « Le Vieux qui lisait des romans d’amour », est mort jeudi 16 avril du Covid-19, à l’âge de 70 ans.
Il avait trouvé refuge à Gijon, paisible ville côtière des Asturies : vingt-trois ans que l’écrivain chilien y résidait avec son épouse, la poétesse Carmen Yanez, savourant ici plus qu’ailleurs, cette « tradition de lutte politique instaurée par les mineurs » et cet « esprit de fraternité » qui le rassérénait. Il rentrait d’un festival littéraire qui s’était tenu non loin de là, au Portugal, lorsqu’atteint d’une féroce pneumonie, le diagnostic est tombé, le 29 février dernier. A l’hôpital d’Oviedo, il a lutté pendant un mois et demi contre le coronavirus, avant de succomber à la maladie, jeudi 16 avril. Ce sera le dernier combat du révolutionnaire, qui avait arpenté d’autres terrains, autrement plus périlleux, minés ceux-là par les dictatures.
De l’Espagne au Chili, on pleure « Le Vieux qui lisait des romans d’amour », titre de son premier succès planétaire, publié en 1992. Il n’était pas si « vieux », Luis Sepúlveda : il avait 70 ans. Et comme son héros, il avait vécu de bouleversantes découvertes : celle, dans sa jeunesse, de la forêt amazonienne et celle à ses vieux jours, de la lecture, puissant « antidote contre le venin de la vieillesse », assurait-il. Parce que « raconter, c’est résister », mantra emprunté au Brésilien Joao Guimaraes Rosa, des romans, il en écrira une vingtaine, traduits dans 50 langues et couronnés de prix, du Pégase d’or italien au prix chilien de la critique. En France, on l’avait nommé chevalier des Arts et des Lettres.
La voix des oubliés
Ses « romans d’amour », il les dédie d’abord à son pays, le Chili. Il a beau l’avoir quitté en 1977, contraint à l’exil, il ne perdra rien de son militantisme : menant des actions au sein de la Fédération internationale des droits de l’homme et portant dans ses romans la voix des oubliés. Toujours ces mêmes héros fragiles et vacillants, brisés par l’histoire et l’exil, des perdants ou des vaincus qui, épris de rêves collectifs, refusent la défaite. Leur destin, leurs combats et désillusions n’ont rien de romanesque : c’est son vécu qu’il nous conte, lui qui sera, comme tant d’autres, condamné et torturé par le régime de Pinochet.
Sa peine ? Vingt-huit ans de prison en 1973, pour « trahison » et « conspiration ». Son crime ? S’être rangé du côté du président Allende, dont il appartenait à la garde rapprochée. On critique, dans ses romans, son sensationnalisme ? Il l’assume. Chez lui, ça fait partie du processus créatif : « Je suis entièrement ému par l’histoire que je raconte, j’aime être très fidèle à mes personnages, tomber amoureux d’eux, car je sais que le lecteur, en lisant, ressentira une émotion très similaire à ce que je ressens en écrivant. Pouvoir partager ses émotions et ses sensations, c’est ce qu’il y a de plus beau dans la littérature », confiait-il.
Le sentiment de l’exil
Le sentiment de l’exil, ce natif d’Ovalle, qui se disait « profondément rouge » et qui avait rejoint à 12 ans les Jeunesses communistes, l’a hérité d’un grand-père anarchiste qui avait fui avant lui l’Andalousie. Dans ses veines coulait aussi le sang d’un chef indien, auquel il dédiera un roman, « Histoire d’un chien Mapuche », pénétré par son esprit de rébellion. En 1977, Amnesty International le sort au bout de deux ans et demi des sordides geôles de Temuco. Pas question d’accepter en échange cet exil de huit ans en Suède ; il gagne les territoires reculés de l’Amérique du Sud : l’Equateur, d’abord, où il monte sa compagnie théâtrale, avant de s’immerger en 1978 dans la vie des Indiens Shuars, sur lesquels il scrute pendant un an pour l’Unesco l’impact de la colonisation.
De ses recherches sur les ethnies, il découvre les idiosyncrasies régionales, « le plus grand trésor de l’esprit humain », dira-t-il. Et puis, le Nicaragua où en 1979, il passe à la lutte armée aux côtés des Sandinistes de la brigade Simon Bolivar. Depuis l’Allemagne où il devient grand reporter, il embrasse une autre cause : l’écologie. Et c’est à bord d’un bateau de Greenpeace, sur lequel il embarque dans les années 80, qu’il alerte sur les désastres qui menacent notre planète. Son Moby Dick à lui, ce sera cette « Histoire d’une baleine blanche » qu’il publie en 2019.
Reste qu’au Chili, il n’y retournera qu’après la chute de la dictature. Dans son recueil « Histoires d’ici et d’ailleurs », il dévoile ce cliché, dont il ne s’est jamais séparé : celui d’une bande de gamins de La Victoria, banlieue pauvre de Santiago, qu’il s’était promis un jour de réunir. Avec l’avènement fragile de la démocratie, c’est un autre pays qu’il retrouve, ravagé par les macs qui charcutent les jeunes filles au scalpel et par ces parvenus de millionnaires, escroqués par des Madoff en série.
La lutte contre le fléau de l’oubli
Tout a changé, sauf les visages de ses camarades qui portent à jamais les stigmates de l’horreur. Le pire fléau ? L’oubli, pour ce révolutionnaire, habité par la nostalgie des combats d’autrefois, consacrés à la défense des idéaux et de ce temps qui ne sera plus. Dans « L’ombre de ce que nous avons été », il faut les voir, ces anciens militants de gauche, sexagénaires, prêts à renouer, 35 ans après le coup d’Etat de Pinochet, avec l’action révolutionnaire.
Le secret des lendemains qui chantent ? Pour ce poète et conteur hors pair, il est dans notre capacité à croire aux rêves. Relisez donc son « Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler », fable enchanteresse, vendue à 5 millions d’exemplaires et adaptée au cinéma. Il l’a écrite avec le cœur et les tripes, pour toucher, amuser et faire réfléchir.
Article © Audrey Lévy pour Marianne