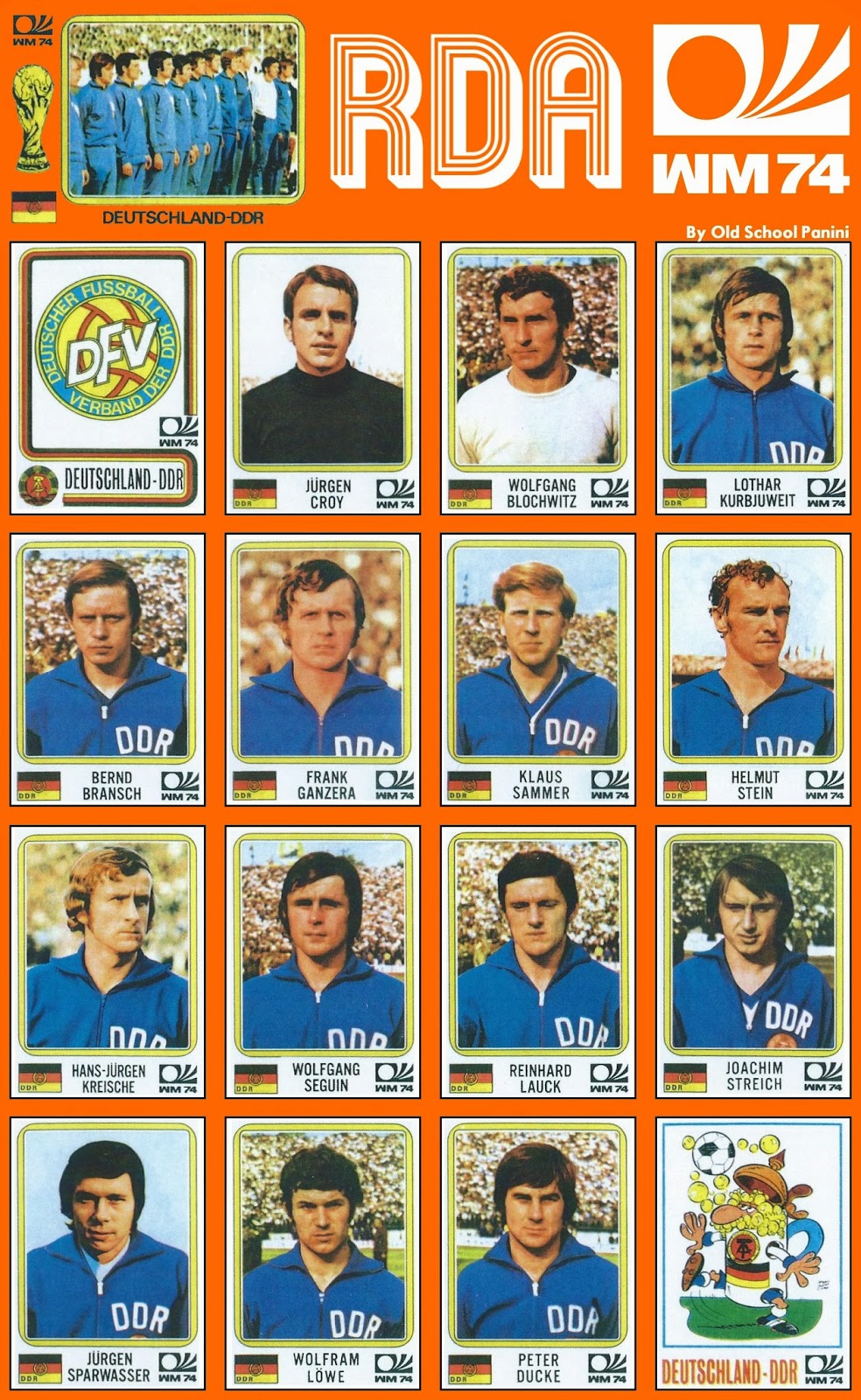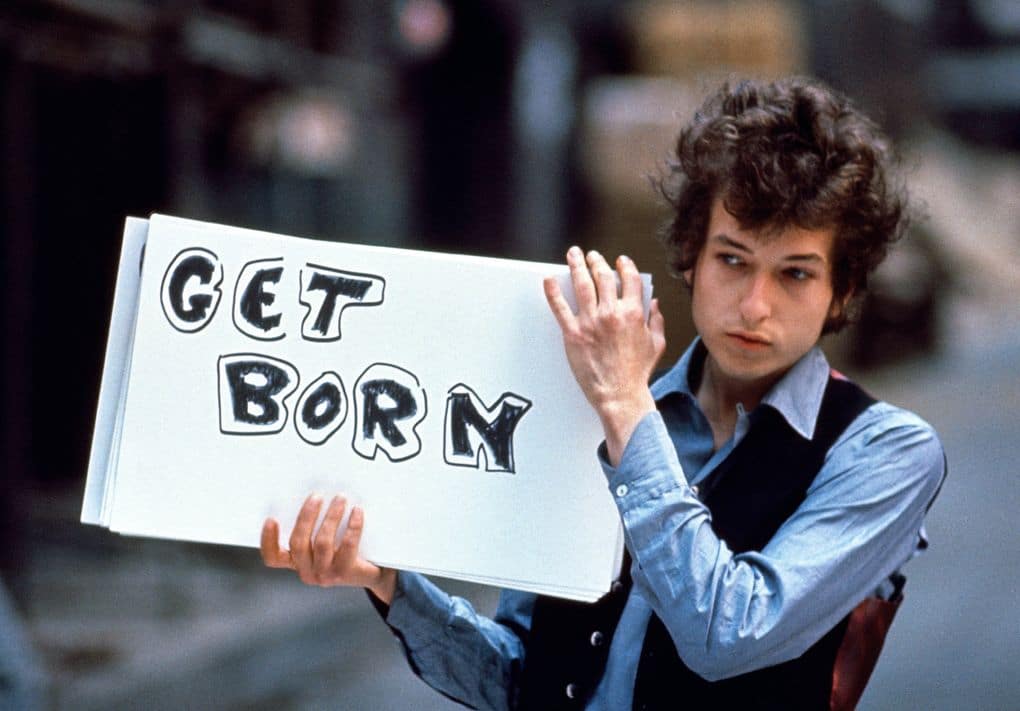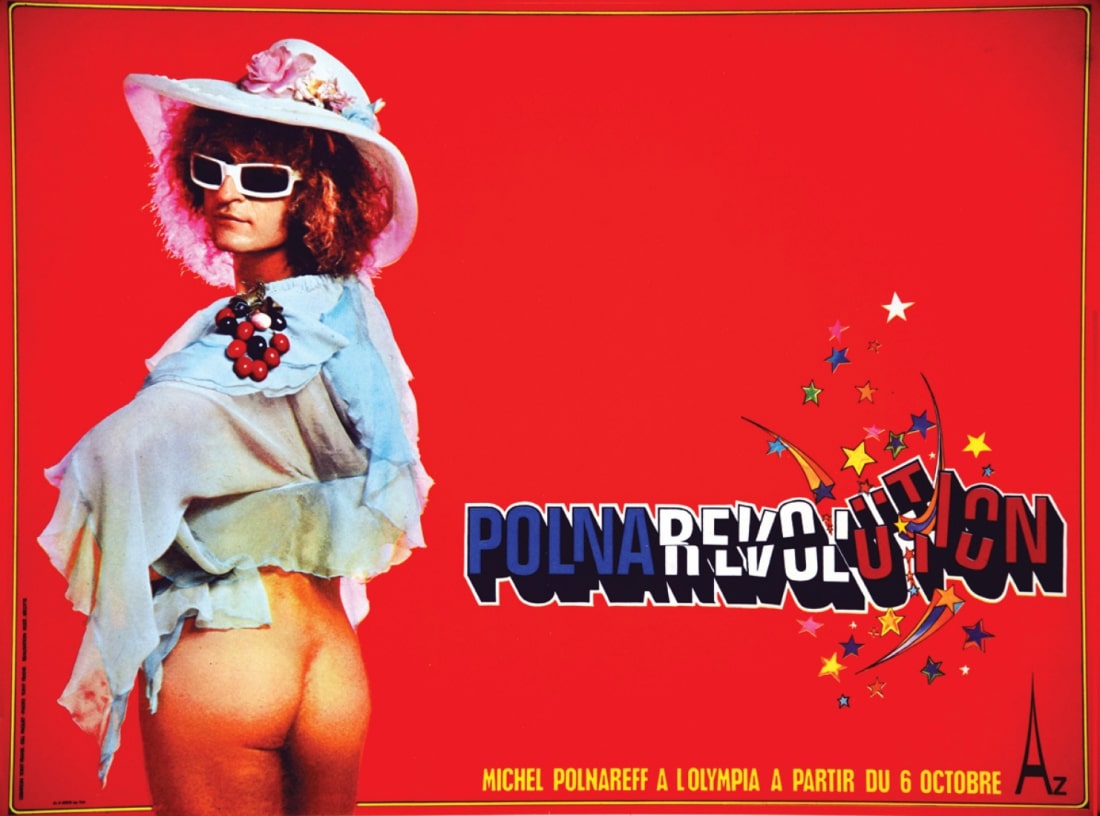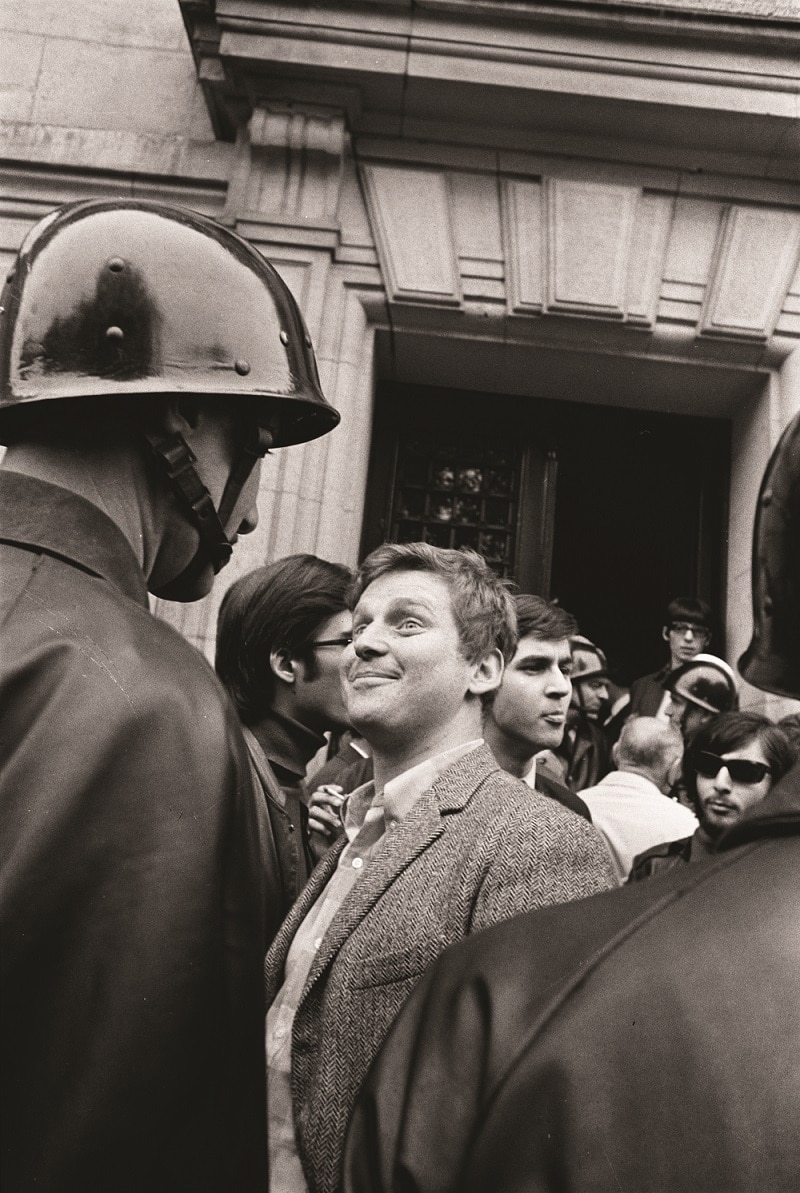A travers 71 peintures et 26 dessins provenant de prestigieuses collections internationales publiques et privées, cette exposition se concentre, pour la première fois et de manière exclusive, sur le développement de l’œuvre de Nicolas de Staël lors de son séjour en Provence, entre juillet 1953 et juin 1954.
La période provençale de Nicolas de Staël marque un tournant essentiel, aussi bien dans sa vie que dans son œuvre. Entre juillet 1953 et juin 1954, l’artiste y puise une nouvelle source d’inspiration.
La découverte de la lumière du Midi, la beauté exceptionnelle de ce pays, la rencontre amoureuse d’une femme et l’épreuve de la solitude qui lui permet de répondre à sa future exposition à New York à la galerie Paul Rosenberg, sont autant d’expériences qui nourrissent son imaginaire et le rythme spectaculaire de sa production artistique. La renommée internationale de Nicolas de Staël prend son élan au cœur de la Provence.
À Lagnes, en juillet 1953, le regard du peintre s’intensifie. Les paysages sont saisis au plus près de leur motif, avec une attention portée sur l’évolution de la lumière au fil de la journée. En août, le peintre voyage jusqu’en Sicile. Son appréhension des paysages, des sites archéologiques et des musées, lui permet, une fois de retour à Lagnes, de mettre en chantier une série de tableaux parmi les plus importants de sa carrière, notamment à partir des notes prises dans ses carnets à Fiesole, Agrigente, Selinonte et Syracuse. À la même époque, son intérêt pour l’étude du nu trouve son expression la plus accomplie dans les grands tableaux de figures et de nus qui dialoguent souvent avec le paysage.
Au terme de cette année intense de travail, le peintre a la certitude, en 1954, d’avoir donné le maximum de sa force. Préparant son exposition à New-York, il écrit à Paul Rosenberg : « Je vous donne là, avec ce que vous avez, de quoi faire la plus belle exposition que je n’ai jamais faite ». L’exposition « Nicolas de Staël en Provence » rend ainsi compte des plus hautes envolées picturales du peintre. Ici, la précision d’un regard révèle la nature dans son expression la plus inventive.
Commissariat
Gustave de Staël est né en 1954, à Paris. Il est le quatrième enfant de Nicolas de Staël. Après deux ans d’école d’architecture, il se met à peindre puis à graver. En 1991, il prend la direction de l’Association pour la Promotion des Arts à l’Hôtel de Ville de Paris où pendant quatorze ans, il est le commissaire d’une trentaine d’expositions pour la Salle Saint-Jean. Après avoir dirigé les Instituts Français du nord du Maroc, Tanger et Tétouan, il décide de partager son temps entre Paris et Tanger et de se consacrer à nouveau à la peinture où il travaille en alternance aquarelles sur le motif, dessins et peintures. Depuis dix ans, il est également coéditeur des éditions tangéroises Khbar Bladna. Sur Nicolas de Staël, il a réalisé l’exposition de la Salle Saint-Jean en 1994 ainsi que la rétrospective au Musée National de l’Ermitage en 2003, à l’occasion du tricentenaire de Saint-Pétersbourg.
Marie du Bouchet est née en 1976. Elle est titulaire d’une maîtrise de philosophie sur la phénoménologie de Husserl. Après avoir collaboré à l’exposition « Paris sous le ciel de la peinture » organisée par Gustave de Staël à l’Hôtel de Ville de Paris en 2000, elle devient productrice à la radio, sur France Culture, à partir de 2001, pour l’émission « Surpris par la Nuit » dirigée par Alain Veinstein. Elle produit de nombreux documentaires sur la peinture et l’histoire de l’art. En 2003, elle écrit la monographie « Nicolas de Staël, Une illumination sans précédent » dans la collection Découvertes Gallimard. Depuis 2011, elle est membre et coordinatrice du Comité Nicolas de Staël.
[youtube id= »8Mxayq6TvpQ » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Programmation
Nommée directrice de la programmation culturelle des expositions de Culturespaces en 2017, Beatrice Avanzi est notamment en charge du Musée Jacquemart-André, du Musée Maillol et de l’Hôtel de Caumont – Centre d’Art. En tant que conservatrice du département des peintures du Musée d’Orsay depuis 2012, elle avait assuré le commissariat d’expositions majeures telles que « Le Douanier Rousseau – L’innocence archaïque » ou « Au-delà des étoiles – Le paysage mystique de Monet à Kandinsky ».
A ses côtés, Agnès Wolff, responsable de la production culturelle, Cecilia Braschi, responsable des expositions pour l’Hôtel de Caumont – Centre d’Art, et Sophie Blanc, régisseur des expositions chez Culturespaces.
Application Smartphone
Cette application vous permet de découvrir les plus belles œuvres de l’exposition grâce à 23 commentaires d’oeuvres et la bande-annonce de l’exposition. Profitez d’une visite en très haute définition avec une profondeur de zoom exceptionnelle.
Tarif : 2,99 €
✓ Disponible sur l’AppStore
✓ Disponible sur Google Play
[arve url= »https://vimeo.com/265720848″ align= »center » description= »Nicolas de Staël en Provence » maxwidth= »900″ /]
© Réalisation de la vidéo : Olam Productions
© Photo à la Une : Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
© Nicolas de Staël, Paysage de Provence, 1953, huile sur toile, 33 x 46 cm, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid © Adagp, Paris, 2018
[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour Aller Plus Loin » class= » » id= » »]
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Hôtel de Caumont, Aix-en-Provence
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] « Nicolas de Staël en Provence » (Gustave de Staël et Marie du Bouchet, Ed. Hazan)