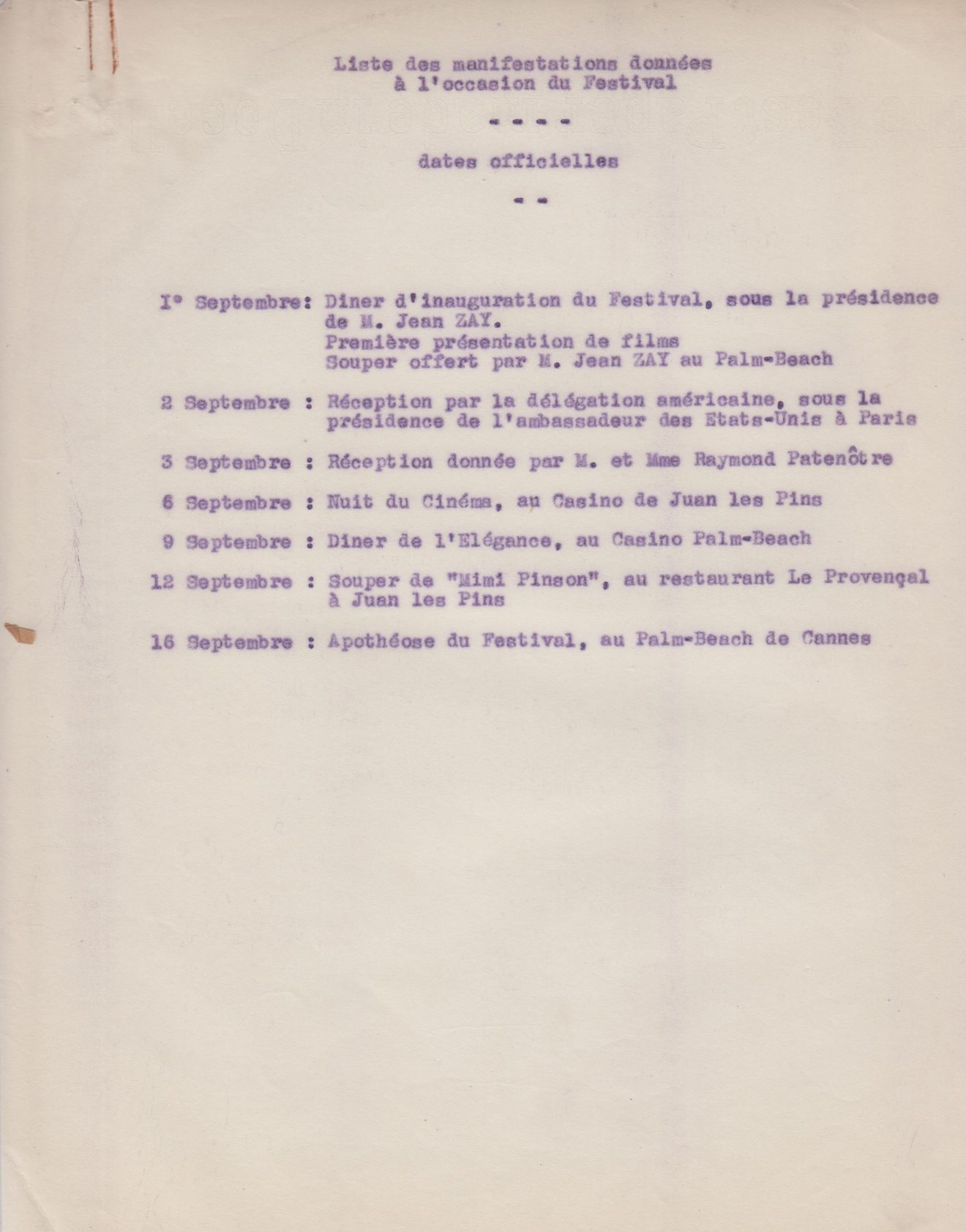Pierre Desproges, disparu en 1988, aurait eu quatre-vingts ans le 09 mai 2019. Inclassable trublion, spécialiste des blagues potaches, éternel gamin dans la vie de tous les jours, roi de la provocation, père attentionné, amateur de bon vin, travailleur acharné, écorché, grand pessimiste, bon vivant… Pierre Desproges surprend par ses multiples facettes, parfois contradictoires.
Mort en pleine gloire voilà trente-et-un ans, Pierre Desproges nous parle toujours… Bien-sûr, certains textes, très liés à l’actualité, ont vieilli. Mais tant d’autres, qui traitent de thèmes universels et chers à l’humoriste, résonnent encore aujourd’hui.
« Tout dans la vie est une affaire de choix, ça commence par la tétine ou le téton, ça se termine par le chêne ou le sapin. » (Textes de scène, Éditions du Seuil)
Chercher à raconter la vie de Pierre Desproges : c’est une gageure. Comme le rire qui résiste obstinément à toute tentative de définition, l’homme ne se laisse pas enfermer facilement dans une case. Difficile en effet de faire l’inventaire de l’œuvre d’un cinglant lettré, d’une personne au parcours atypique ; d’un homme qui fustigeait les bonnes consciences, de son personnage misanthrope et antihumaniste qui lui permettait d’aller très loin. Mais qui était vraiment Pierre Desproges, qui, aujourd’hui encore, continue d’être considéré comme une référence ? Comment expliquer sa modernité et sa singularité ?
« La culture, c’est comme l’amour. Il faut y aller par petits coups au début pour bien en jouir plus tard. » (Réquisitoire contre André Balland, Éditions du Seuil, Tôt ou Tard)
Le meilleur moyen de partager la vie et l’œuvre de Pierre Desproges est de faire entendre une série de points de vue qui suggèrent l’homme à différents moments de sa vie. De la guerre d’Algérie à la Madeleine, du Petit Rapporteur au Théâtre Fontaine, de l’écriture au cimetière du Père-Lachaise, ce documentaire invite à déambuler sur les différents territoires de Desproges. Il remonte le temps pour découvrir Pierre Desproges à travers celles et ceux qui l’ont côtoyé : sa fille, Perrine ; Jacques Catelin, son ami de jeunesse ; Francis Schull, son collègue au quotidien l’Aurore ; Jean-Louis Fournier, réalisateur attitré et complice ; Yves Riou, l’ami humoriste.
« Je me heurte parfois à une telle incompréhension de la part de mes contemporains, qu’un épouvantable doute m’étreint : suis-je bien de cette planète ? Et si oui, cela ne prouve-t-il pas qu’eux sont d’ailleurs ? » (Chroniques de la haine ordinaire, Éditions du Seuil)
Ces témoignages révèlent une personnalité sans concession, angoissée et complexe, à laquelle font écho ses thèmes de prédilection. Des sujets les plus universels (la vie, l’humour et le rire, l’écriture, l’amitié et l’amour, la mort, le racisme) aux plus singuliers (les cintres, les cons, les coiffeurs, la maladie), qui se confondent dans la vie de homme, et dans l’œuvre de cet artiste aux talents protéiformes.
« Humoriste, c’est un mot grave et prétentieux comme philosophe ou spécialiste : je ne suis pas un spécialiste de l’humour. C’est par humilité que je ne veux pas être humoriste. En revanche, c’est par vanité que je ne veux pas être comique. Un comique, c’est un type qui a le nez rouge, qui pète à table, qui se met une fausse barbe : ça me glace totalement. Ce sont des mots impropres. Pareil pour « écrivain », je dirais plutôt écriveur. Parce qu’écrivain, c’est à la fois outrecuidant et trop incisif. » (Libération, 3 mars 1986)
Il ne suffit pas d’être heureux. Encore faut-il que les autres soient malheureux… Trente-et-un ans après sa mort, portrait intime par ses proches d’un homme tendre et angoissé, à l’humour sans ambiguïté ni concession : « me courber me fait mal au dos. Je préfère rester debout ».
« J’ai le plus profond respect pour le mépris que j’ai des hommes. »
Article et Documentaire signés Romain Masson pour France Culture (février 2018)
[arve url= »https://www.franceculture.fr/player/export-reecouter?content=39ef5c4b-7cf2-4418-b650-9fcc8514a24d » title= »Pierre Desproges : « Je ne suis pas n’importe qui » » align= »center » aspect_ratio= »21:9″ loop= »no » muted= »no » /]
Une émission de Romain Masson, réalisée par Anne Perez-Franchini – Prise de son : Yann Fressy, Ollivia Branger – Mixage : Claude Niort – Archives INA : Arnaud Plançon – Liens internet : Annelise Signoret.
Archives PMP Productions (Perrine Desproges) : Spectacles au Théâtre Fontaine (1984) et au Théâtre Grévin (1986), réalisés par Jean-Louis Fournier. Archives INA – 30 millions d’amis, « Les animaux extraordinaires de Pierre Desproges », TF1, le 8 novembre 1979 – Boîte aux lettres, Jérôme Garcin, FR3, le 26 juin février 1983 – Mardis du théâtre, Lucien Attoun, France Culture, le 25 novembre 1986.
Remerciements
Hélène Desproges, Jérôme Garcin, Marie-Ange Guillaume, Nina Masson, Myriam Nguyen, Philippe Pouchain, les Editions du Courroux, PMP Productions, Les Jardins du Marais.
[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Pierre Desproges Officiel
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Pierre Desproges – Je vais être sincère… (Entretien publié dans Les Inrocks le 29 novembre 1995)
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Pierre Desproges interviewe Françoise Sagan pour le Petit Rapporteur (Novembre 1975)
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Entretien au coin du feu (Archive INA, 12 mars 1977)
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Chaîne spéciale Desproges sur Dailymotion