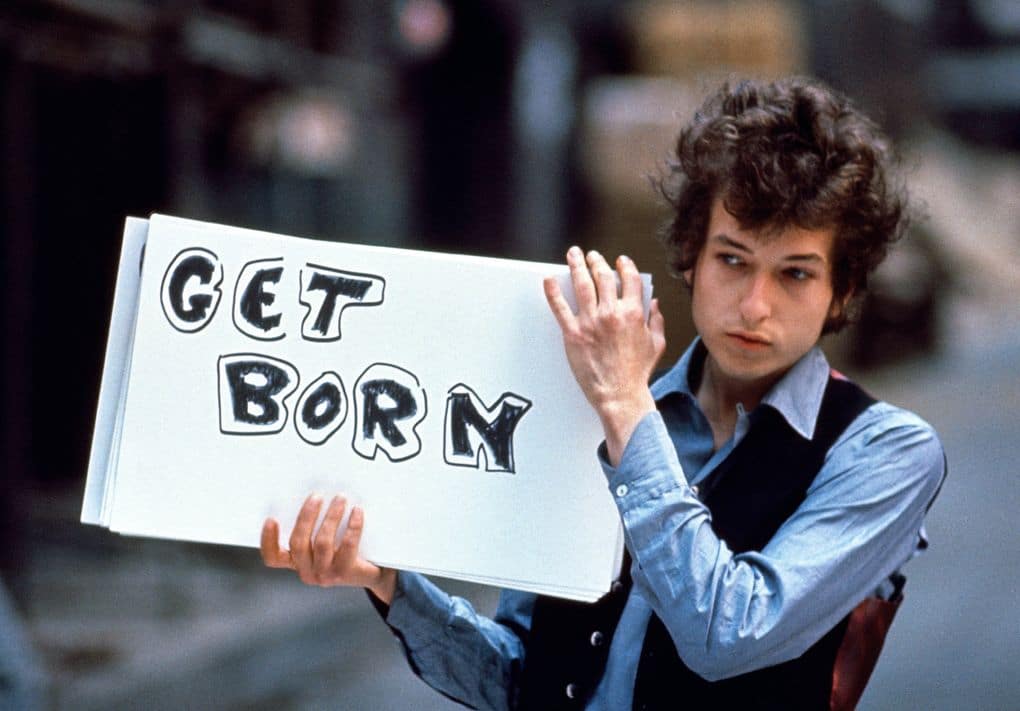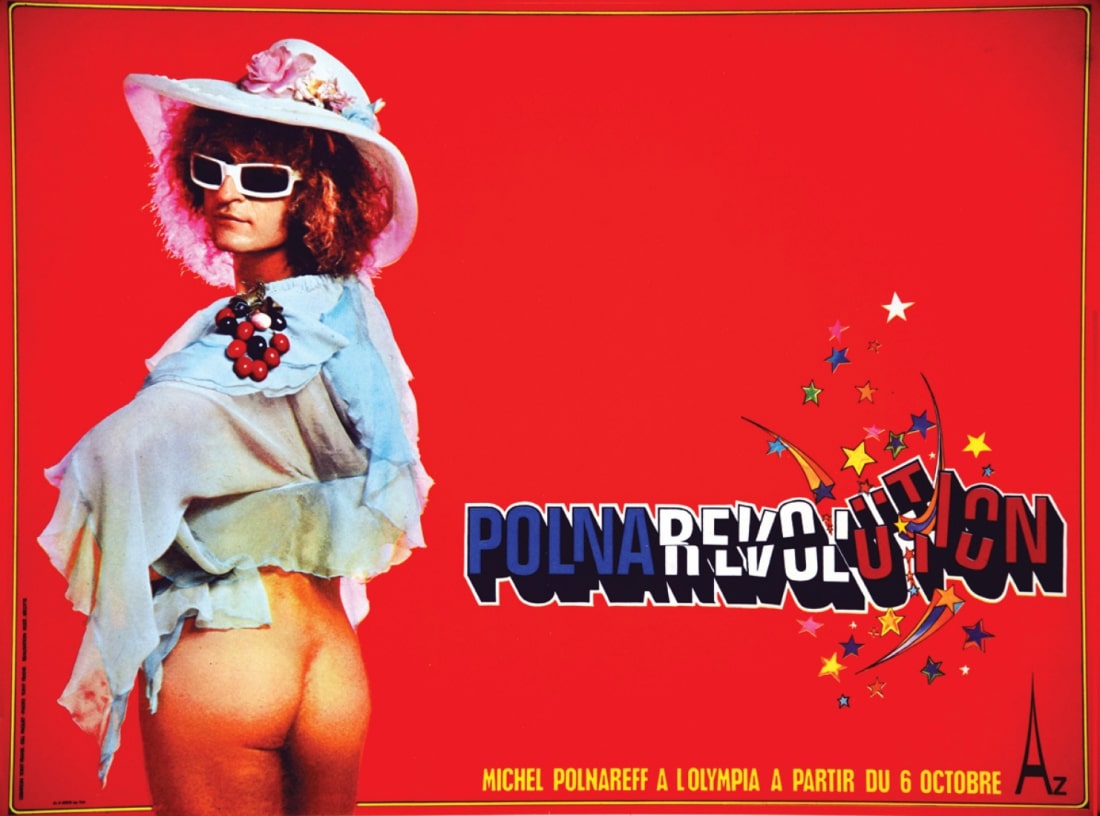Serge Gainsbourg est un monde à lui tout seul, un concept. Une immensité aussi grande que contrastée. C’est un océan puissant, profond et tour à tour sombre, étincelant, élégiaque ou vociférant, en fonction des flux et reflux du temps. Et la lune, maîtresse argentée, l’a souvent brinquebalé, en yo-yo schizophrénique.
Capable de composer des chansons aux mélodies sublimes et aux textes ciselés comme de sorties publiques plus problématiques, Serge Gainsbourg était ce Docteur Jekyll et Mister Hyde soumis à l’astrologie et aux femmes, esclave de son signe zodiacal et de son thème astral. Ses frasques et ses attitudes sont aussi célèbres que ses chansons. Gainsbourg était bélier ascendant poisson, l’eau et le feu. Il a véhiculé, tout au long de ces trente années passées sous les feux de la célébrité, autant de paradoxes, d’excès et de fulgurances, dans le seul but de se construire un personnage de légende ; plus qu’une carrière, une épopée.
« Je t’aime et je crains de m’égarer et je sème des grains de pavot sur le pavé de l’anamour. »
Peintre et romancier avorté, nourri de poésie et de littérature du 19ème siècle, Gainsbourg voue un culte et une obsession à Rimbaud, Musset, Baudelaire, Edgar Alan Poe, et chez les écrivains, à Oscar Wilde (« Le Portrait de Dorian Gray ») ou Benjamin Constant (« Adolphe ») ; mais surtout à sa bible absolue, la matrice de toute son œuvre et de ses pulsions, « A Rebours » de Joris-Karl Huysmans. Et c’est ainsi qu’il deviendra ce dandy flamboyant, cynique et passablement méchant, qui jette sur le monde un regard désinvolte.
« Ce mortel ennui qui me vient quand je suis avec toi… »
Vous ne lui trouverez pas d’équivalent créatif et artistique dans le reste du paysage musical et lexical. Sans le savoir, Gainsbourg a su remixer avant l’heure Brahms, Chopin, Beethoven, Schumann, Khatchaturian, Sibelius, Dvořák, pour reprendre ces mélodies appartenant à l’inconscient collectif et leur apporter sa prose et ses humeurs.
Ce fils de parents juifs russes ayant fui le communisme n’aura jamais autant rendu leurs lettres de noblesse à la langue française comme à ces illustres compositeurs. Et ce qu’il aura raté ou perdu dans la peinture, il le retrouvera dans la musique et la chanson, qu’il appelait pourtant un art mineur.
Plus encore que ses quelques percées dans la réalisation pour le cinéma ou la publicité, il composera également des musiques de films (« La Horse », « Ce Sacré Grand-Père », « Je T’aime Moi Non Plus », « Mister Freedom », « Slogan », « Cannabis », « Manon 70 »…), en leur apportant une plus-value indéniable, tant en termes de qualité que d’émotion, qui transcenderont les longs-métrages eux-mêmes. Des mélodies, des sonorités à la modernité évidente, qui se dissocient instantanément des images et dont on se souvient encore aujourd’hui, contrairement aux films qu’elles habillèrent…
De la fin des années 50 jusqu’au début des années 90, le petit Lucien Ginsburg, qui deviendra tour à tour Serge Gainsbourg puis Gainsbarre, en une lente et sinueuse métamorphose, nous aura gratifié d’une œuvre himalayesque. Ce petit garçon juif arborant fièrement son étoile jaune comme on porte une étoile de shérif, sans doute déjà enclin à l’anti-conformisme et avec sa vision du monde toute personnelle, cet enfant malingre aux oreilles décollées, transportera longtemps une pelletée de complexes. Se sachant laid ou pensant l’être, il cultivera toute sa vie un art de la provocation et du bon mot, quitte parfois à être méchant en blessant les autres.
[youtube id= »8TF2YNbDyb8″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Telle la petite chenille, il a commencé simple pianiste sous la houlette de Boris Vian, puis s’est déployé comme un papillon noir et or. Son œuvre n’a eu de cesse que de croître, à raison de tubes incontournables et de chansons inoubliables. Il fut toujours à la recherche de collaborateurs rares et talentueux, entre Alain Goraguer pour la patte jazzy, Michel Colombier et l’avènement pop, Jean-Claude Vannier pour les expérimentations psychédéliques ou Jean-Pierre Sabard pour des sons plus « FM ». Autant d’inspirations et de rencontres, pour mieux créer encore et canaliser toute cette passion, ce sacerdoce imposé par une exigence sans limite. Ces arrangeurs ont servi les créations de Gainsbourg comme des écrins et les diamants qu’ils renferment.
Chaque décennie recèle un ton et évoque un univers bien défini, où Serge surfe allègrement sur les genres et les attentes, pour dépasser aussi les lignes imposées par l’époque. Il ne veut pas simplement se contenter de recracher de petites chansons à succès, bien sages, à l’image d’un Claude François, car son objectif ultime est de sublimer le moment et s’inscrire toujours, à la manière d’un Ronsard, d’un Baudelaire, dans un(e) geste définitif(ve).
Ces volutes Gitanes, la fragrance Van Cleef & Arpels, cette verve au débit saccadé et narquois, ont séduit les plus belles femmes. Et il en a fait chanter plus d’une… Blondes, brunes, rousses, elles se sont toutes bousculées pour venir roucouler les mots que Gainsbourg leur sculptait sur mesure, tel un Michel-Ange torturé, fougueux et génial. Certaines sont restées plus longtemps que d’autres, avec ce privilège d’être dans l’intimité de l’homme à la Rolls Royce, comme un collier de perles qu’on ne quitte jamais, même pour dormir. Bardot, Gréco, Deneuve, Bambou…
Et puis il eut Jane, à qui l’auteur de « Je t’aime moi non plus » consacra tout un album, « Histoire de Melody Nelson », probablement son chef-d’œuvre. Pour l’ex-épouse du compositeur anglais John Barry, Gainsbourg déploie toute son imagination et écrit ses textes les plus forts, les plus fous, ceux qui donnent l’impression de léviter.
[youtube id= »i1cJEN8xj8M » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
« Ecoute ma voix, écoute ma prière. Écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire… »
A Jane Birkin, Gainsbourg offre autant de chansons sublimes. Il n’a pas peur de les rendre meilleures, et bien plus encore que celles qu’il se réserve. L’amour rend aveugle. L’amour rend fou. L’amour rend meilleur aussi. Si Serge Gainsbourg ne sait pas dire « je t’aime », parce que tout compte fait, sa pudeur et sa timidité souvent le rongent, il s’emploie par des moyens détournés à déployer sa prose et son lyrisme, pour hurler ses sentiments en des élégies somptueuses et des musiques sophistiquées.
Il était un poète à fleur de peau qui se cachait derrière la subversion et l’insolence…
Jane Birkin possède une voix fragile et candide, mais en théorie pas celle conçue pour chanter. Et pourtant, c’est toute l’histoire de la chanson française que cet artiste au physique étrange révolutionne. Les mots collent ici au plus près de la tessiture de la petite Anglaise. Ce sont presque des feulements qui parfois expriment autant de caresses, de désirs et de tristesse. La chanson va devenir intime, tellement proche. Une fois de plus, Gainsbourg étonne, innove. Avec l’élégance dont il s’entoure pourtant et cette manière de ne pas y toucher, il grave tout un répertoire dans le marbre.
En 1971, sort dans les bacs le nouvel album du propriétaire du 5 bis rue de Verneuil. S’inspirant des riffs langoureux et hypnotiques de Jimi Hendrix, Serge Gainsbourg imagine toute une histoire dans laquelle il décrit un personnage sorti tout droit d’un roman caché de Lewis Caroll. Presque androgyne et encore enfant, Gainsbourg tient la ligne de crête dans ses descriptions, avec des allusions qui aujourd’hui l’enverraient tout droit au tribunal, accusé par nos nouveaux inquisiteurs, serviteurs infatigables de la bien-pensance.
[youtube id= »97ip0sdVN14″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
« Comment tu t’appelles ? Melody ! Melody comment ? Melody Nelson ! Melody Nelson a les cheveux rouges et c’est leur couleur naturelle. »
Tout dans ce nouvel opus n’est que somptuosité et magnificence. Avec cette « Histoire de Melody Nelson », Gainsbourg tutoie les astres. Hélas, ces idiots qui constituent le public de l’époque préfèrent se bâfrer de Mike Brant et autres chanteurs bellâtres du moment. C’est un échec commercial et critique cinglant, avec moins de 18.000 copies vendues. Gainsbourg en gardera longtemps une aigreur et une douleur, tel un ulcère. Mais il va prendre sa revanche, à sa façon.
Avec « L’Homme à Tête de Chou », qui sort cinq ans plus tard, Gainsbourg réitère pourtant avec le principe de l’album-concept. Ce nouvel opus peut s’écouter comme l’autre versant de celui de 71. Une version plus glauque, plus sordide, de cette Melody, être diaphane et fantastique, devenue désormais une simple humaine prénommée Marilou. Une coiffeuse un peu vulgaire et passablement intéressée, qui rend dingue celui qui est tombé en pâmoison sous ses charmes de shampouineuse. Elle le mènera à sa perte, avant que celui-ci, dans un éclair de lucidité, ne lui fasse la peau en lui fracassant le crâne à coup d’extincteur d’incendie.
« … elle a sur le lino, un dernier soubresaut, une ultime secousse.
J’appuie sur la manette, le corps de Marilou disparaît sous la mousse… »
Gainsbourg aura tout testé, tout tenté, avec des fortunes diverses, même avec deux albums Reggae et un ultime album Funk, très dispensable.
Si Serge Gainsbourg, à l’instar d’un Gilbert Bécaud, ne tombera jamais dans l’oubli, c’est parce qu’il était habité par l’amour et sa passion des femmes. C’est ce qui reste et qui vibre à chaque nouvelle écoute de son œuvre. Qu’il les chante ou qu’il les ait fait chanter, chacune d’entre elles nous habite et nous subjugue. De la petite chansonnette (« Le Poinçonneur des Lilas », « L’Ami Caouette ») à la définitive (« 69 Année Erotique », « Je suis venu te dire que je m’en vais »), cette précision du mot, cette musique et ses arrangements, alliés à la désinvolture qui le caractérisait, ne peuvent pas nous faire oublier que ce dandy absolu était d’une ultra et hyper-sensibilité qui lui permettait ainsi de voler au-dessus des contingences et des hommes. Son œuvre polymorphe et précieuse s’enracine dans notre culture. On a chacun une chanson, un air, une phrase, une rime, de celui qui fumait des Gitanes lorsque Dieu, lui, préférait les Havane.
« Sorry angel, sorry so, c’est moi qui t’ai suicidée mon amour, moi qui t’ai ouvert les veines.
Je sais maintenant tu es avec les anges pour toujours, pour toujours et à jamais. »