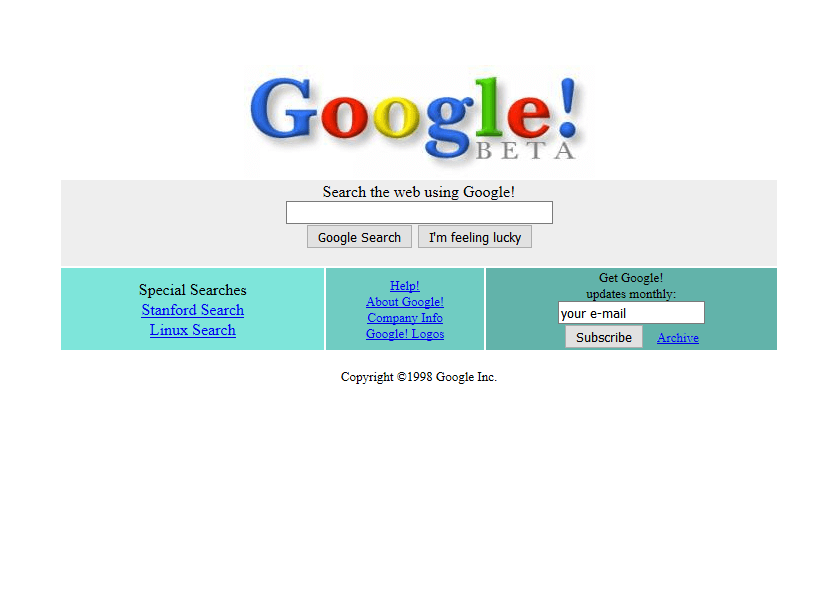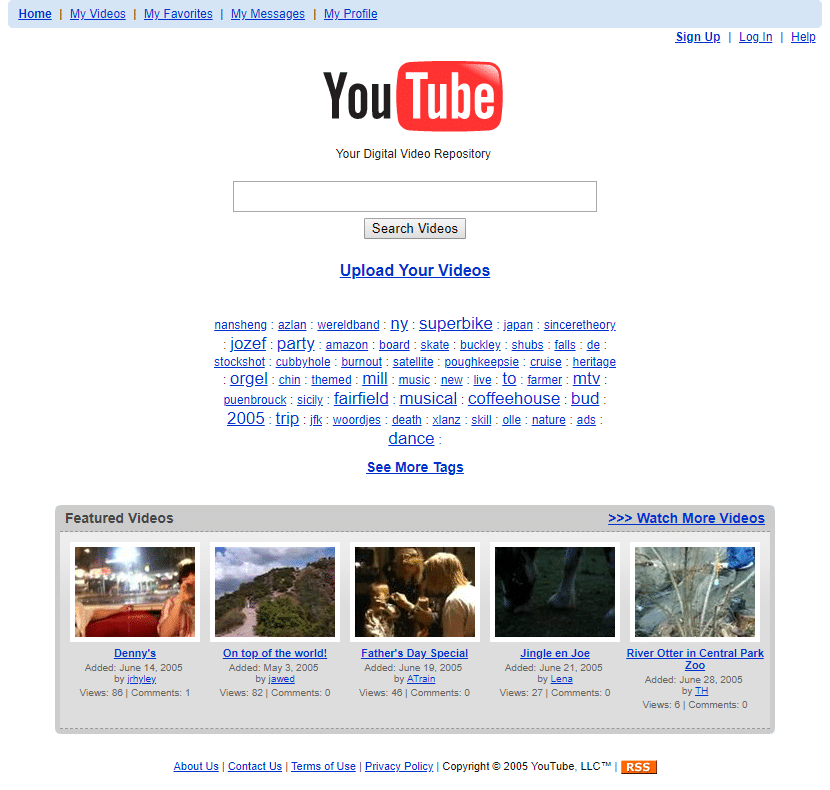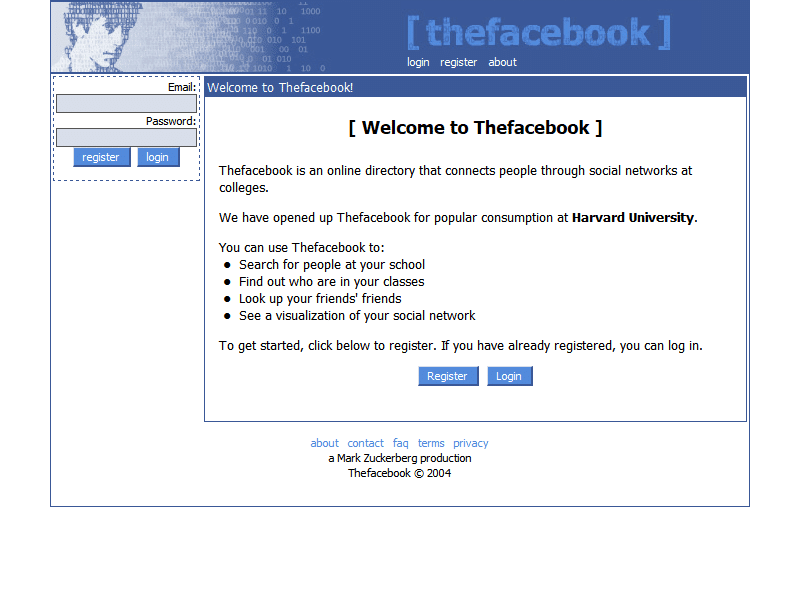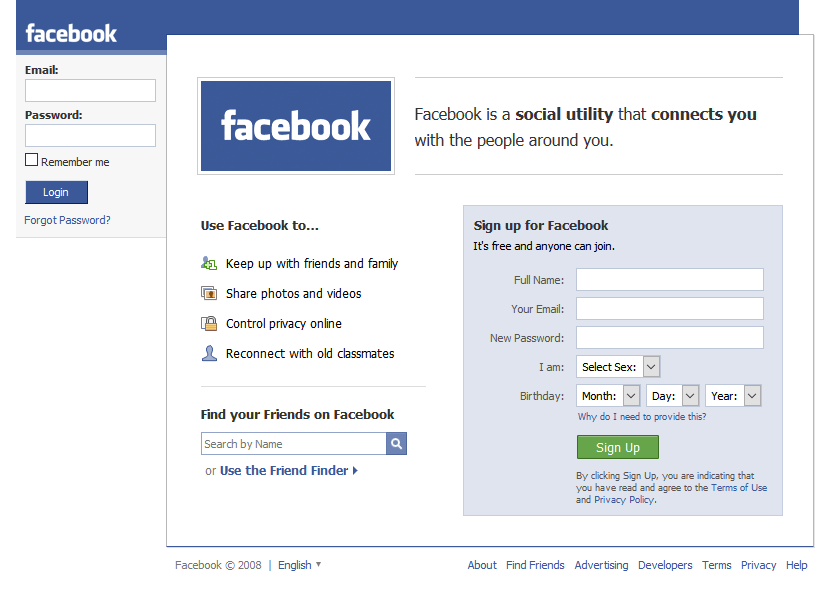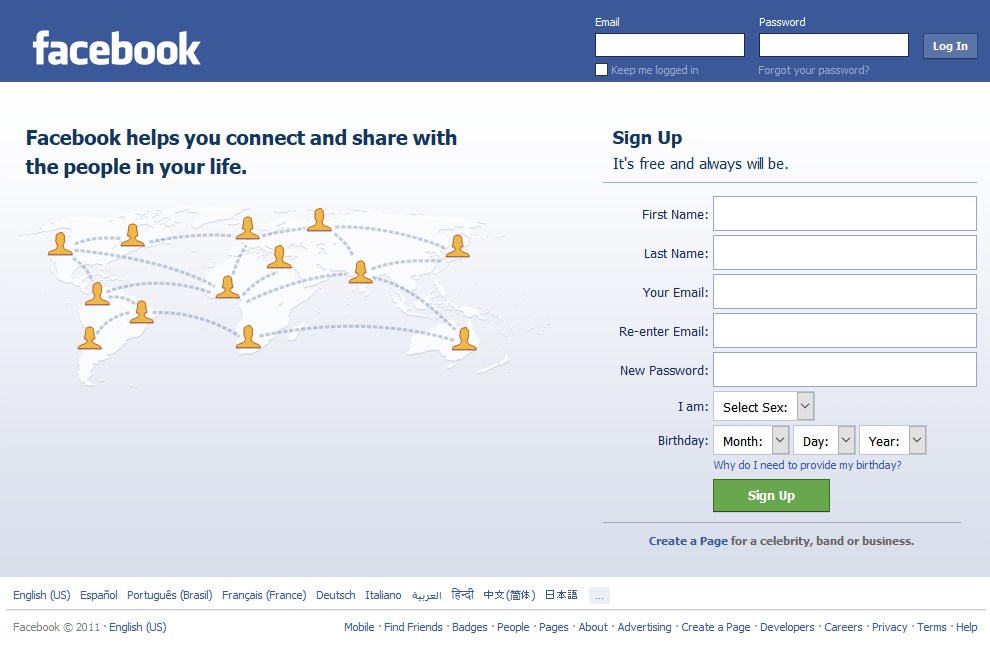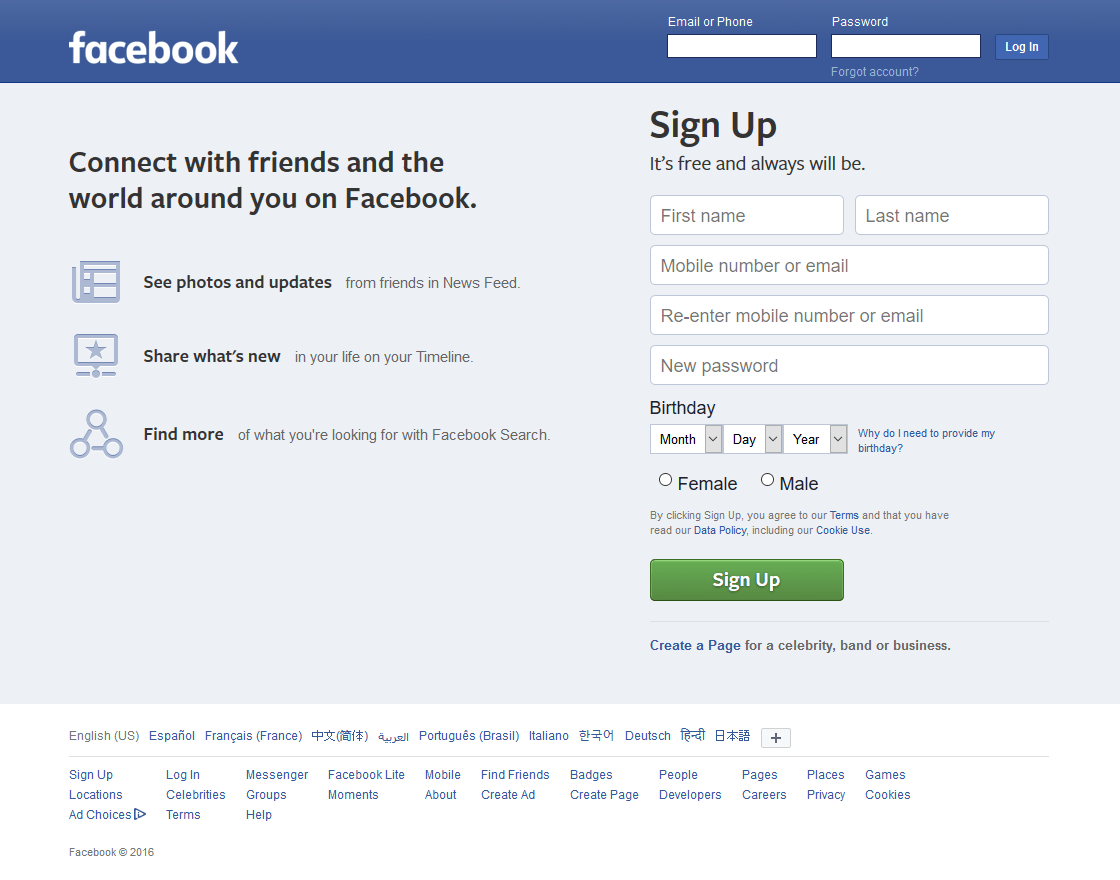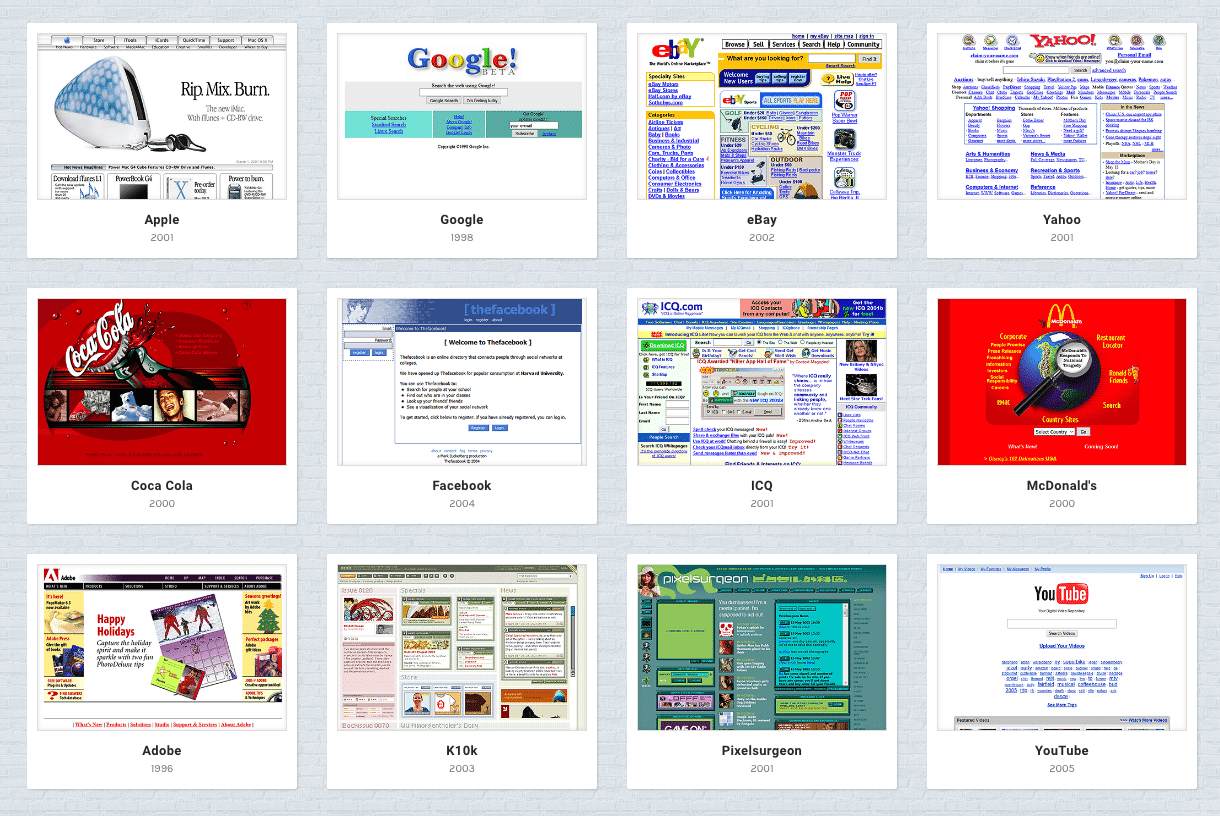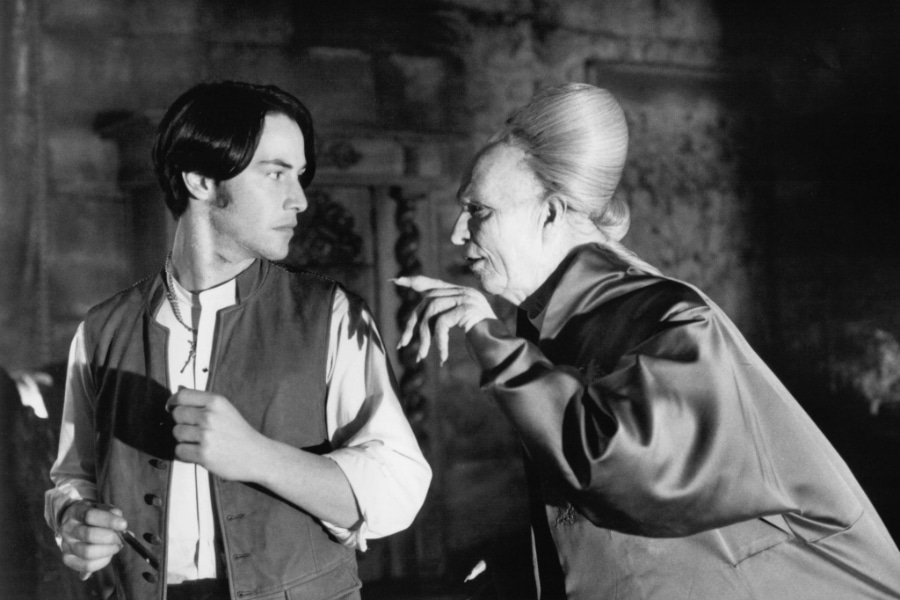Avec le documentaire « De La Soul Is Not Dead » sorti en 2016, nous reprenons le chemin d’Amityville, Long Island, une des banlieues de New York, la Mecque du hip-hop, avec les trois membres du groupe De La Soul, là-même où trente ans plus tôt, trois camarades de lycée à l’instinct créatif des plus aiguisés parvenaient à attirer l’attention de DJ Prince Paul en envoyant une cassette de démo au label Tommy Boy Records.
Tommy Boy Records, le même label qui balançait à la face du monde le fameux « Planet Rock » d’Afrika Bambaataa quelques années plus tôt et contribuait à l’émergence internationale du hip-hop, s’apprêtait à connaître sa seconde révolution avec De La Soul et son « Me, Myself and I ». Mais les trois gamins étaient à cette époque bien loin d’imaginer ce que l’avenir leur réservait.
Tandis que la nouvelle génération du rap s’appuie plutôt sur une musique agressive alliée à des textes radicaux dans cette fin des années 80, le style de De La Soul repose quant à lui essentiellement sur le groove et le sampling de sons plus pop, jazz, psychadéliques, voire folk. C’est d’ailleurs pour des histoires de droits que ces titres de la première heure, devenus pourtant des classiques, ne se trouvent plus sur les plateformes digitales, tant nos trois compères sont allés puiser dans le patrimoine musical mondial, des Whatnauts et leur classique « Help Is On The Way » dans le titre « Ring Ring Ring », extrait de l’album « De La Soul Is Dead » (1991), à Serge Gainsbourg sur leur troisième opus « Buhloone Mind State » sorti en 1993.
Que de chemin parcouru, donc, depuis cette démo envoyée en 1988 à l’un des producteurs les plus iconiques de tous les temps, DJ Prince Paul, et le retour sur les terres de leurs débuts en 2016, à l’occasion du documentaire « De La Soul Is Not Dead » tourné au moment de la sortie de leur dernier album en date, « And The Anonymous Nobody ». 25 ans s’étaient écoulés depuis le mythique « De La Soul Is Dead » en 1991, et 20 ans depuis « Stakes Is High » en 1996, leur première production sans DJ Prince Paul aux commandes. Il n’en reste pas moins qu’avec ou sans le concours de leur mentor, ces deux opus auront définitivement placé De La Soul en orbite et maîtres de leur destin.
A l’écoute de ce dernier album « And The Anonymous Nobody » jalonné de collaborations diverses et variées, de Snoop Dogg et l’irrésistible « Pain » à David Byrne avec « Snoopies », en passant par « Greyhounds » en duo avec Usher, on réalise rapidement que, contrairement à ce qu’ils clamaient à la face du monde en 1991, non, « De La Soul Is Not Dead »…
[youtube id= »8i346sS-_8Q » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]