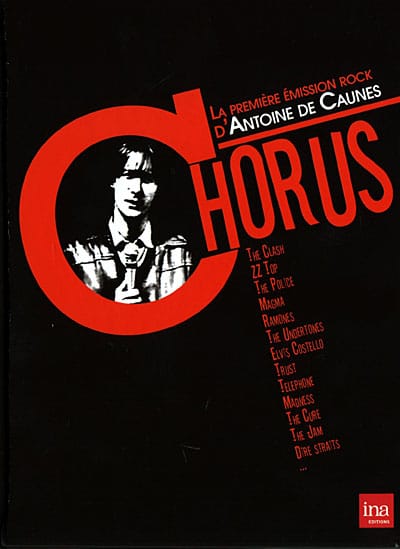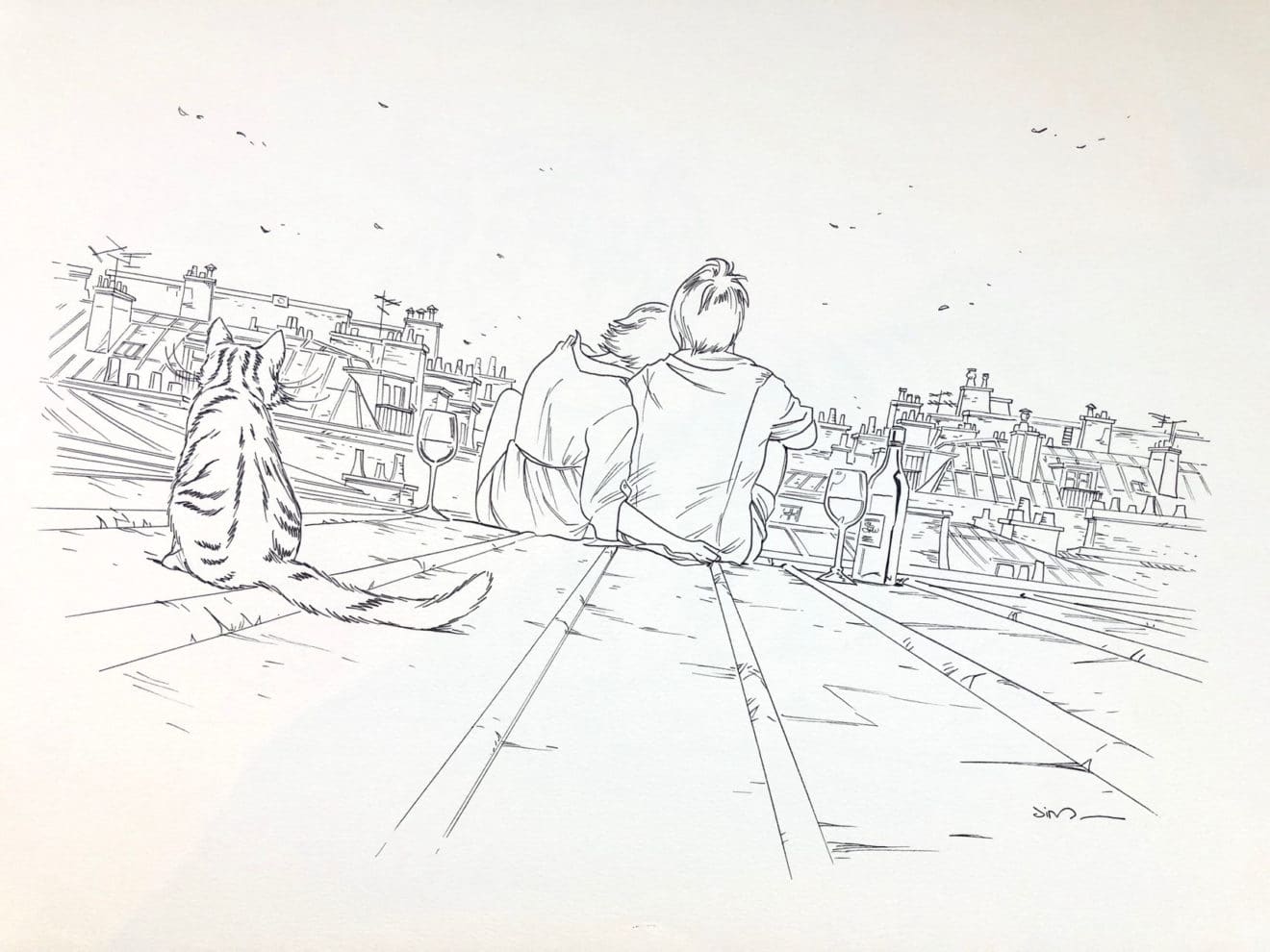Avec son dernier single en date « Shut Me Down » sorti en octobre 2017, le duo français Haute s’impose peu à peu dans le paysage musical comme un de ses espoirs parmi les plus sérieux.
Nous découvrions Haute en septembre 2014, avec leur premier titre « Down » publié sur leur page Soundcloud et dans la foulée sur la compilation Nova Tunes 3.0. Cette jolie bluette mélangeant sonorités rythmées, sampling et voix suaves, au croisement du hip-hop électronique (proche de l’univers de Flume) et de la pop soulful, nous laissait déjà présager un avenir radieux pour nos deux comparses.
https://soundcloud.com/hauteofficial/down
S’ensuivent ensuite deux Eps, « Reciprocity » et « Nuit » sortis respectivement en 2015 et 2016, qui posent les bases de ce que sera définitivement le son « Haute », entre groove électronique, esthétique funky, nappes vaporeuses et pop soulful, et qui retranscrivent bien l’univers d’un groupe à deux facettes qui se complètent parfaitement. On pourrait d’ailleurs dire de cette dualité qu’elle est totale puisqu’elle se ressent tant dans leur musique que dans l’histoire qui lie les deux artistes.
Car les deux membres du duo Haute, Anna Magidson et Romain Hainaut, étaient décidément faits pour se rencontrer. Après une enfance passée en Californie pour la première et à New York pour le second, c’est dans la même rue de Montréal que ces deux Français emménagent et dans la même université (Mc Gill) qu’ils étudient tous les deux la musique et la philosophie. Les coïncidences ne s’arrêtent d’ailleurs pas là : en 2010, ils rentrent finalement en contact via un groupe musical sur Facebook (créé par Romain), et commencent à partager leurs affinités musicales… sans jamais s’être rencontrés.
Cette rencontre, elle se fera finalement par hasard à 5.500 km de chez eux, à Paris, alors que les deux jeunes gens sont en vacances chacun de leur côté. C’est à l’occasion de ce premier rendez-vous qu’Anna et Romain réaliseront qu’il est grand temps pour eux de rentrer en studio ensemble, ce qu’ils feront à Paris, par l’intermédiaire de Diez Music, pour enregistrer leur premier titre « Down ».
En 2016, le destin, encore lui, cogne une nouvelle fois à leur porte, en les invitant à venir présenter au grand public « Rêverie », titre qui sera sélectionné pour devenir la signature sonore de la chaîne d’hôtels Sofitel, assurant au morceau une diffusion mondiale.
[youtube id= »rOEKnlQdNyM » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Aujourd’hui, leur dernier titre « Shut Me Down » constitue tant la suite logique que la synthèse de l’histoire de Haute. Blasé et Anna créent en symbiose : ils écrivent, composent, partagent, enregistrent et font vibrer chaque morceau à deux. Une alchimie que l’on retrouve donc sur le morceau « Shut Me Down » et qui nous a séduits. On vous invite d’ailleurs fortement à suivre le duo dans le futur, car tant de signes du destin ne peuvent être ignorés. En attendant, on vous laisse découvrir la version live du morceau sur la plateforme contemporaine Colors Berlin.
[youtube id= »mmWr0rXeeh8″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Sources » class= » » id= » »]
© Article de Chloé Lecerf pour Cyclones Magazine
© Article de Tawfik Akachar pour Villa Schweppes
© Photo à la Une par Louise Carrasco