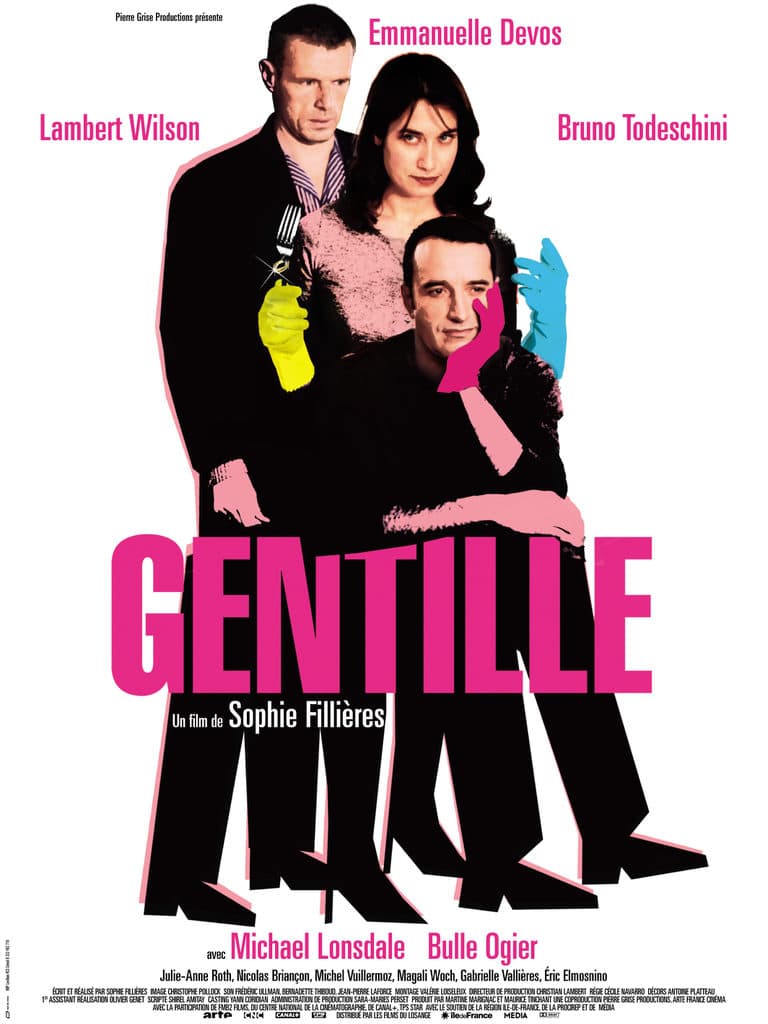Agnès Varda nous a quittés le 29 mars. Face aux images de sa vie, elle revient sur son parcours, ses combats, et répond aux questions de Pierre Michel.
Agnès Varda, c’est 64 ans de cinéma, 01 coupe au bol, 12 longs-métrages, 17 documentaires, 14 courts-métrages, 03 Césars, 01 Palme d’Honneur, 01 Oscar d’Honneur.
Agnès Varda, c’est aussi trois métiers : cinéaste, photographe et plasticienne… C’est aussi « Cléo de 5 à 7 », « Les 101 Nuits de Simon Cinéma ». Agnès Varda, c’est des visages, des villages, mais aussi des plages, Knokke-le-Zout, Sète ou Los Angeles. Agnès Varda, c’est une rue, Mouffetard, un chat… enfin, deux chats, un jardin à Bruxelles, deux enfants dans une cour intérieure Rue Daguerre, Paris 14ème.
[arve url= »https://vimeo.com/256883028″ align= »center » title= »Agnès Varda : « Cléo de 5 à 7 » (1962) » description= »Agnès Varda » maxwidth= »864″ /]
« Pialat m’a fait naître, et Varda m’a fait exister. » (Sandrine Bonnaire)
En fin d’année dernière, un hommage lui était rendu au Festival International du Film de Marrakech. Et fin 2017, un Oscar d’honneur lui était décerné, récompense qu’elle est la première femme réalisatrice à recevoir : « Ce qui est impressionnant chez Varda, c’est qu’elle a plusieurs vies de cinéaste. » (Frédéric Bonnaud, Directeur de la Cinémathèque Française)
Pour quelqu’un qui ne voulait pas vraiment faire carrière, vous vous êtes plutôt pas mal débrouillée ?
« Ça n’est pas du tout une histoire de se débrouiller… Ça n’est pas moi qui ai cherché les honneurs. Dans mon petit discours aux Oscars, j’ai presque fait rire, en disant que je n’avais jamais fait gagner d’argent à aucun producteur. Mais mes films existent, c’est un fait. Ce sont mes films qu’ils ont récompensés. Et évidemment, j’en suis très fière. »
[youtube id= »QXsBmlc9sBA » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Petit flash-back. Nous vous retrouvons en 1964, quand un journaliste vous pose une question qu’il avait aussi posée à Jacques Demy, votre mari : « Jacques Demy nous a dit que pour lui, le bonheur était une donnée qu’il fallait défendre, et que la dramatisation du bonheur, c’était la défense du bonheur ». Et pour vous ?
« C’est drôle… Non, pour moi, c’est un cadeau, le bonheur. Je veux dire par là que ça vient en plus. Vous avez des gens qui ont en eux tous les éléments du bonheur et qui ne sont pas heureux. Et vous avez des gens qui n’ont pas de quoi être heureux et qui le sont. »
« C’est ce que je disais à cette époque. Mais ça reste vrai. Même à l’âge que j’ai et avec les difficultés que je connais, ressentir des instants de bonheur, ou un peu plus que des instants, c’est un don qu’on a ou qu’on n’a pas… Ça peut être presque rien, une rencontre, un paysage, et d’un coup, on est habité par la beauté du monde. Et moi, j’ai le bonheur d’avoir ce don… »
Ça n’est pas votre seul don, d’ailleurs… Vous êtes une filmeuse, une filmeuse de femmes, mais pas que… Vous les avez filmées en noir, en blanc, de profil comme de face. Vous les avez filmées hautes en couleur et en musique. Les femmes, vous les avez montrées jeunes, vieilles. Vous avez filmé des femmes démunies, voire dénudées, en chair comme en pierre. Alors une question : est-ce que vous pensez faire un cinéma de femmes, ou tout simplement être une femme cinéaste ?
« Je pense être une cinéaste, qui est femme. Il y a des hommes qui font de très beaux films sur les femmes, et il y a des femmes qui parlent des femmes, si elles veulent. Je ne suis pas dans les ghettos, moi… Je suis pour un cinéma actif, inventif. »
Parlons réalisation, maintenant. Quand vous avez commencé au sein de la Nouvelle Vague, au milieu des Truffaut, Chabrol, Rivette ou Godard, vous étiez la seule femme, et pourtant vous avez déclaré : « métier d’homme, ça ne veut rien dire… Un métier d’homme, ce serait un métier qu’une femme ne peut pas exercer, et ces métiers, il y en a vraiment peu… » (Agnès Varda, 1978)
« Les metteurs en scène, ils ne font rien. On leur demande juste d’être sur le coup, on leur demande de penser au film et d’avoir une vision aigüe. » (Agnès Varda, 1964)
« Il faudra faire face dans très peu de temps à un phénomène complètement naturel, à savoir quand il y aura autant de femmes cinéastes que d’hommes cinéastes. » (Agnès Varda, 1978)
Alors, en 2019, et pour n’en citer que quelques-unes, nous avons donc les Emmanuelle Bercot, Valérie Donzelli, Maïwenn, Catherine Corsini, Agnès Jaoui, Julie Delpy, Houda Benyamina, Céline Dorski, Noemi Lowski, Claire Burger, Jeanne Herry, et quand on voit toutes ces femmes, ça vous inspire quoi ?
« Ça me fait vraiment plaisir. Quand j’ai commencé, il y avait déjà des femmes qui travaillaient. Moi, je me suis retrouvée dans la lumière, parce que j’ai fait quelque chose de tellement radical que j’ai été classée dans la Nouvelle Vague. Maintenant, je suis un peu la potiche des femmes cinéastes. On me met souvent devant, un peu trop, d’ailleurs, parce que parmi ces femmes-là, il y en a qui ont vraiment beaucoup de talent. »
Comment on en vient à croiser la route de Jim Morrison ?
« On avait un ami commun. Lui aussi avait fait ses études de cinéma à UCLA. Et comme Jacques Demy et moi, on représentait les petits nouveaux de la Nouvelle Vague, parce que ça n’était pas encore arrivé à Los Angeles, et comme on a commencé quatre ou cinq ans avant Spielberg, Coppola et toute cette génération de réalisateurs, Jim était content de faire notre connaissance. Quelques années plus tard, il s’est installé à Paris et on se voyait, tranquillement. Il venait dans ma cuisine, on discutait, avec Jacques. Mon regret, c’est de ne jamais avoir fait de photo de lui, ni à Los Angeles, ni à la maison… Mais tous les gens l’embêtaient tellement avec ça. J’ai préféré malgré tout garder cette distance, ce respect. C’était un être exceptionnel. »
[arve url= »https://www.dailymotion.com/video/x1ht6xk » align= »center » title= »Agnès Varda : « Cléo 5 à 7 » : Extrait 2 avec Jean-Luc Godard et Anna Karina » description= »Agnès Varda » maxwidth= »900″ /]
On est de retour avec vous, Agnès Varda, et on avait un petit extrait de « Cléo de 5 à 7 » à vous montrer… Dans votre vie, il y a eu des femmes, mais aussi des hommes. Il y a eu vos compagnons, Antoine Bourseiller, le père de Rosalie, et bien-sûr Jacques Demy, votre mari, le père de Mathieu. Il y eut aussi des initiales célèbres, JLG pour Jean-Luc Godard, et JR pour… JR. Deux hommes aux lunettes fumées, même si dans votre premier long-métrage, JLG avait accepté de les enlever.
« Ça, c’est un sketch à l’intérieur de Cléo… J’avais peur que le sujet soit trop sérieux. Cette femme en danger de mort. Alors j’ai inséré ce petit clip au milieu. Et Jean-Luc et Anna, qui étaient adorables, ont accepté de le faire. Et puis Jean-Luc, je l’ai beaucoup aimé. On était très amis, Jacques Demy, Anna Karina, lui et moi. Puis on s’est perdu de vue, comme ça arrive souvent dans la vie. Avec Jean-Luc, on a failli se retrouver dans « Visages, Villages ». Il n’a pas ouvert la porte, mais je l’aime quand même. »
Si vous le voulez bien, on va arriver chez un jeune premier, Harrison Ford.
« Harrison Ford… Quand on l’a rencontré, on l’a trouvé tellement sympathique, intelligent. Jacques m’a demandé de faire des essais pour lui, parce qu’il voulait le mettre dans Model Shop avec Anouk Aimée. Et la Columbia a refusé, en disant que ce gars n’avait aucun avenir. Jacques était très déçu mais on est resté ami. Jacques Demy l’avait repéré, il avait confiance en lui et il était convaincu qu’il ferait quelque chose. Harrison a dit que ça l’avait aidé à patienter pendant quatre ou cinq ans, le temps qu’on lui donne sa chance, car il savait qu’un grand metteur en scène trouvait qu’il avait du talent. »
On retourne aux Etats-Unis avec votre documentaire « Murs, Murs » en 1982.
« Vous savez, c’est ma façon de faire du documentaire. Approcher au plus près le sujet. Là, le sujet, ce sont ces « murals » qui sont peints sur les murs. J’ai toujours été très curieuse des gens et de leurs oeuvres. J’ai fait ce documentaire très attentivement. J’ai passé plusieurs mois non seulement à trouver les murals intéressants, mais aussi à découvrir qui les avait réalisés. Il n’y avait pas d’intérêt pour ça à l’époque. Souvent, ils n’étaient même pas signés. Avec ce film, j’ai rendu aux auteurs leurs droits d’artiste. »
[youtube id= »zKGI5FMhQqE » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
35 ans plus tard, vous collaborez avec JR, et cette fois, vous faites vous aussi des murals. Et dans « Visages, Villages », c’est vous qui affichez en grand tous ces visages.
« Avec ce film, c’était l’idée qu’on en a marre de voir des gens qui ont toujours quelque chose à vendre. Alors qu’il faudrait plutôt qu’on mette à l’honneur des gens simples, des gens de la rue. Le facteur dans le film, c’est un exemple de ceux que j’ai envie de mettre en avant. Si j’ai encore envie de filmer, c’est pour capturer des moments, des instants avec des gens simples, qui n’ont pas forcément beaucoup de choses à dire, mais qui dans leur comportement, dans leur rapport à l’autre, sont beaux. »
Agnès Varda s’en est allée et nous a laissés sans Varda… Au revoir et merci…
Propos recueillis par Pierre Michel pour Tchi Tcha