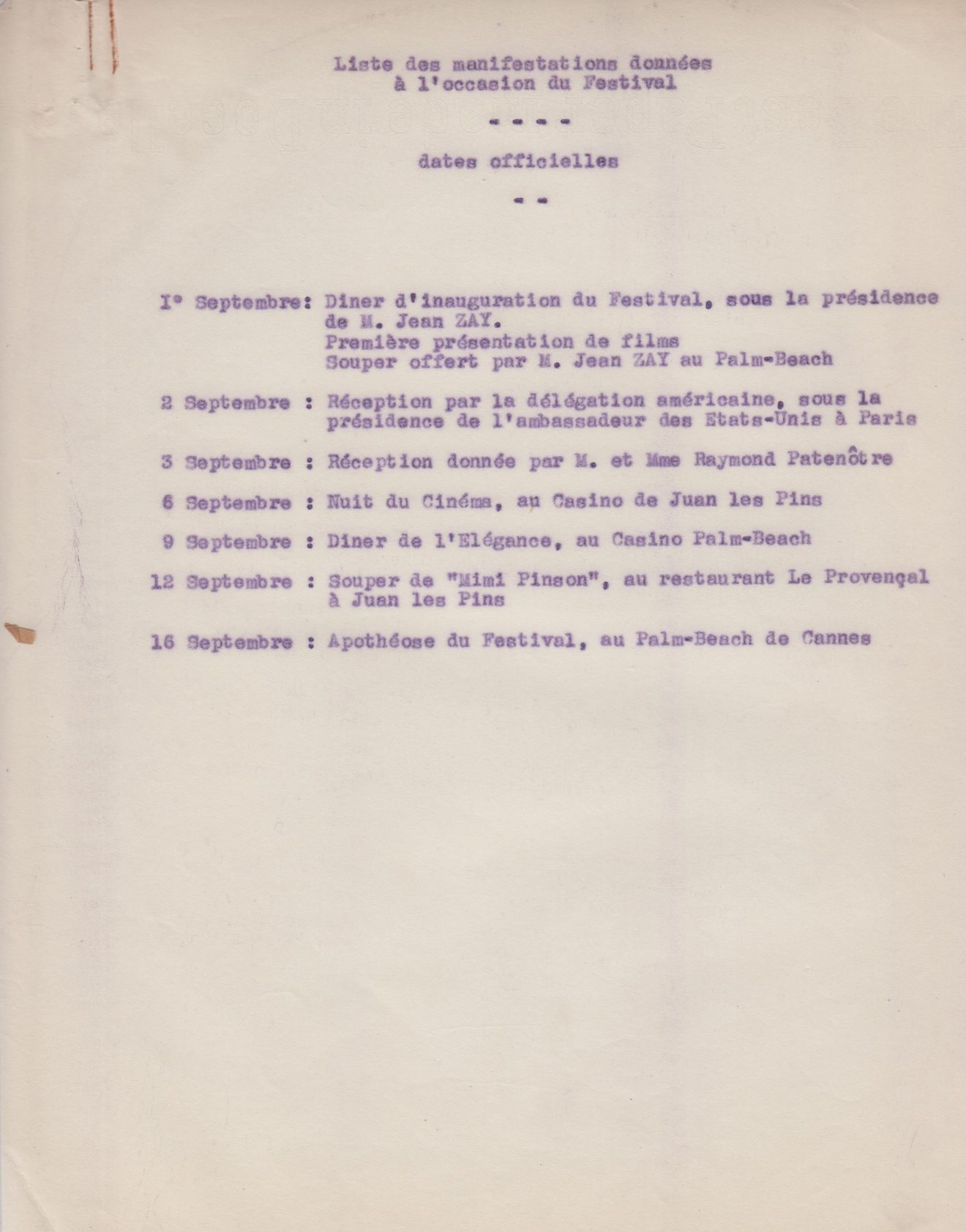Avec « The Neon Demon » sorti en 2016, Nicolas Winding Refn n’a définitivement pas fini de magnifier nos cauchemars en susurrant à l’oreille des démons…
Depuis la sensation « Drive », ses scènes d’action ultra-violentes et l’hyper masculinisation de Ryan Gosling, arborant un blouson avec un scorpion brodé au dos, puis avec la castration du même Gosling dans « Only God Forgives », son film suivant dans lequel le héros blond à l’œil passablement vide devient le jouet de sa mère dans un Bangkok fantasmé, le réalisateur Nicolas Winding Refn n’en finit pas de brouiller les pistes et nos certitudes en des tours de passe-passe singuliers. Un glissement où la représentation absolue du mâle finit, avec ce dernier opus « The Neon Demon », par devenir une femme incandescente, souveraine et elle aussi toujours aussi dangereuse.
Ces trois films forment ainsi une trilogie autour d’une réinvention des années 80, avec une esthétique, des motifs et un son empruntés à cette époque. A l’instar de Wong Kar Waï, Michael Mann, David Lynch, Brian De Palma, ou encore d’un Dario Argento, Nicolas Winding Refn se sert de ses illustres modèles pour à son tour livrer sa perception d’une idée ou deux qu’il utilisera comme prétexte afin de toujours nous raconter un peu le même film. « Drive » avec le polar, le film de vengeance, le cinéma. « Only God Forgives » avec le thème de la mafia, du film noir. Quant à « The Neon Demon », il nous parle du monde de la mode, de la beauté comme vecteur de ce milieu, de la jeunesse comme Nivarna à reculons, de vampirisme, de cannibalisme et de cinéma d’horreur. Des thématiques que le réalisateur de la trilogie « Pusher » va décliner comme autant de reflets et d’éclats de miroir.
« The Neon Demon » n’est cependant pas une critique de la mode, de son monde ou de ses représentations, pas même encore une vision de la femme, de l’argent, des apparences, de notre société ou de son nihilisme. Non, c’est un trip étrange et maniéré, sophistiqué à l’extrême, sidérant, somptueux, où y apparaissent dans des ambiances toujours plus 80’s les fantômes de films cultes de cette époque. « Looker », « Suspiria », « Les Prédateurs »… Los Angeles est le parfait écrin pour signifier la ville ultime de tous les pêchés, tel un aimant à fantasmes, à désir et à mort. Ville monde-cimetière où des harpies mettent en charpie pour s’en repaître d’innocentes victimes qui découvriraient trop tard ce qui exalte la beauté.
Si le réalisateur danois de Branson exhume autant de splendeurs cinématographiques venant des eighties, en les agitant sans vergogne dans ce film en un patchwork stylisé, il sait qu’il n’abîme ni ces modèles d’antan, ni ce qu’il tricote aujourd’hui. Le tout forme un poème visuel et vénéneux, une ode fait de lumière aveuglante et d’ombres inquiétantes. Mais en aucun cas, on nous sert un film prétentieux ou poseur. Paradoxalement, il s’agirait plutôt pour Nicolas Winding Refn de son film le plus drôle et le plus léger de toute sa filmographie.
Le score de Cliff Martinez (probablement l’un de ses meilleurs depuis celui de « Solaris ») hypnotise les images. Là aussi, le compositeur de « Drive » et « Only God Forgives » convoque toutes les sonorités 80’s, électroniques, inquiétantes et luxuriantes, rappelant ainsi Tangerine Dream, Vangelis, Carpenter. Des sonorités flottantes au grès des scènes, comme des îlots… « The Neon Demon » est un archipel perdu dans cet océan amniotique, mais sans eau. Juste du sang. Un sang convoité par des bouches avides et cruelles.
[youtube id= »lBYf1ALkpVc » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Dévoreur Hubertouzot
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Hubert Touzot : Photographe dévoreur d’images