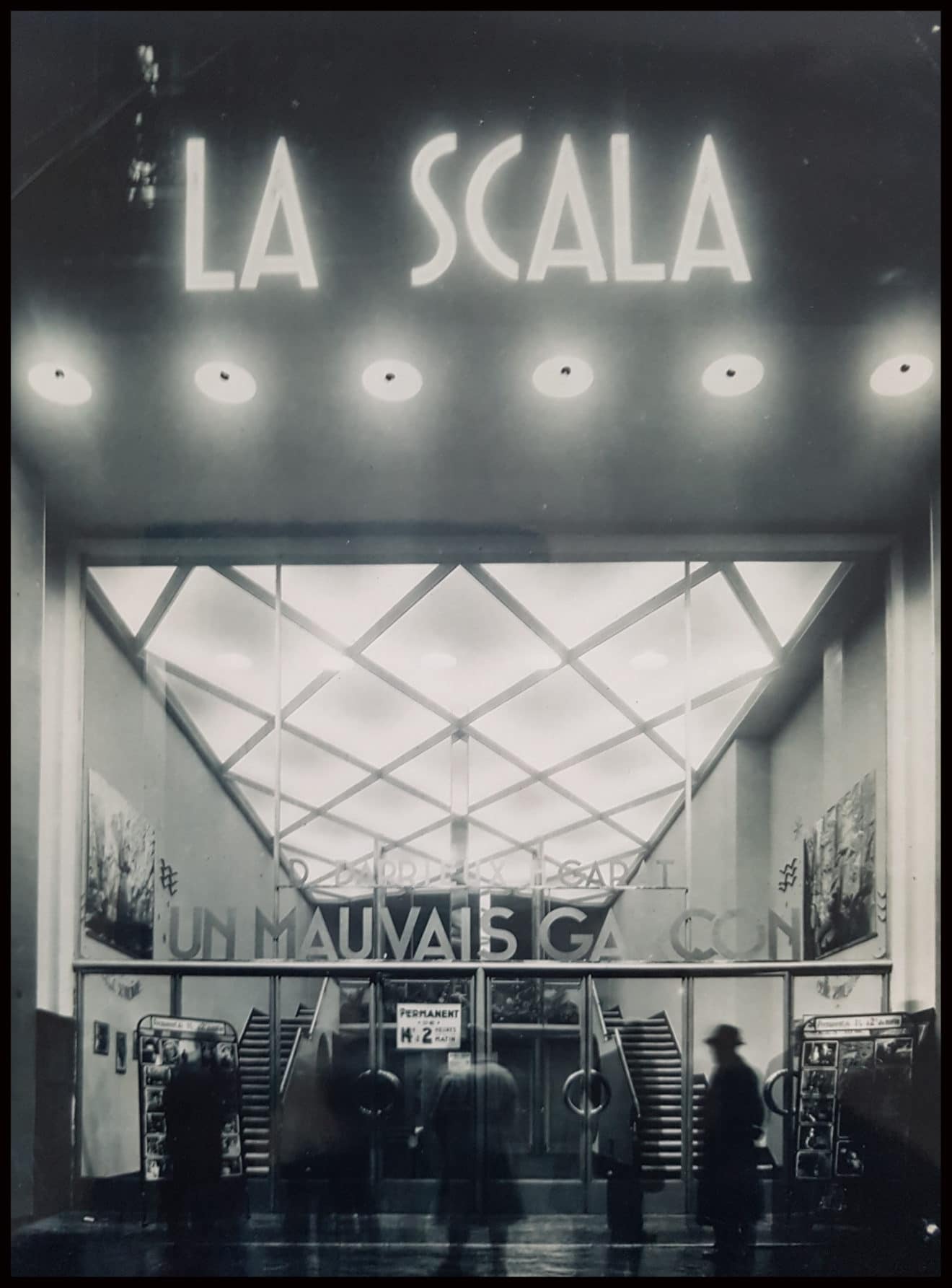Si l’on osait la comparaison, l’empire de Mickey serait un gros globule blanc. Disney qui, depuis le rachat de Pixar en 2006, n’a de cesse que de phagocyter tout ce qu’il acquiert, nivelle tout ce qui devient sa propriété, pour proposer ensuite des produits de contrefaçon juste bons à servir eux-mêmes d’outils de communication, avec comme objectif ultime d’écouler du produit dérivé à la tonne.
C’est d’ailleurs la même bonne vieille recette qui est utilisée depuis toujours par Disney pour ses parcs d’attractions, où pour cinq minutes de fun (je ne compte pas l’heure de queue avant…), vous êtes obligés de passer deux heures dans un supermarché de jouets et goodies, posé là, sur votre chemin vers la sortie, dans le seul but de vous faire les poches un maximum et d’engraisser toujours un peu plus toute cette cynique entreprise.
Walt Disney n’a plus rien à dire, si tant est qu’il eut par le passé déjà quelque chose d’intéressant à raconter. Ou alors il y a bien longtemps… Car il est vrai que ce parangon de l’animation de long métrage, dite de prestige, s’est finalement fait rattraper par des concurrents bien plus pertinents, au début des années 80, comme Don Bluth, dissident et ancien collaborateur émérite de la souris gloutonne, très vite disparu après juste une poignée de films d’animation qui ne rapportèrent pas assez d’argent.
Mais c’est surtout au Japon, avec le Studio Ghibli, le pendant asiatique de Disney, d’une richesse thématique inouïe, chez qui poésie, lyrisme et messages emplissent le moindre celluloïd, que les limites du géant américain se révèleront au grand jour. Miyasaki va élargir la brèche et oser rivaliser avec malice avec Disney, en nous proposant des films inoubliables.
[youtube id= »imtdgdGOB6Q » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
C’est pourtant bien avant cela qu’il faut pour le muridé vorace (terme encyclopédique pour désigner une souris, bande d’incultes…) trouver d’autres paysages à envahir pour redéfinir son image. Bref, se repositionner pour ne plus jamais perdre la main. Des cerveaux se sont mis à réfléchir…
Dès les années 50, Mickey se lance dans le long métrage live, avec des propositions toujours aussi niaiseuses, qui rencontrent cependant un relatif succès, surtout sur son continent d’origine. Mais il faudra attendre 1964, avec le triomphe de « Mary Poppins », pour prétendre au succès mondial, en jonglant sur les deux médiums. Rester roi de l’animation tout en devenant le roi du cinéma de divertissement familial, avec des œuvres techniquement ébouriffantes et jamais vues.
En essayant de sortir un peu de son carcan guimauve et familial, la firme de l’oncle Picsou va ainsi traverser une période assez longue et douloureuse, s’essayant à ses propres films d’animation originaux, comme « Taram et Le Chaudron Magique » et surtout en live avec « The Black Hole » en 1979, qui tente de surfer sur le succès mondial d’un fameux « Star Wars » (tiens tiens…). Le film est un énorme bide et ébranle même sérieusement tout l’édifice de fromage entassé depuis la création de Disney en 1923.
Car le Trou Noir arrive trop tard et même si sa direction artistique semble intéressante, toute l’entreprise pèse trois tonnes. C’est un gros truc balourd et statique venu d’un autre temps. Et Disney est complètement à côté de la plaque… « Star Wars » a révolutionné le genre, en proposant, en plus des vaisseaux spatiaux et des robots, la vitesse et en introduisant dans ces récits technologiques de l’aventure et du serial. Quant à George Lucas, il a su mélanger avec brio différents thèmes et histoires pour retranscrire à un moment charnière ce que les gens rêvaient de voir sans l’espérer.
[youtube id= »DIw76J_nVMs » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Inutile de préciser que Mickey l’a mauvaise… Mickey est revanchard. Et Mickey est tout rouge… Soit, si l’empire aux grande oreilles, coloré, sucré et souriant en apparence, ne peut prétendre à surprendre et cartonner avec ses propres créations, alors il rachètera un après l’autre tous ceux qui pourraient devenir des concurrents et surtout constituer des mannes en devenir ; des créateurs de légendes, en somme. Là où pour l’instant la souris cupide n’avait su que dépoussiérer les contes d’Andersen, des frères Grimm ou d’autres écrivains européens oubliés, il lui faut désormais s’approprier de vraies mythologies Yankee, celles dans lesquelles le peuple américain se reconnaîtra sûrement. Mickey, totalement mégalomane, veut devenir le maître du monde…
Robert (dit Bob) Iger, le nouveau PDG de The Walt Disney Company depuis 2005, lance alors une implacable offensive. Et Disney va désormais dévorer tous ceux qui pourraient faire de l’ombre à la petite souris… A commencer par Pixar en 2006, puis Marvel Studios en 2009 ; toute son écurie de super-héros (ou presque) en fait d’ailleurs les frais. Mais il faudra attendre 2019 pour que la souris obèse croque également l’indéboulonnable Twenty Century Fox, et puisse user jusqu’à la corde la franchise des X-Men, préservée jusqu’à ce funeste jour dans le giron des célèbres studios. Ne reste finalement plus que Spiderman, toujours chez Sony-Colombia, que les Japonais ne veulent pas offrir en pâture au rongeur ogre (tiens tiens (bis)…).
[youtube id= »WfV-0Yv5vNY » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Mais c’est sans doute avec la vente de LucasFilm que le choc sera le plus retentissant. Abandonnant son bébé, George Lucas, homme d’affaire avisé avant d’être le visionnaire que l’on veut naïvement croire, devait bien savoir que sa lointaine galaxie allait échoir dans des mains peu scrupuleuses. Mais Lucas traîne son enfant depuis 1977, connaissant un inégal succès, certes, mais surtout beaucoup de déconvenues, de cris et de larmes chez l’entité monstrueuse qu’il a créée sans le faire exprès et dont il a totalement perdu le contrôle, à la merci d’un public fanatisé qui voit en « Star Wars » sa nouvelle religion. Ainsi, pour échapper à diverses fatwas et reprendre une vie normale, loin du tumulte de la foule haineuse qui a élevé la saga au rang de finalité de vie, Lucas accepte de vendre le package et ses emmerdes avec.
Pourtant, en signant le contrat en 2012 pour la modique somme de 4,05 milliards de dollars, notre George préféré reçoit encore de la part de ses acheteurs toutes les scrupuleuses attentions relatives à la ligne éditoriale des prochains opus, des séries pour la télé et autres histoires issues de la célèbre saga. Même les ébauches de scénarios pour d’éventuelles suites, soit les futurs épisodes VII, VIII et IX, déjà plus ou moins couchées sur le papier par Lucas, sont fournies dans le cadre du rachat, ainsi que Kathleen Kennedy, déjà présidente de LucasFilm. Tous les cadres de la souris enragée et revancharde jurent sur leurs mères et leurs enfants réunis, ainsi que sur la tête de Tata Rachel, que « Star Wars » sera respecté, aimé et qu’il ne lui sera jamais fait aucun mal.
Huit années plus tard… Dans une galaxie pas très lointaine, en Californie précisément, « Star Wars » est aujourd’hui dans le bien piètre état qu’on lui connaît. Non seulement les pontes de Disney n’en ont eu strictement rien à fou… faire de ce que Lucas souhaitait pour la suite de ces aventures spatiales et intersidérales, mais de surcroît, ils ont fait exactement ce que l’on pouvait redouter. A savoir « Marveliser », ripoliner notre saga préférée, la rendre tiédasse à souhait. Bref, « Star Wars » est devenu « Les Cochons Dans L’Espaaaaaaaace »…
Inutile de revenir sur le piteux épisode VII et son manque flagrant d’audace et de nouveauté, tout ce contre quoi Lucas s’était toujours battu. En produisant des « Star Wars », le réalisateur du mythique « American Graffiti » voulait, à chaque nouvel opus, repousser les limites techniques et offrir des spectacles toujours plus novateurs. Même si George Lucas n’a jamais été un génial réalisateur ou même un éminent scénariste, reste qu’il faut tout de même lui concéder un indéniable talent de conteur, de mixeur brillant, pour faire se télescoper des concepts et des images inédites. Mais là, c’est la douche froide… Non seulement « L’Eveil de la Force » ne propose rien de nouveau mais cet épisode VII se paye en plus le luxe de réchauffer au micro-ondes des pans entiers de l’épisode IV, « Un Nouvel Espoir ».
On sait ensuite comment la gestion de cette nouvelle histoire et de ses personnages va être malmenée dans l’épisode VIII, où le nouveau réalisateur ne semble pas s’être spécialement intéressé aux fondations de cette nouvelle trilogie. Cependant, même si « Les Derniers Jedi » divise (et c’est un euphémisme), il faut quand même reconnaître à Rian Johnson son sens de l’ampleur et une certaine ambition de cinéma, qui font depuis toujours cruellement défaut chez J.J. Abrams. « Les Derniers Jedi », à défaut d’être cohérent avec la mythologie « Star Wars », propose, essaye, tente des pistes. Le film et son réalisateur deviennent pourtant, après Eric Zemmour, ce qu’il y a de pire au monde…
[youtube id= »wY708Ky2SG8″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Et force est de constater que tout cela fleure bon l’amateurisme général et cette façon désinvolte de traiter par dessus la jambe un tel monstre de l’inconscient collectif. Les histoires paraissent écrites au fur et à mesure, sans qu’il n’y ait de réelle vue d’ensemble. Le réalisateur Colin Trevorrow, censé boucler l’ultime épisode, est remercié et remplacé au pied levé par ce cher J.J. Abrams (encore…), qui réécrit finalement toute l’histoire. On est bien là en train de parler de « Star Wars », hein !! Pas de « Plus Belle La Vie », entre l’épisode 450, 451 et 452. Ok ??
Alors en attendant cet ultime épisode IX qui va sortir dans quelques jours, on nous promet depuis plusieurs mois, à grand renfort de bandes-annonces, de teasers, spots TV en pagaille, de théories de geeks, d’images et d’interviews de tel ou tel intervenant, tous plus rassurants les uns que les autres, que cette fois-ci, ça y est, ça va être fou et que l’on va tous faire « sploutch » dans nos slips ou « sprooch » dans celui des filles…
Mais le petit souci, en fait, c’est que depuis l’épisode VII, ni l’histoire, ni ses enjeux, ni ses méchants, ni rien d’ailleurs, n’offre un quelconque intérêt, une éventuelle surprise. « Bon les gars, notre méchant a été tué dans l’épisode VIII… Il nous reste quand même encore un épisode à torcher. Il nous faut un autre méchant… Bon, des idées ? Plait-il, J.J. ? faire revenir l’empereur ? Mais il n’était pas mort ? Quoi ? tu t’occupes de tout ? N’oublie pas que tu n’as que deux mois pour ficeler un scénario… Ca ira quand même ? Ok, cool, yeap ! »
[youtube id= »pHgwf2eMFnA » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Alors oui, c’est par réflexe Pavlovien que l’on va courir comme des sots encore cette fois-ci, parce qu’on se dit : « Eh, Starouarz quand même ! ». Effectivement, il y eut bien un petit miracle avec « Rogue One », le premier crossover, soit un épisode qui ne rentre pas dans la série officielle, mais qui s’y raccroche quand même pour combler certains trous laissés ça et là… Le film, tout en étant plaisant, offrait un autre aspect de l’univers, moins édulcoré et plus sombre, plus mélancolique. Quant à « Solo », le film conçu justement autour du personnage de Han Solo… Ce fut non seulement une purge mais de surcroît un énorme bide au box office mondial (ouf). On pensait que cela allait faire réfléchir un peu tous les zombies aux commandes et à la manœuvre ? Que nenni…
La mini-série appelée « The Mandalorian » est également un infâme brouet fan-service, avec en prime toutes les peluches kro-kro mignonnes vues dans les films de la série. Avec cette impression qu’à chaque nouvel épisode (beeen oui, parce que le gros fan de Starouarz, même s’il critique, ne manque pas un seul épisode, tellement hypnotisé qu’il est…), le producteur de ce programme a en fait placé des caméras dans la chambre de son fils, qui joue à la « Guerre des Etoiles » avec toutes ses figurines et ses vaisseaux. Et on grossit à peine le trait, tant le scénario s’avère être à peu près de ce niveau-là…
Alors, pour ce qui est de « L’Ascension de Skywalker », que souhaiter ? Comme le dirait Georges Abitbol dans « La Classe Américaine » : « Ce flim n’est pas un flim sur le cyclisme… ». Car ces nouveaux Star Wars ne sont pas des films, comme ils n’ont finalement rien à voir avec le cinéma. Ils ne tentent rien, ne proposent rien, n’essayent rien. C’est le degré zéro de l’invention. Ce que Disney veut avant toute chose, tel un nouvel empire qui souhaite transformer le monde à son image, c’est que personne ne bronche. Il veut juste servir au public ce qu’il attend. Ne surtout pas le brusquer, ni l’étonner. Oh non, surtout pas l’étonner !
Starouarz, ce sont ces Chipsters chimiques qui proposent encore et encore de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs, oignon, barbecue, fromage, etc… mais qui restent de vulgaires Chipsters, car c’est tout ce qu’on leur demande, après tout, dans ce monde Disneyien…