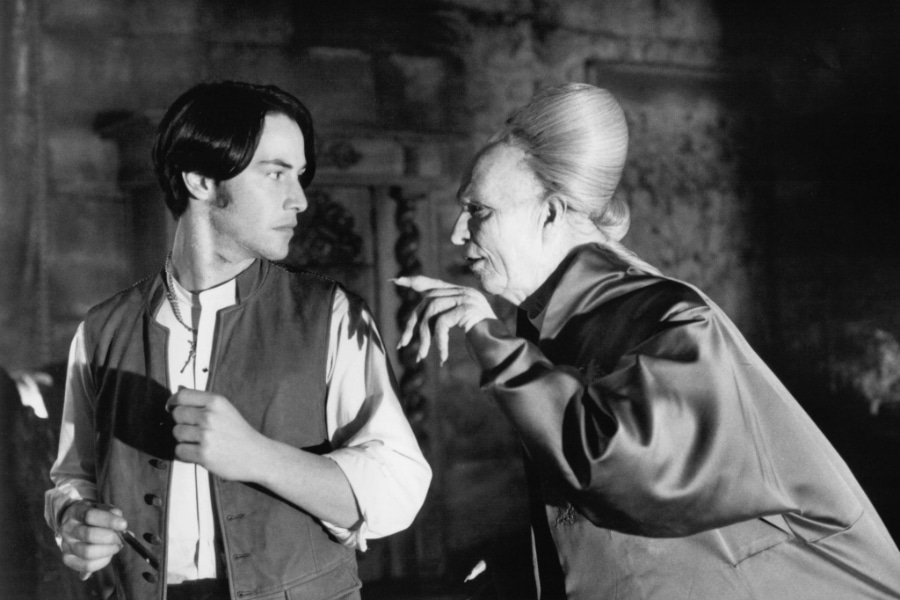La Fête…
« 5ème Avenue, 5 heures du matin, Audrey Hepburn, Diamants sur canapé et la genèse d’un film culte » par Sam Wasson – Sonatine Editions – 2010 (Extraits)
Le tournage n’a duré qu’une semaine à New-York. Le temps des scènes chez Tiffany et de quelques extérieurs. Tout le reste du film fut tourné à Los Angeles dans les studios de la Paramount. On dit que miss Hepburn aurait amené pas moins de trente-six valises ainsi que son mari, Mel Ferrer et leur fils de dix mois, Sean. On logea toute la petite famille dans une maison de Coldwater Canyon.
25:17 : La fête bat son plein.
Pour filmer la scène de la fête, Blake Edwards a l’idée d’en organiser une vraie, pour mettre les acteurs « en condition ». Rien de tel pour filmer « sur le tas » de vraies scènes de comédie hilarantes. Il s’agissait de laisser libre cours au naturel. Cette petite sauterie dura pas moins de huit jours pleins. Blake Edwards voulait de vrais acteurs pour cette scène, pas des figurants. C’est ce qu’il avait demandé au bureau de casting. Pas de grands acteurs, non, mais des acteurs de seconds rôles qui seraient capables, le moment venu, de tourner plusieurs prises d’une situation cocasse observée durant la fête. « Convaincre le studio de rémunérer des acteurs jusqu’à 125 dollars par jour quand les figurants sont beaucoup moins chers ne fut pas facile à négocier ». Il fallut une semaine, du 2 au 9 novembre, à Blake Edwards pour avoir la matière suffisante à une scène qui durerait 13 minutes dans le film. Il fallut également engager une chorégraphe, afin que chaque morceau de fête, chaque personnage mis en avant, chaque scène soit organisée et les déplacements orchestrés.
Blake eut certaines idées, comme celle du téléphone dans la valise, du fou rire devant la glace ou de la douche. D’autres fois, il demandait aux acteurs d’improviser, comme pour la scène de la dispute. Ou encore, les idées étaient saisies au bond, comme celle de tenir ses chaussures à la main lorsqu’on a trop mal aux pieds. Blake Edwards avait organisé une vraie fête, et comme dans toutes les fêtes, certains acteurs avaient des coups de barre qui étaient filmés au vol. Une autre fois, Georges Peppard pinça les fesses de Joyce Meadows qui dansait moulée dans une robe blanche. Elle poussa un cri et la scène fut enregistrée. On ne savait jamais à quoi s’attendre !
La scène de la chute, quant à elle, faillit tourner au drame. « Cette fois c’était l’actrice Dorothy Whitney qui s’y collait ; elle interprétait Mag Wildwood et devait tomber directement devant l’objectif en gardant les bras le long du corps. Cette pitrerie fut un véritable cauchemar pour l’actrice. Elle était terrorisée. – Je n’y arrive pas, je n’en suis pas capable ! Disait Dorothy. Blake a insisté jusqu’à ce qu’il obtienne gain de cause. » Il a fallu plus de treize prises.
Quand Audrey Hepburn arriva sur le plateau numéro 9 de la Paramount début du mois de novembre 1960, la fête battait son plein depuis déjà plusieurs jours. 540 litres de thé glacé et de Canada Dry, de la viande froide, des sandwichs, plus de 60 cartouches de cigarettes et 20.000 dollars de frais de production. « Il y avait du monde partout ! ». On avait fait venir un enfumoir à abeilles pour recréer l’ambiance enfumée d’une fin de soirée. Audrey était coiffée d’une choucroute énorme parsemée de mèches blondes décolorées. « Entre les scènes, elle était douce, modeste et gentille avec tout le monde. Certaines stars regagnent leur loge entre les prises, mais pas elle. »
La scène fut une réussite. A tel point que Blake et le scénariste Tom Waldman décidèrent d’en faire tout un film : c’est comme ça qu’est née l’idée de « La Party ».
[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Ciné Cinéma Facebook