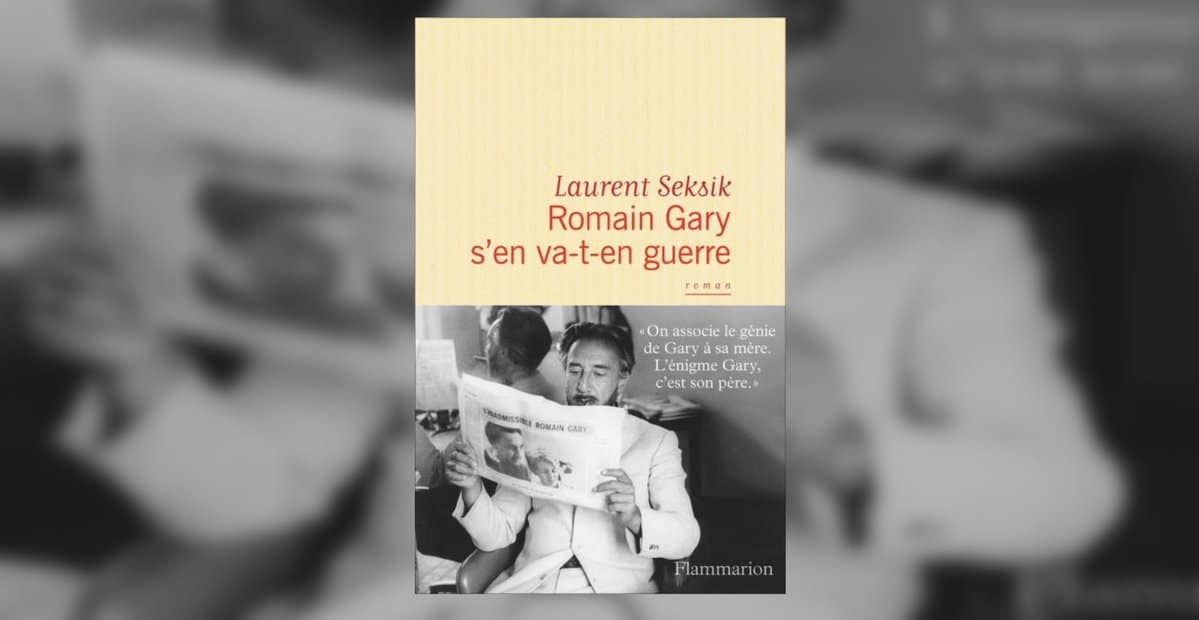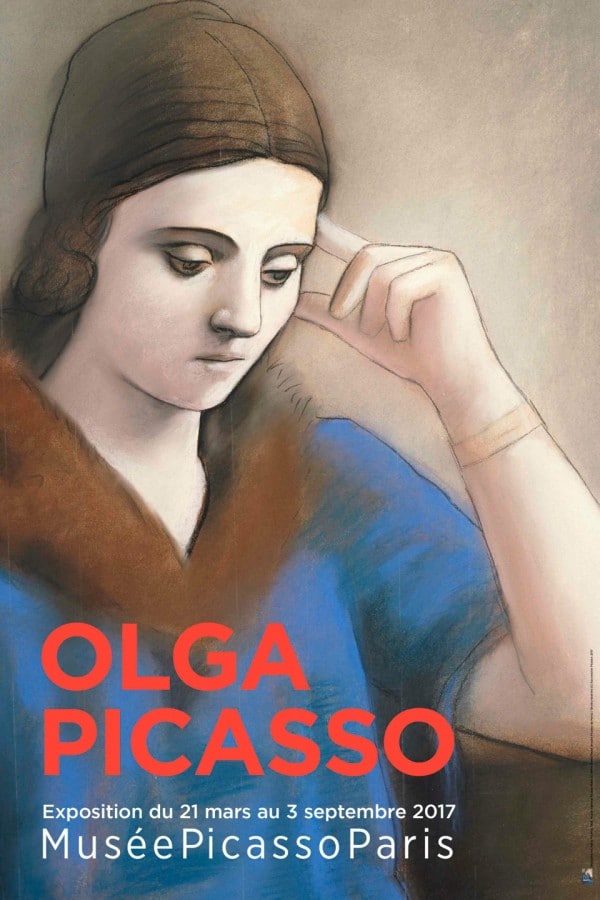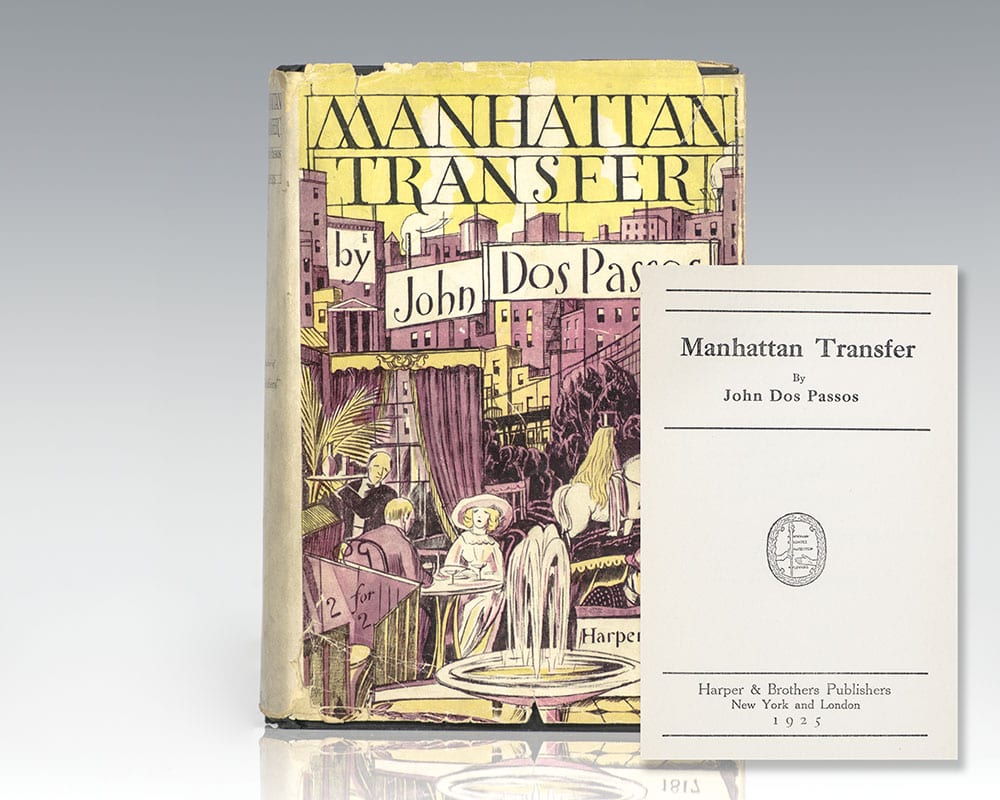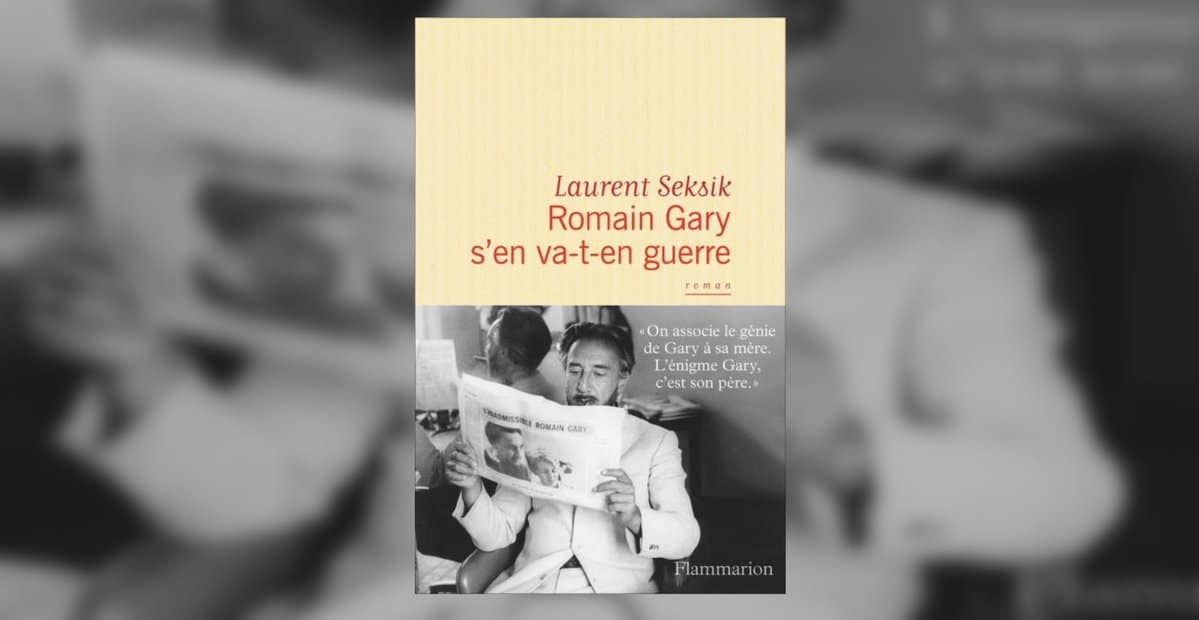À l’occasion de la publication de « Romain Gary s’en va-t-en guerre » de Laurent Seksik, revenons sur la vie et l’oeuvre du diplomate et romancier français originaire de Lituanie.
Il est l’homme aux deux prix Goncourt et aux multiples identités. Romain Gary, alias Emile Ajar, de son vrai nom Roman Kacew, double prix Goncourt, d’abord en 1956 pour « Les Racines du Ciel », puis en 1975, sous un autre nom, Emile Ajar, pour « La Vie Devant Soi », naît à Vilna, en Russie, en 1914 (Aujourd’hui, Vilnius en Lituanie).
Aviateur, diplomate, mais surtout écrivain à la fécondité exceptionnelle, capable d’écrire plusieurs ouvrages en même temps, Romain Gary a livré une oeuvre littéraire drôle, tendre et humaniste.
Romain Gary, c’est une vie marquée par sa relation avec sa mère. Quant à son père, il va abandonner la famille pour épouser une autre femme, avoir d’autres enfants, avant de mourir dans le ghetto pendant la guerre.
Rencontre avec Laurent Seksik, qui vient tout juste de publier « Romain Gary s’en va-t-en guerre », Myriam Anissimov, sa biographe, auteur de « Romain Gary, le Caméléon » (Editions Folio), et Joann Sfar qui a illustré « La Promesse de l’Aube » en 2014.
« Gary se levait tôt, il descendait vers 7h00 du matin, dès que les bistrots ouvraient. Ils les faisait tous, en écoutant toutes les conneries que les gens disaient, les notant minutieusement en mangeant un oeuf dur. Puis il remontait chez lui et travaillait jusque midi, une heure. » (Myriam Anissimov).
« Gary écrit puissamment. C’est un flot, c’est une colère, c’est ininterrompu. Puis il y a des redites, il répète beaucoup les choses. On sent le diplomate rompu à l’écriture de mémos, qui a l’habitude de composer une littérature efficace, qui a une grande connaissance du cinéma et du roman américain, et qui pour se purger, se détendre ou faire plaisir à sa maman qui n’est plus là, écrit du roman. » (Joann Sfar)
Sa maman, justement, il en fait une des plus belles héroïnes littéraires dans la « Promesse de l’Aube » publiée en 1960. Ce que cette femme a d’intéressant, c’est qu’elle est une héroïne sans homme, toute entière dévouée, peut-être pas intrinsèquement au bonheur de son fils, mais plutôt à l’avénement d’un fils roi.
« J’ai écrit la Promesse de l’Aube pour m’exorciser, pour me débarrasser du fantôme de ma mère, qui vécut à mes côtés pendant quinze ou vingt ans, et qui semblait encore demander quelque chose. Aujourd’hui, je me sens beaucoup plus libre, Je me suis, comme on dit, affranchi… » (Romain Gary en 1960)
Romain Gary a réussi à échapper au cadre très rigide du roman français traditionnel, pour introduire dans la littérature française quelque chose de nouveau, à savoir l’idée de l’émigré, avec la notion de métissage entre les cultures française et juive, yiddish d’Europe orientale, plus précisément.
Il y a chez Gary, outre cette poésie et une façon peu commune de décrire les sentiments, les émotions ou les personnages, en les esquissant, cette forme d’humour, humour juif, humour du désespoir, plein de tendresse.
Aviateur dans les Forces Françaises Libres pendant la Seconde Guerre Mondiale, voyageur et diplomate, Romain Gary ancre les thèmes de ses romans dans l’actualité du monde. En 1956, avec « Les Racines du Ciel » récompensé par le prix Goncourt, il livre l’un des premiers récits écologiques. Autre exemple avec « Chien Blanc » en 1970, sur la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis, et contre le racisme. Autant de sujets qui n’ont rien perdu de leur pertinence.
« Chien Blanc préfigure Donald Trump. Quand on parle de l’actualité de Gary, tout ce qu’il dit sur l’Europe, sur la montée des périls ou sur l’Amérique, résonne aujourd’hui de façon totalement hallucinante. » (Laurent Seksik)
C’était un humaniste, un homme profondément généreux qui aimait les autres hommes, mais aussi les femmes. Il en parlait d’ailleurs comme on en parlait peu à l’époque, comme des égales, des partenaires, aussi bien sur le plan amoureux que plus généralement dans la vie.
En 1975, Romain Gary invente Emile Ajar, pseudonyme sous lequel il va remporter un second prix Goncourt pour « La Vie Devant Soi ».
« Il a voulu se débarrasser de Romain Gary pour qu’enfin, on le lise vraiment. Il se plaignait toujours qu’on ne le lisait jamais. Tout roman de Gary relève du doute. Il a mis tellement d’énergie à raconter des mensonges qui lui plaisaient, à s’inventer un personnage qui lui convenait. Il a décidé que le roman, c’était finalement plus important que l’existence. Quand on prend cette décision-là, on peut finir un jour avec le canon d’un fusil dans la bouche. » (Joann Sfar)
En 1980, Romain Gary décide donc de mettre fin à ses jours. ll eut cette phrase avant de se supprimer : « Je me suis totalement exprimé ». Comme pour Gary, il n’y avait que le roman qui importait, on peut imaginer qu’au moment de commettre l’irréparable, il eut le sentiment de s’être totalement exprimé sur le plan romanesque.
Romain Gary est un génie, même si le terme peut paraître aujourd’hui quelque peu galvaudé. Déjà par le fait que c’est un auteur qui est extrêmement facile à lire. Et puis il y a cet humour irrésistible allié à un sens de l’auto-dérision poussé à son paroxysme… De ce point de vue, « Gros Câlin » est probablement le roman dans lequel l’humour de Gary, allié à un sens inné du surréalisme, est le plus jubilatoire. Oui, Romain Gary est un humaniste. Et finalement, est-ce que ce n’est pas ça, réussir sa vie ?
Profitez de la sortie de « Romain Gary s’en va-t-en guerre » pour aller jeter un oeil à « La Promesse de l’Aube » illustrée par Joann Sfar. C’est magnifique…