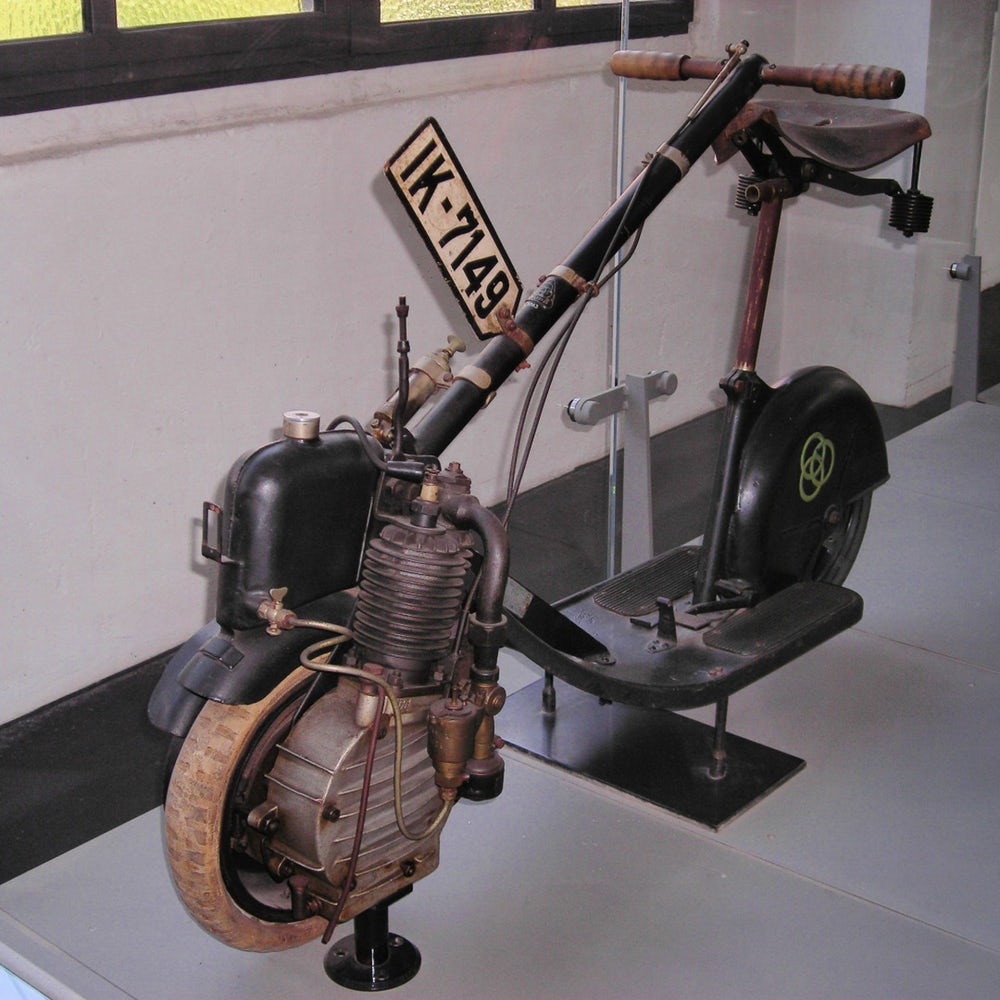Notre fin de civilisation n’en est pas à un paradoxe près…
Une société où plus personne n’est censé mourir de faim, où l’abondance et la diversité des aliments se trouvent même jusque dans les containers à ordure des grandes surfaces qui préfèrent jeter que de redistribuer (mais ça c’est un autre débat).
Pourtant, il existe une religion, avec ses croyances et ses pratiques radicales, qui n’est pas le salafisme ou une de ces doctrines orthodoxes monothéistes connues. Il s’agit de ce royaume étrange de la mode et de ses sortilèges.
Un monde parallèle fait de luxe, d’exception et de beauté, qui de petits ateliers et de salons cramoisis pour belles bourgeoises d’avant-guerre, se mua décennie après décennie en un concept commercial qui finalement réussit à se fondre dans notre vie de tous les jours.
Des Saint Laurent, des Courrèges, des Cardin, ont voulu démocratiser les belles étoffes et les finitions savantes pour vendre plus mais surtout faire de la couture un produit de pop culture, accessible… Cette révolution, d’abord noble et candide, engendra des monstres que sont aujourd’hui les H&M et autres Zara. Les petites structures artisanales d’antan qui faisaient travailler des couturières émérites ne sont plus.
Les grands groupes textiles ont piétiné les valeurs de la confection et du savoir-faire pour embrasser la mondialisation en se nourrissant tel l’ogre de petits enfants, chair à canon, pour gagner sans panache cette guerre globale de l’anéantissement des valeurs morales et humanistes.
Cyniques ou aveugles, nous acceptons sans broncher, heureux d’acquérir ces vêtements ersatz à moindre frais, en prenant soin de ne pas penser aux petits bras s’attelant à la tâche à l’autre bout du monde en échange d’un salaire de misère… Et c’est sans compter ces artificiers que sont les publicitaires et les départements marketing pour rediriger la foule anonyme vers de nouveaux besoins. Mais là encore, c’est toujours un autre débat.
Il aura fallu certes du temps mais nous y sommes, en plein dedans. Ce fameux futur Orwelien où tout est devenu slogans, tels des litanies martelées à longueur de journée et reprises en cœur par toutes celles et ceux qui ont le pouvoir de les relayer. Au cinéma, à la télévision, dans la presse et les magazines.
Ce monde hermétique rempli de falbalas, devenu finalement le dieu suprême à vénérer, avec ses rituels, ses obédiences et ses fidèles. Ce monde devenu triste mais où on nous oblige à être beaux, souriants, légers, en commençant par tous ceux qui deviennent célèbres et riches et qui doivent impérativement être sûrs d’eux, drôles, attrayants et minces, oui minces, toujours plus minces, en rêvant à l’épaisseur d’une feuille de papier comme but ultime à atteindre.
Cette idée de la minceur comme une victoire sur la vie ou une revanche sur toutes nos frustrations existentielles mutées en obsessions quasi journalières, où l’on préfère désormais porter un pantalon en taille 32 que de se nourrir convenablement. Arborer une silhouette osseuse, famélique, flottant dans une veste XS avec une pomme et un bouillon comme seul repas de la journée.
Cette fixation sur la maigreur, après avoir supplanté celle de la minceur, est vécue donc comme une normalité, soit une règle absolue, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, et maintenant même pour les enfants. Pour vous en convaincre, les mannequins hommes vus dans les derniers défilés Vuitton, Balenciaga ou Rick Owens, arboraient des visages crayeux, les yeux fiévreux, les pommettes du visage comme des lames.
On se souvient aussi de la silhouette osseuse et blanche de David Bowie dans le film « L’Homme Qui Venait D’ailleurs », période albums « Station To Station », « Low » et « Heroes », quand une abondance de cocaïne le faisait ressembler à un grand cadavre exsangue.
Regardez-les, tous ces cintres mouvants sur les podiums comme dans la rue, qu’un simple courant d’air peut balayer de la surface de la terre. Voici donc cette image démultipliée qui représente si bien cet univers qui prend tous les jours un peu plus des couleurs de fin du monde, absurde, violent, grotesque et dément.
… Et ces êtres décharnés si bien habillés, superposant la hype et les tendances, qui se frôlent dans la rue avec d’autres êtres devenus quant à eux obèses et monstrueux, à force d’ingérer toutes les heures de la journées du gras et du sucre. Spectacle de « Freaks » que n’aurait pas renié Tod Browning.
Cette anorexie collective triomphante s’invite jusque dans les restaurants des grands chefs où il est formidable de dépenser une fortune pour se faire servir des assiettes immenses et vides, où l’aliment lui-même est remplacé par des formulations pompeuses déclamées par des maîtres d’hôtel taillés comme des épingles et qui vous regardent sournoisement si vous avez le malheur de demander si le plat choisi est copieux.
Quand on sait que le premier à avoir exigé cette maigreur chez les modèles hommes ou femmes s’appelle Hedi Slimane, lui-même physiquement étranger au concept de nourriture. Relançant la mode du « Slim », cette silhouette post Punk-Rock de la fin 70 et du début 80, lorsque beaucoup des figures populaires ou underground de cette époque naviguaient toutes entre Héroïne et Cocaïne, avec à la clé une fin prématurée.
Cette vision romantique mais morbide d’une époque ou d’un courant musical qui est devenue avec tous ces directeurs artistiques, à commencer par celui de la marque Saint Laurent, une norme standard. Karl Lagerfeld a succombé également à ce chant des sirènes pour se transformer en une poupée effrayante tout droit sortie d’un épisode des « Sentinelles De L’Air ».
Pas un vêtement acheté dans la grande distribution qui désormais ne sera pas « Slimy », ou soit veste étroite, chemise resserrée à la taille et pantalon tube. Les ventres et les bourrelets sont donc cruellement recalés. Régime et sport sont devenus obligatoires pour chacun d’entre nous, si nous ne tenons pas à encaisser chaque jour de petites phrases assassines, ou même de simples regards accusateurs sur nos parties de corps incriminées.
On se croirait vivre sur une terre, à l’instar du film « Body Snatchers », où nos différences risquent de se retourner contre nous à tout moment et où il serait tellement plus simple de devenir comme tous les autres, dans une uniformisation confortable et sereine, ces autres qui s’échangent un petit sourire et un mouvement de tête entendu lorsqu’ils se croisent.
La tyrannie du beau, du mince, du maigre, du lustré, du sans poil, instaurée par tous ces gens qui gravitent dans un univers où on ne vit décidément pas comme le tout un chacun.
Des moutons de Panurge, des veaux, c’est ce qui définit le reste d’une société anxieuse de pouvoir devenir aussi comme l’un de ces mannequins de 16 ans vu dans une revue, ou même encore pouvoir ressembler à un acteur de cinéma qui pour les besoins d’un film doit perdre 15 kilos en deux semaines et voir son corps devenir hyper musclé à grand coup de stéroïdes, d’injections et d’endoctrinement coachisé 24 heures sur 24.
Ceci n’est pas la réalité. Ceci n’est pas réel. Pourtant, comme un pied qui ferait du 44 et qui à l’aide d’un chausse-pied voudrait absolument rentrer dans une ballerine en 38, nous sommes obnubilés par ces silhouettes filiformes qui nous entourent, dans un cauchemar qui a déjà commencé.
Autrefois, les femmes plus girondes portaient des corsets, puis plus tard des gaines pour affiner la taille. Aujourd’hui, pour paraître aussi plates que des limandes, les plus riches se font enlever des côtes, liposucer… On transforme son corps, on le modifie, on le travestit, on le profane à la gloire de cette déité païenne. Des romanciers comme J.G. Ballard avaient vu juste sur le devenir de l’être humain.
Quant à nos rêves de voyage dans les étoiles, il est peu probable que cela nous soit permis un jour, tant toutes nos pensées sont réduites, recroquevillées sur l’inconséquente et insignifiante petite enveloppe qui nous sert de corps. Cette science fiction qui nous faisait tellement rêver enfant est réduite à bien peu de chose…
Sous tous ces prétextes fallacieux du « bien vivre », du « saint, équilibré, léger », à grand renfort d’écrans, de caméras et d’objectifs nous scrutant en boucle, de montres au poignet qui contrôlent, surveillent tous nos faits et gestes, le nombre de marches montées et les calories perdues, nous perdons à vitesse grand V tout ce qui restait d’humanité en nous. De trop nous regarder dans ces miroirs magiques pour nous rassurer sans arrêt quant à la perfection de notre dentition blanche et parfaite, nos muscles si bien dessinés, notre coupe de cheveux si réussie, nous devenons aussi lisses que ces surfaces réfléchissantes, aussi transparents qu’une vitre, aussi vides qu’un courant d’air. Oui, nous disparaissons ainsi de la surface de la terre. Nous nous effaçons.
Et il ne reste que des os et de la vanité…
[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Dévoreur Hubertouzot
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Hubert Touzot : Photographe dévoreur d’images