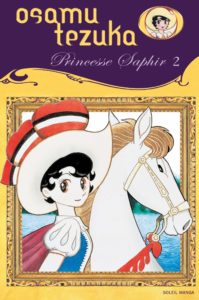« Ghost in the Shell » est le titre anglophone d’une œuvre de science-fiction de Masamune Shirow, publiée entre 1989 et 1991, et qui donna lieu par la suite à de nombreuses déclinaisons, le plus souvent réussies. Afin de célébrer dignement le trentième anniversaire de la franchise de cyberpunk nipponne qui a popularisé le genre dans le monde entier, au point de devenir la référence ultime du genre dans la pop-culture de science-fiction, un tour d’horizon de « Ghost in the Shell » ainsi que des thèmes qu’elle aborde s’impose…
Ghost in the Shell: Solid State Society
Ce téléfilm de 90 minutes datant de 2006 est en fait la suite de la seconde saison, et conclut les sujets mis en suspens lors de la saison précédente.
On apprend dans ce film dont l’action se déroule en 2034 que le major Motoko Kusanagi a quitté la Section 9 et travaille désormais à son compte. « Solid State Society » relate une nouvelle enquête, entre usurpation d’identités, enlèvement d’enfants et vol de ghosts, impliquant un mystérieux hacker surnommé le Marionnettiste (Puppeteer ou Puppet Master en Anglais). Le major au visage de poupée de porcelaine rejoint finalement la Section 9 dirigée par Togusa, qui travaille sur la même affaire. Le téléfilm « ressuscite au passage les Tachikoma, dont la mémoire avait été sauvegardée (ou quand l’informatique permet des ficelles scénaristiques…).
Le staff pour ce téléfilm à gros budget est le même que celui des deux saisons de « Stand Alone Complex » et Yōko Kanno en signe de nouveau la bande originale. A noter que les scénaristes profiteront de ce téléfilm pour faire résoudre des intrigues en suspens depuis la deuxième saison par leurs personnages, mais en amenant au passage de nouvelles interrogations et en faisant de nombreux clins-d’œil aux films de Mamoru Oshii.
[youtube id= »YQfVEUaPmKc » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Ghost in the Shell: Arise
Cette série de 2013 se déroule en 2027, et il s’agit en fait d’une préquelle de toutes les saisons qui la précèdent. On y retrouve ainsi une Motoko plus jeune et plus nerveuse. Son physique la fait ressembler à une adulte à peine sortie de l’adolescence, et son caractère est encore « en construction », tout comme son corps cybernétique différent de sa version manga (et par extension de sa version dans « Stand Alone Complex »). Dans une série de cinq OVA d’une heure, on suit les aventures d’une Section 9 tout juste formée par le gouvernement. On assiste dans « Ghost in the Shell: Arise » à la construction progressive des relations entre les divers personnages. Par exemple, les décisions d’Aramaki y sont contestées par ses subordonnés, alors qu’il est au contraire très respecté dans les autres œuvres.
On note toutefois dans cette série quelques incohérences, comme le fait de voir tous les membres de l’équipe déjà présents depuis un certain temps, voire un temps certain, tandis que Togusa était présenté comme un « bleu » dans « Stand Alone Complex ». De plus, pourquoi donner cet aspect « adolescent » à Motoko, alors que le postulat de base de la saga nous la présente comme une militaire accomplie et que, de surcroît, son passé avait déjà été dévoilé dans « Ghost in the Shell: The Stand Alone Complex, 2nd Gig », où elle avait déjà un corps d’adulte ?
Pour cette nouvelle saison, le staff est différent, même si c’est toujours Production I.G qui est aux manettes. L’aspect graphique des dessins est toujours aussi bluffant, mais les réflexions métaphysiques sont moins présentes et le récit fait plus place à l’action et aux manœuvres politiques que dans les autres séries. Cela n’empêche cependant pas les morceaux de bravoure, comme l’affrontement entre la Section 9 et une horde de robots lancée à sa poursuite. Côté technologie, on découvre les prédécesseurs des Tachikoma, les Logikoma, de taille beaucoup plus imposante et moins sophistiqués, montrant la progression de la technologie entre les différentes séries.
[youtube id= »yP7KAeqK2kM » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Ghost in the Shell: The New Movie
Ce film fait suite à « Ghost in the Shell: Arise » et tente de réinventer le contexte de la franchise, tout en conservant les fondamentaux, ce qui donne un sentiment de manque de continuité flagrant, même si Production I.G est de nouveau à la tête du projet, avec une animation toujours aussi bluffante.
Malgré ses qualités graphiques indéniables, cet opus ne convainc pas le public. Motoko et l’équipe ne semblent pas être les mêmes et surtout, on note une rupture nette avec les scénarios aux histoires complexes auxquels « Ghost in the Shell » nous avait toujours habitués.
[youtube id= »b5g1xubyuVs » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Ghost in the Shell, le film Live
Dans ce nouvel opus-événement de la franchise, l’actrice Scarlett Johansson incarne le Major Kusanagi. Et l’histoire prend délibérément le contre-pied de l’œuvre originale, en nous présentant le Major comme le premier cyborg intégral, avec la volonté affichée de rendre le personnage unique (pour le rendre plus impressionnant ? Ou bien Hollywood serait-il tombé dans le piège du « Special Snowflake » ?), tandis que les cyborgs intégraux pullulent et sont fabriqués en série dans le Manga originel comme dans le film de 1995 ou les différentes séries.
L’intrigue y est plus simple, voire simpliste, et certaines scènes ne font que reprendre ce que l’on avait déjà vu dans le film d’animation de 1995. Si vous attendez un scénario aussi peu manichéen que dans les séries et les films de Mamoru Oshii, alors passez votre chemin…
Dans ce long-métrage sorti en 2017, Motoko Kusanagi lutte contre un terroriste qui s’en prend à une société en particulier, car cette dernière, qui avait déjà fabriqué le corps du Major, a ensuite fait du terroriste le premier cyborg intégral. Mais le prototype est raté, contrairement au Major. Notre antagoniste principal a désormais comme objectif sa vengeance, pure et simple, ce qui l’éloigne sensiblement du caractère du Puppet Master du Manga originel, retors et calculateur.
Malgré cela, on notera une tentative assez maladroite, comparée à l’œuvre d’origine, de faire de notre Major préférée un personnage en quête d’identité. Elle apprendra qu’elle était à l’origine Japonaise (et s’appelait… Motoko Kusanagi), puisque cette fois l’action se déroule à Los Angeles, et que cette identité lui avait été cachée par la société qui en a fait une cyborg, après, bien-sûr, lui avoir lavé le cerveau.
Et sa quête d’identité ne commence qu’au moment où elle a des flash-backs. Bref, on retombe dans le cliché de la méchante-corporation-qui-manipule-tout-le-monde, et le questionnement de Kusanagi sur son identité et son individualité est rapidement abordé, sans la profondeur du Manga originel, voire du film d’animation de 1995.
Tout bien considéré, le scénario du film et la recherche d’identité du Major nous renvoient de manière assez évidente à l’intrigue du « Robocop » de Paul Verhoeven, sorti trente ans plus tôt, en 1987. En effet, Le personnage de Murphy y est cybernétisé par une entreprise (l’OCP), afin de servir dans les forces de police. Mais Murphy finit par partir à la recherche de son identité, après avoir découvert qu’on lui avait lavé le cerveau. Ce qui donne malheureusement au film avec Scarlett Johansson un sentiment de réchauffé désagréable à voir, tant l’oeuvre originelle est peu respectée.
La version 2017 de « Ghost in The Shell » ne rencontre finalement pas le succès escompté, malgré la présence de la star américaine, et certains n’hésitent pas à dire que pour une œuvre abordant les thèmes de l’âme et de la nature humaine dans un monde hyper-technologique, le film manque justement… cruellement d’âme, en passant à côté du sujet, pour simplifier l’histoire. Ce qui s’avère être l’erreur fatale des studios Paramount et Dreamworks, sachant que c’est la complexité de l’intrigue qui a fait la renommée du film de Mamoru Oshii et du Manga originel, avec une Motoko Kusanagi qui connaissait son identité depuis le début, même si elle doutait souvent d’elle-même. Tout ça passe à la trappe, pour donner ce bien pâle Robocop au féminin…
[youtube id= »G4VmJcZR0Yg » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Ghost in the Shell SAC_2045, la série Netflix
C’est la suite directe des séries « Stand Alone Complex » et du téléfilm « Solid State Society ». On y retrouve le même staff à la production, mais le dessin est désormais en 3D et les premières images que nous avons pu voir en 2020 étaient pour le moins décevantes, tant certains des personnages y sont méconnaissables. Les quelques extraits visibles l’année dernière dévoilaient aussi une animation au ralenti, là où la série 2D faisait des merveilles, en termes de fluidité comme de rapidité.
On a quand même la crainte d’un traitement de cette franchise identique à celui que « Les Chevaliers du Zodiaque » ont subi, avec cet aspect « playmobil » des dessins.
[youtube id= »Tf59gQWItJo » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Conclusion pour un océan de données pas si virtuelles
Faire un article sur « Ghost in the Shell » est une tâche ardue, tant le contenu des histoires est riche et fouillé (qui a dit fouillis ?). Et il y a tellement à dire que le risque est de finir par s’y noyer…
« Ghost in the Shell » puise ainsi dans les poncifs du genre Cyberpunk, tout en y apportant ses propres codes visuels, techniques et narratifs, dans un genre de science-fiction dont l’un des enjeux est de concevoir de l’anticipation dans un futur proche, d’où une très grande maturité dans les thèmes abordés par les différentes adaptations de l’œuvre de Masamune Shirow.
Mais la franchise-star démontre aussi que l’animation au Japon est désormais un média mûr et adulte, en abordant des sujets qui sont d’habitude propres aux histoires policières et d’espionnage. Car « Ghost in the Shell » ne se cantonne plus à la catégorie « œuvre pour enfants », au vu du sérieux des thèmes abordés. On peut ainsi constater que les fans occidentaux du Manga ont bien intégré cette réalité ; l’animation japonaise est dorénavant capable d’aborder tous les sujets, du plus enfantin au plus mature.
Pour en revenir à l’œuvre, si dans le Manga originel de Masamune Shirow, l’action se passe dans un futur proche, en 2021, soit trente ans après sa première publication, on devrait à présent plutôt évoquer un futur très proche… Certes, aujourd’hui, on ne croise pas (encore…) dans la rue de cyborgs intégraux comme dans « Ghost in the Shell », la technologie pour greffer un cerveau dans un corps mécanique étant encore science-fictive.
Il n’en reste pas moins que, d’un point de vue scientifique et technologique, il existe déjà depuis 2012 des prototypes de prothèses mécaniques commandées directement par les nerfs-moteurs des patients. Et la même année, une autre équipe de chercheurs avait réussi à redonner le sens du toucher à un patient amputé, toujours via une prothèse. Tout ça pour dire, ça n’est plus de la science-fiction.
Aujourd’hui, les deux techniques sont associées pour d’autres prototypes, rendant une partie du corps de nouveau fonctionnelle à la personne équipée, même si le coût de ces prothèses artificielles reste encore prohibitif. Mais il ne serait pas impossible que dans dix ou vingt ans, ce type de prothèses soit de plus en plus répandu. Et c’est ce qui fait du genre Cyberpunk et de « Ghost in the Shell » en particulier des œuvres qui nous interpellent.
Les mondes qui y sont décrits sont parfois bien proches du nôtre, notamment dans les relations entre entreprises et états, avec des sociétés devenues si puissantes qu’elles affichent un chiffre d’affaires parfois équivalent au PIB d’un état. Et ça, vous en conviendrez, ça n’est déjà plus de la fiction, avec les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple).
Avec l’évolution actuelle de la technologie et des réseaux d’information, particulièrement omniprésents avec Internet et les smartphones, on peut même se demander si le Web n’évoluera pas pour finir par ressembler au Net de « Ghost in the Shell ». Et on peut également se poser la question suivante : le Cyberpunk est-il un genre visionnaire ou ne fait-il qu’extrapoler, voire de broder sur ce qui existe d’ores-et-déjà ?
En constatant aujourd’hui la montée en puissance du mouvement transhumaniste, avec comme but ultime, en tout cas pour ses membres les plus extrémistes, de faire fusionner l’Homme et la Machine, on peut revoir « Ghost in the Shell » à l’aune de l’interrogation suivante : quelle est le rapport actuel entre l’Homme et la Machine, ou avec la technologie ? Car c’est bien cette question centrale que pose l’œuvre, en se nourrissant des symboles du passé et des inquiétudes du présent sur l’avenir.
Certes, il s’agit là d’un avis personnel, de surcroît à 200 % subjectif, mais s’il n’y avait qu’une seule œuvre à recommander dans le genre Cyberpunk, ça serait donc celle-là, tant l’univers décrit nous semble à la fois familier et éloigné. Et je recommanderais à tout fan de science-fiction de regarder la première saison de « Stand Alone Complex ». L’univers de Masamune Shirow y est parfaitement retranscrit par Kamiyama, même s’il y apporte sa propre touche. L’oeuvre du maître a offert au Cyberpunk la référence dont le genre avait besoin pour être connu d’un plus large public, en sortant du cadre strict des seuls fans de SF, et ce grâce à son approche de l’œuvre adaptée pour le petit écran, mêlant enquêtes policières et brigades d’intervention.
« Ghost in the Shell » est ainsi devenue une œuvre de science-fiction parmi les plus incontournables, en inspirant par exemple les frères Wachowski pour leur trilogie « Matrix », ou en bluffant James Cameron, lui qui ne tarit pas d’éloge lors de la sortie du film de 1995, en qualifiant l’oeuvre de Mamoru Oshii de visionnaire.
Alors, n’hésitons pas à nous plonger à corps perdu (ou nous replonger) dans l’univers de Masamune Shirow et les aventures de ces cyborgs, dans un monde entre chair et métal, entre traditions du passé et futur incertain, où l’individu se cherche, au coeur du flux de données réelles et informatiques.
« Ghost in the Shell, quand le cyberpunk du Soleil Levant devient une référence mondiale », c’est fini… Retrouvez prochainement de nouveaux articles consacrés à l’univers du Manga dans le Magazine Instant City…
[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Dans les Episodes Précédents » class= » » id= » »]
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Ghost in The Shell, la Saga – Partie 1
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Ghost in The Shell, la Saga – Partie 2