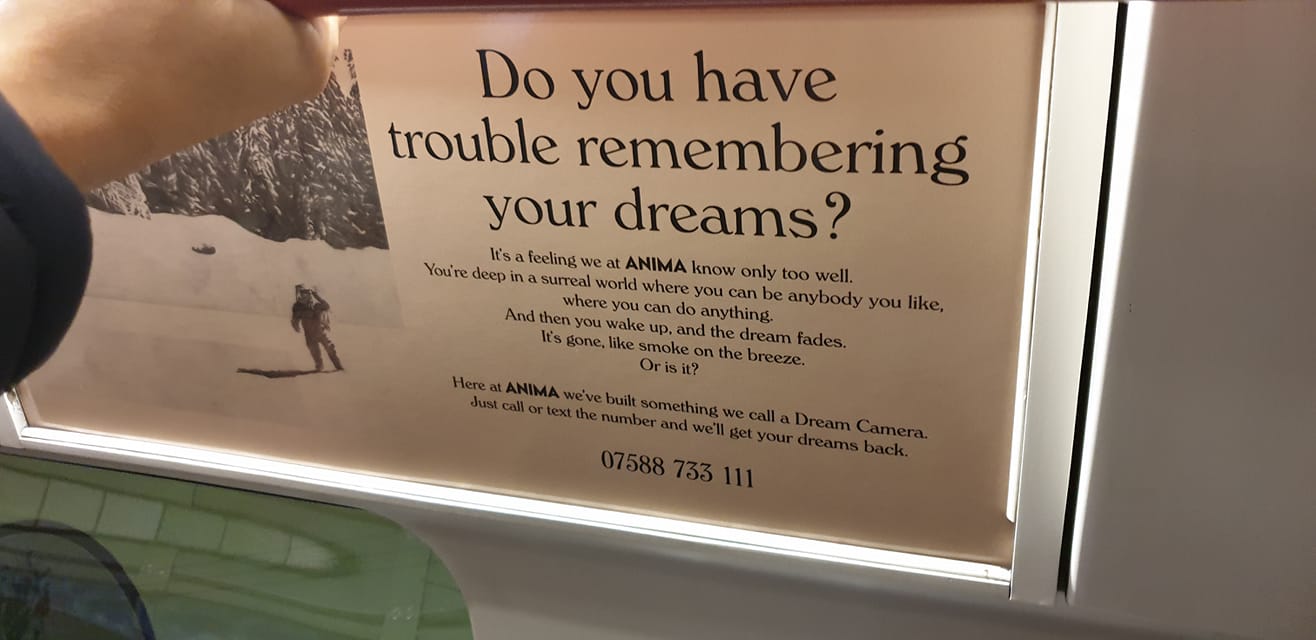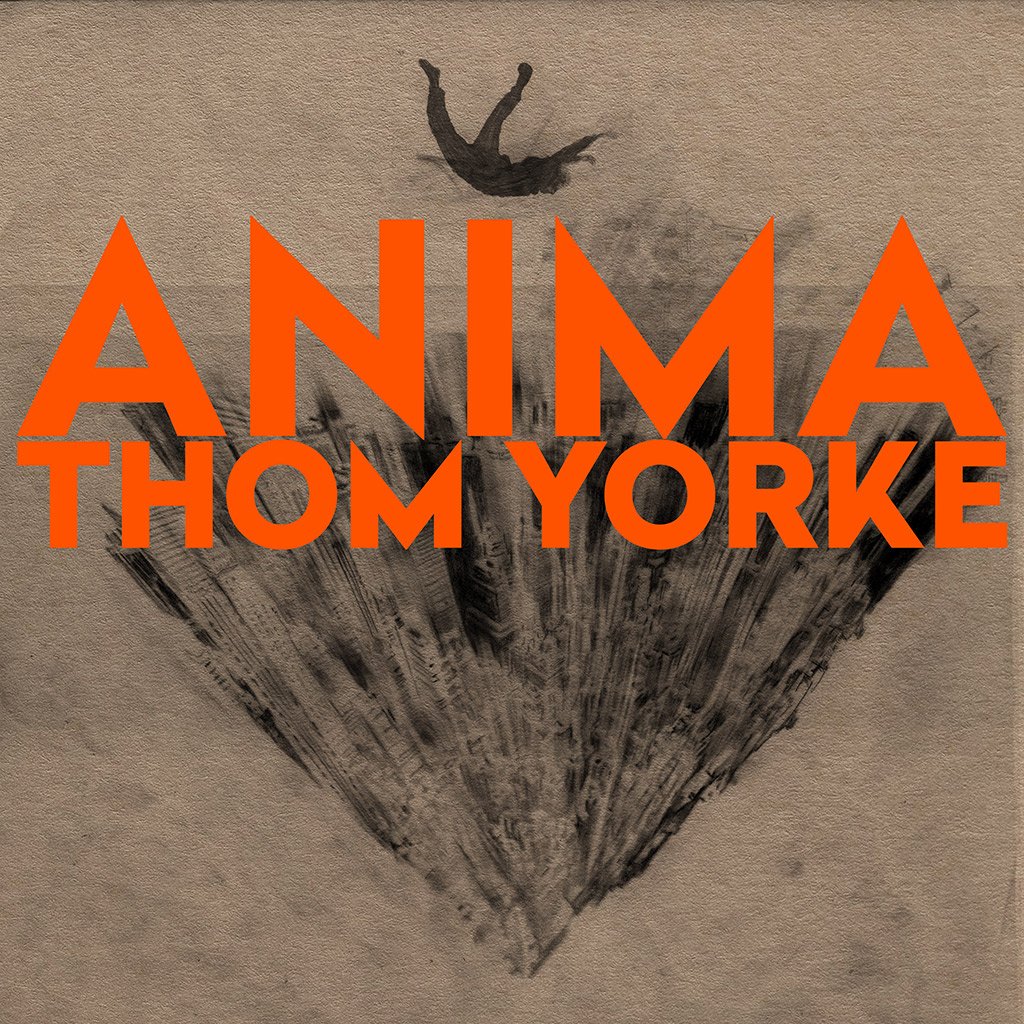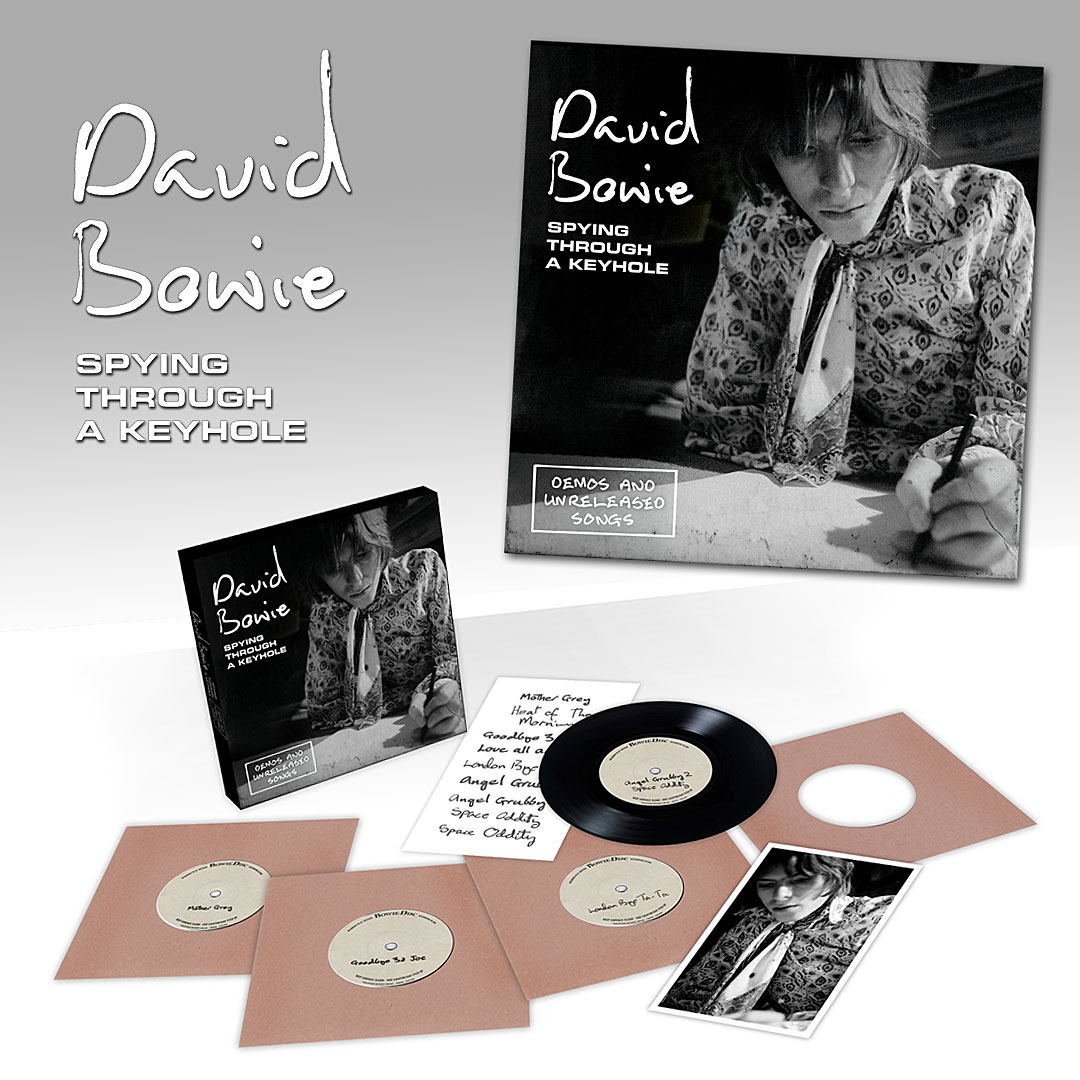En 2019, nous avons au moins trois bonnes raisons de célébrer Sergio Leone : les 90 ans de sa naissance, les 30 ans de sa disparition et les 35 ans du film considéré comme « plus grand que le cinéma », « Il était une fois en Amérique ». Retour sur la vie et l’oeuvre de l’immense réalisateur italien.
Si Sergio Leone (1929-1989) n’aura réalisé en tout et pour tout que sept films durant une carrière prématurément interrompue à l’âge de 60 ans, son influence est majeure dans l’histoire du cinéma, notamment par sa relecture du western. En inventant le « Western Spaghetti » il y a 55 ans, avec « Pour une poignée de dollars » sorti en 1964, il sut donner au genre tant des couleurs européennes qu’un second souffle, et révéla du même coup la star Clint Eastwood.
Aujourd’hui, trente ans après sa disparition, Sergio Leone est enfin reconnu, mais il a pourtant longtemps été un cinéaste très sous-estimé par l’industrie. Le mépris qui avait accueilli ses premiers westerns « Made in Italy » a ensuite fait place au profond respect qu’impose l’œuvre d’un véritable auteur ; Sergio Leone est devenu une référence incontestable, pour ses pairs, pour les cinéphiles comme pour le grand public, en ne signant que sept films qui auront marqué durablement notre imaginaire.
[youtube id= »OOxuXA2oviY » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
La route était déjà toute tracée pour Sergio Leone quand il naît le 3 janvier 1929, d’un père pionnier du cinéma italien, Vincenzo Leone, dont le nom de scène est Roberto Roberti, né le 5 août 1879 à Torella dei Lombardi, en Campanie, et mort le 9 janvier 1959 (à 79 ans) dans cette même ville, et d’une mère actrice, Edwige Valcarenghi, au pseudonyme de Bice Waleran. Premier signe du destin, ce père tutélaire réalisa le tout premier western italien, malheureusement perdu aujourd’hui, « La Vampire Indienne » sorti en 1913, avec son épouse dans le rôle-titre, le terme « vampire » désignant à l’époque une femme fatale.
Élève effacé dans une école religieuse de Rome, Sergio se retrouve étonnamment dans la même classe que son futur compositeur fétiche, auquel ses oeuvres resteront identifiées à jamais, Ennio Morricone. Second signe du destin… Celui qui deviendra son plus proche collaborateur et ami, lui rappellera d’ailleurs cette rencontre des années plus tard, Leone l’ayant oubliée.

Pionnier du cinéma italien, dont il devra pourtant s’éloigner dans les années 30, du fait de son aversion profonde pour le fascisme ambiant, Roberto Roberti parvient néanmoins à ouvrir les portes du 7ème Art à son fils Sergio, dès la fin de ses études, à 18 ans. Sergio Leone entame alors une interminable première partie de carrière d’assistant-réalisateur, qui durera de 1946 à 1962, avec notamment une série d’adaptations au cinéma d’oeuvres lyriques célèbres (Rigoletto, Il trovatore, La forza del destino…), réalisées par Carmine Gallone. Leone prendra soin plus tard d’occulter ces films de son esprit comme de sa biographie officielle (et pour cause, il n’était même pas crédité au générique…), alors que ses propres films afficheront ensuite une indéniable dimension lyrique.
Mais un film émergera pourtant de cette période, tant il marquera à tout jamais l’oeuvre de Sergio Leone. En 1948, il est assistant-réalisateur sur « Le Voleur de Bicyclette » de Vittorio De Sica. Il n’est toujours pas crédité au générique à ce titre, certes, mais fait une apparition furtive aux côtés de l’acteur Lamberto Maggiorani, en jeune séminariste s’abritant de la pluie. C’est selon Leone ce film qui sera le réel déclencheur de sa carrière.

Dans les années 50, lorsque les Américains décentralisent la réalisation de grosses productions à Cinecitta, notamment des péplums, Sergio Leone devient l’assistant (toujours non-crédité) de Robert Wise (« Hélène de Troie » en 1956), Fred Zinnemann (« Au risque de se perdre » en 1959), William Wyler (« Ben-Hur » en 1959, notamment sur la course de chars) et Robert Aldrich (« Sodome et Gomorrhe » en 1962), dont il quittera le plateau avant la fin du tournage pour cause de climat général quelque peu houleux…
Le péplum connaît alors son âge d’or, dans les années 50 et jusqu’au tout début des 60. Et Sergio Leone y contribuera largement, mais toujours comme assistant ; dès 1949, avec « Fabiola » d’Alessandro Blasetti, puis « Quo Vadis » de Mervyn LeRoy (1951), « Prynée, Courtisane d’Orient » de Mario Bonnard (1953), qu’il retrouve en 1958 sur « L’esclave d’Orient », avant « Sous le Signe de Rome » (1959) de Guido Brignone.
Désormais pleinement reconnu dans ce rôle d’assistant-réalisateur, Sergio Leone se voit confier la réalisation des « Derniers Jours de Pompéi », en remplacement de Mario Bonnard, malade. Il ne sera toujours pas crédité au générique, mais les compétences techniques acquises tout au long de ces seize années passées en tant qu’assistant-réalisateur lui confèrent une solide réputation et lui permettent enfin d’accéder en 1961 à sa première réalisation pleine et entière, encore un péplum, « Le Colosse de Rhodes ».
Le cinéaste confessera plus tard avoir eu un immense plaisir à tourner ce premier film sous son propre nom. Il y fait même quelques apparitions dans certaines scènes de foule…
[youtube id= »jh1hmDr11SY » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
« Pour un Européen de son âge, les États-Unis étaient le paradis. Et pour Leone, le cinéma était encore bien plus haut que le paradis… Dans une très belle interview qu’il avait fait pour la Cinémathèque française, quelqu’un lui demandait pourquoi il ne faisait pas de films sur l’Italie, et il répondit : « peut-être que quand l’Italie sera grande comme les États-Unis, alors je ferai des films sur l’Italie ». En substance, seuls les Etats-Unis étaient assez grands pour son cinéma… Cette dimension d’enfant, de rêveur, c’est la clef pour comprendre Sergio Leone. » (Gian Luca Farinelli, Directeur de la Cinémathèque de Bologne et du Festival Il Cinema Ritrovato)
Après cette adhésion au genre dominant de l’époque, le péplum, Sergio Leone va être à l’origine d’une véritable révolution… S’il n’a pas à proprement parler réalisé le premier « Western Spaghetti », considéré comme étant « Duel au Texas » de Ricardo Blasco en 1963, tombé depuis dans l’oubli, Leone enfonce malgré tout le clou l’année suivante avec le succès foudroyant de son « Pour une poignée de dollars » sorti en 1964, qui grave dans le marbre pour l’éternité les codes du genre. A noter que la musique du film est composée par un certain Dan Savio qui n’est autre qu’Ennio Morricone en personne, pour la toute première collaboration de ces deux monstres sacrés du 7ème Art.
[youtube id= »VD6Ew4AS-Ic » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Le Western, propriété inaliénable d’Hollywood, est alors en perte de vitesse aux Etats-Unis et se voit peu à peu supplanté par les productions « Made In Italy » ainsi que par quelques succès allemands, avec plus de 500 films réalisés sur une dizaine d’années. Cette renaissance du genre, jalousée par l’Amérique, lui vaudra ce qualificatif de « Western Spaghetti », que Leone détestait : « ce terme de Spaghetti Western, c’est un des plus cons que j’ai jamais entendu de toute ma vie ».
Ayant tourné beaucoup de ses multiples co-réalisations « péplumiennes » en Espagne, Leone estime que les paysages de l’Almeria conviendraient parfaitement au Western. En 1963, il découvre au cinéma « Yojimbo » (« Le Garde du Corps ») d’Akira Kurosawa et décide d’en transposer le cadre du Japon médiéval à celui de l’ouest américain. Il conçoit alors le personnage de « l’homme sans nom », entre chasseur de prime et défenseur de la veuve et l’orphelin, pour lequel il trouve la parfaite incarnation en un acteur inconnu et dont il va faire une star : Clint Eastwood.
[youtube id= »5L_i2ReuARo » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Le film remporte un immense succès international et donne lieu l’année suivante à sa suite, « Et pour quelques dollars de plus » (1965), plus sophistiqué, pour aboutir en 1966 au cultissime « Le Bon, la Brute et le Truand », sommet du western italien, avant son ultime sublimation par Leone trois ans plus tard, mais ça, c’est une autre histoire…
[youtube id= »WA1hCZFOPqs » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Mais alors, comment définir le style de Sergio Leone ? Car tout est dans le style, vous en conviendrez… Nous pourrions dire que le style inimitable de Leone, c’est d’abord un sens inné du cadrage en Techniscope (écran large), où se succèdent très gros plans et plans larges, une temporalité syncopée, qui passe de la lenteur à l’action subite, brutale, une violence assumée et une reconstitution documentée et non complaisante de cet ouest américain, localisée plus précisément sur la frontière mexicaine, comme pour y conserver des racines latines. Dans ses films, tout est chaleur et poussière, teinté de réalisme, dans des décors crasseux, des costumes élimés, des trognes, une violence omniprésente… Reflet d’une époque qui trouvera son pendant en Amérique chez Sam Peckinpah (« La Horde Sauvage », 1969).
[youtube id= »e7qGTgubKf4″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Après cette trilogie dite des « Dollars » – « Pour une poignée de dollars » (1964), « Et pour quelques dollars de plus » (1965), « Le Bon, la Brute et le Truand » (1966) – Sergio Leone se lance en 1968 dans la réalisation de son (presque…) dernier western, pour ouvrir un nouveau triptyque, « Il était une fois dans l’Ouest », un des meilleurs westerns jamais réalisés.
Pour la première fois, il tourne aux États-Unis, dans les paysages de la Monument Valley, rebaptisée « John Ford Valley », pour rendre hommage à tous les films qu’y a tournés le vétéran américain adulé par Leone depuis toujours. « Il était une fois dans l’Ouest » est un aboutissement, une consécration, avec au générique Henry Fonda, icône absolue du western, et Charles Bronson, que pour la petite histoire, Leone ne put pas se payer sur son premier film…
[youtube id= »lT2Kh8L4Yc4″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Sublime film sur la corruption et la violence, fondements sur lesquels s’est construite l’Amérique, « Il était une fois dans l’Ouest » est la quintessence du cinéma de Leone. Son chef-d’œuvre absolu… Sa scène d’introduction demeure anthologique, dans son mutisme, son temps étiré et une bande son jamais égalée, où des tueurs attendent « L’Homme à l’harmonica » (Charles Bronson) à la descente du train… tout est dit. Le reste n’est que littérature.
Le film fut cependant un échec financier cuisant à sa sortie, tant en Italie, rassasiée de westerns spaghettis, qu’aux États-Unis qui entraient dans l’ère du western post-guerre du Vietnam et par conséquent plutôt pro-indien (« Little Big Man » d’Arthur Penn en 1970, « Soldat Bleu » de Ralph Nelson en 1970 ou encore « Jeremiah Johnson » de Sydney Pollack en 1972). Seule la France fit un triomphe au film, qui fut classé 2ème au box-office derrière « La Grande Vadrouille », excusez du peu, et qui lança même la mode des longs manteaux inspirés des cache-poussières portés par les tueurs dans le film de Leone.
Sergio Leone enchaîne sur « Il était une fois la révolution » (1972), avec un autre vétéran du western, James Coburn (« Pat Garrett et Billy the Kid » de Peckinpah) et Rod Steiger. Leone renoue avec la veine du western mexicain, traitant de la révolution zapatiste avec un œil ironique, alors que l’Italie plonge dans les années de plomb. Il y exprime avec force son abjection pour tout mouvement révolutionnaire et s’attire encore l’ire de cette même critique qui n’aura de cesse que de l’encenser plus tard…
[youtube id= »ELk0PPgh8y4″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Nous passerons rapidement sur les deux films suivants, « Mon Nom est Personne » en 1973 et « Un génie, deux associés, une cloche » en 1975 qui ne seront que coréalisés par le Maître.
« « Il était une fois en Amérique », c’est un film plus grand que le cinéma, à savoir qu’il en transcende les limites. Avec ce film, c’est un peu comme si la bataille de Waterloo nous était racontée par la cantinière ou le petit tambour… La grande histoire contée par le petit figurant. […] « Il était une fois en Amérique », c’est le plus grand film de Sergio Leone, son œuvre majeure, sur le destin d’un tout petit bonhomme qui aurait été sans Leone au huitième plan sur la photo… » (Frédéric Bonnaud, directeur de la Cinémathèque Française)
Puis vint l’heure de son dernier long métrage, « Il était une fois en Amérique » (1984), que certains considéreront comme son chef d’oeuvre absolu et en même temps son chant du cygne, tant ce film concentre toute la nostalgie du Maître, fondée sur une écriture achronique.
Ultime oeuvre de Sergio Leone, intemporel testament mélancolique auquel il consacra douze années de sa vie, notamment pour préparer le scénario adapté du livre « The Hoods » de Harry Grey, le film nous fait suivre le destin de Noodle sur trois époques différentes de sa vie, régulièrement lié à trois amis dont Max et son amour inconditionnel pour Deborah qu’il a rencontrée dans sa jeunesse.
Affichant une distribution exceptionnelle, de Robert de Niro à James Wood, en passant par Elisabeth McGovern, Jennifer Connely et Joe Pesci, le film projeté à Cannes hors compétition, est bien accueilli. Mais il est ensuite massacré par ses producteurs américains, qui réduisent les 4h11 initiales à seulement 1h30, sans tenir compte de la temporalité sur laquelle repose tout le sens du film. Et pourtant… Que dire de cette immense et magnifique fresque ? Qu’entre autres choses, ici le mot « Cinéma » prend tout son sens.
Sergio Leone ne s’en remettra pas… Il tente de rebondir en écrivant son nouveau projet « Stalingrad », sur la grande bataille du même nom ; sujet encore épique, à sa dimension, et qui sera mené à terme des années plus tard par Jean-Jacques Annaud. Leone meurt d’une crise cardiaque en 1989, alors que le film allait entrer en préproduction.
[youtube id= »-Vmc1sdDlrk » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Sergio Leone éprouvait une vraie fascination pour le cinéma américain. Rappelons qu’il était né en 29, année de la plus grande crise économique que le monde ait connu, mais aussi l’année de l’arrivée du cinéma sonore en Italie. Leone a connu l’âge d’or du cinéma hollywoodien en salle, dont il fut ensuite privé durant les années de fascisme en Italie. Il ne pouvait ainsi concevoir autre cadre à son cinéma que celui de cette Amérique fantasmée, en plan aussi large que l’étaient ses rêves d’enfant. Même s’il fut d’abord boudé, voire méprisé par l’industrie, pour être ensuite encensé, Sergio Leone réussit le tour de force de devenir avec ses films l’un des grands chroniqueurs de l’histoire américaine…
En 2018, la Cinémathèque Française de Paris, en collaboration avec celle de Bologne et son commissaire Gian-Luca Farinelli, lui consacrait une exposition doublée d’une rétrospective exceptionnelle. On pouvait y suivre le parcours chronologique et initiatique de Sergio Leone, depuis la première salle consacrée à son enfance, déjà ancrée dans le cinéma, jusqu’au dernier scénario de « Stalingrad ».
Émouvant de parcourir ce chemin dans les pas du maître, habité de grands films et de l’enthousiasme d’un homme dans sa création toujours renouvelée, qui ne voyait que par le cinéma et qui l’a finalement si bien servi. Sa vision, son traitement du temps et de l’espace demeurent toujours une influence majeure pour un Tarantino ou Clint Eastwood lui-même, dont tous les westerns émanent de Leone, dans leurs sujets et comme leurs mises en scène, mais pour bien d’autres encore.
Émouvant de voir aussi toutes ces photos, ces dialogues entre la peinture de Goya, de Degas et ses plans de cinéma, les passerelles qu’il jeta entre Homère et le western, le parallèle avec Kurosawa… Les musiques indispensables d’Ennio Morricone (qui aura prochainement sa rétrospective à la Cinémathèque) baignent de l’atmosphère des films chacun de nos pas. Émotion encore quand on se trouve devant le poncho de Clint Eastwood, les costumes de ses deux chefs d’oeuvre « Il était une fois dans l’Ouest » et « Il était une fois en Amérique ». Il était une fois le cinéma de Sergio Leone… Monumental.
[youtube id= »WQGbVDEBmXU » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Sources : France Culture, Sens Critique, See Mag, Wikipedia