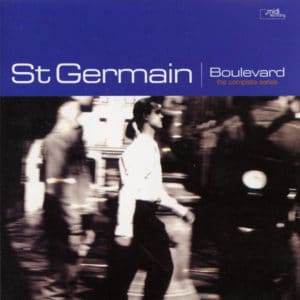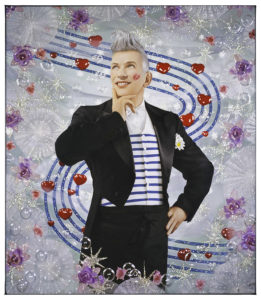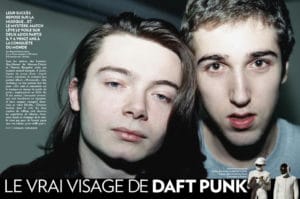[kleo_pin type= »circle » left= »yes » right= » » top= » » bottom= » »] « FOCUS » : un article de fond sur un thème que nos rédacteurs ont sélectionné.
Penser que le Mambo ou la Salsa sont nés à Cuba ou Puerto Rico, pour être ensuite importés aux Etats-Unis, c’est occulter complètement l’influence majeure du South Bronx dans l’émergence de ces musiques aux yeux du monde.
A la fin de la seconde guerre mondiale, l’arrivée massive de populations en provenance de Puerto Rico sera à l’origine du dynamisme créatif de ce quartier de New York. Le Mambo est partout, et des clubs consacrés à cette musique, les Latin Balrooms, fleurissent à chaque coin de rue. Des bancs de la Public School 54 émerge dans les années 40 une génération bénie de musiciens exceptionnels, de Ray Barretto à Eddie Palmieri, en passant par Willie Colon et Benny Bonilla, tous originaires du South Bronx. Quant à Tito Puente, d’environ dix ans leur ainé, il grandit à Spanish Harlem.
Ce qui va d’abord réunir tous ces gamins, c’est le Stickball, « the poor man’s baseball ». Puis viendra la musique et la danse, avec comme point d’ancrage le jukebox trônant au milieu de l’épicerie tenue par les parents d’Eddie Palmieri. Tout ce beau monde fera ensuite ses armes dans les meilleures formations du moment, parmi lesquelles celles de Machito ou Tito Rodriguez.
Dans les années 50 et 60, au coeur du Bronx où se côtoient les communautés African American et Afro-Cubaines, le Mambo made in NYC s’imprègne peu à peu d’influences diverses telles que l’Afro Beat et le Rhythm ‘n’ Blues.
A la fin des années 60, la combinaison de toutes ces facettes de la musique cubaine posera les bases d’un style plus « agressif », que le label prédominant de l’époque, Fania Record Company, dénommera Salsa. La Salsa n’est pas un rythme, c’est un concept. Comme le disent les divers initiateurs de ce nouveau son : « Salsa, Cuban Music with a freakin’ New York attitude »…
L’explosion de la Salsa connaitra son apogée avec le concert géant des Fania All Stars organisé au Yankee Stadium en 1973, en plein coeur du Bronx. Quarante-mille personnes en transe assistent à cet évènement réunissant la crème des musiciens latinos du moment, tous originaires des alentours du stade. Ce qui caractérise cette nouvelle forme de musique cubaine, c’est le rythme qui prend le pas sur la mélodie. Regardez une performance de Tito Puente, el rey de las timbales, pour vous convaincre du pouvoir hypnotique et tribal de la Salsa. Ce qui est sûr, c’est que sans l’établissement de cette communauté portoricaine dans Spanish Harlem ou le South Bronx, à partir des années 20, la musique cubaine n’aurait probablement pas survécu.
Mais le Bronx change… L’arrivée en force du trafic de drogue coïncide avec la formation des premiers gangs qui, conjuguée à la construction du Cross Bronx Express Way, mènera peu à peu à un nouvel exil des populations cubaines et portoricaines vers le West Bronx, ainsi qu’au déclin du borough. Les Dancehalls ferment les uns après les autres, tandis que l’esprit du Bronx disparait au gré des incendies.
En 1974, des cendres et des gravats encore fumants du South Bronx va émerger une nouvelle musique qui, comme la Salsa, met en avant le rythme par rapport à la mélodie : le Hip-Hop. Les pionniers de ce genre musical, à l’instigation d’Africa Bambaataa et de sa Zulu Nation, investissent les immeubles délabrés du quartier, et dieu sait s’il y en a, pour créer autant de dancehalls improvisés où s’affronteront désormais de façon pacifique les gangs, devenus crews, dans le cadre très codifié de battles sur le dancefloor.
La communauté black du South Bronx est à l’origine de l’émergence du Hip-Hop, avec Grandmaster Flash ou Cold Crush Brothers, mais les portoricains ne sont pas en reste avec quelques Djs qui deviendront des mythes, comme Charlie Chase.
A l’aube des années 80, Sugarhill Gang offre le tout premier hit planétaire au Hip-Hop, Rapper’s Delight, tandis que la Disco Music investit Brooklyn.
Ne manquez pas « From Mambo to Hip-Hop, a South-Bronx Tale », un documentaire exceptionnel revenant sur la contribution d’un quartier de New York à l’émergence d’un genre musical qui va révolutionner la musique moderne…
[vimeo id= »27923016″ align= »center » mode= »normal » autoplay= »no » maxwidth= »900″]
[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Liens externes » class= » » id= » »]
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] South Bronx
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Musical Landscape of the South-Bronx