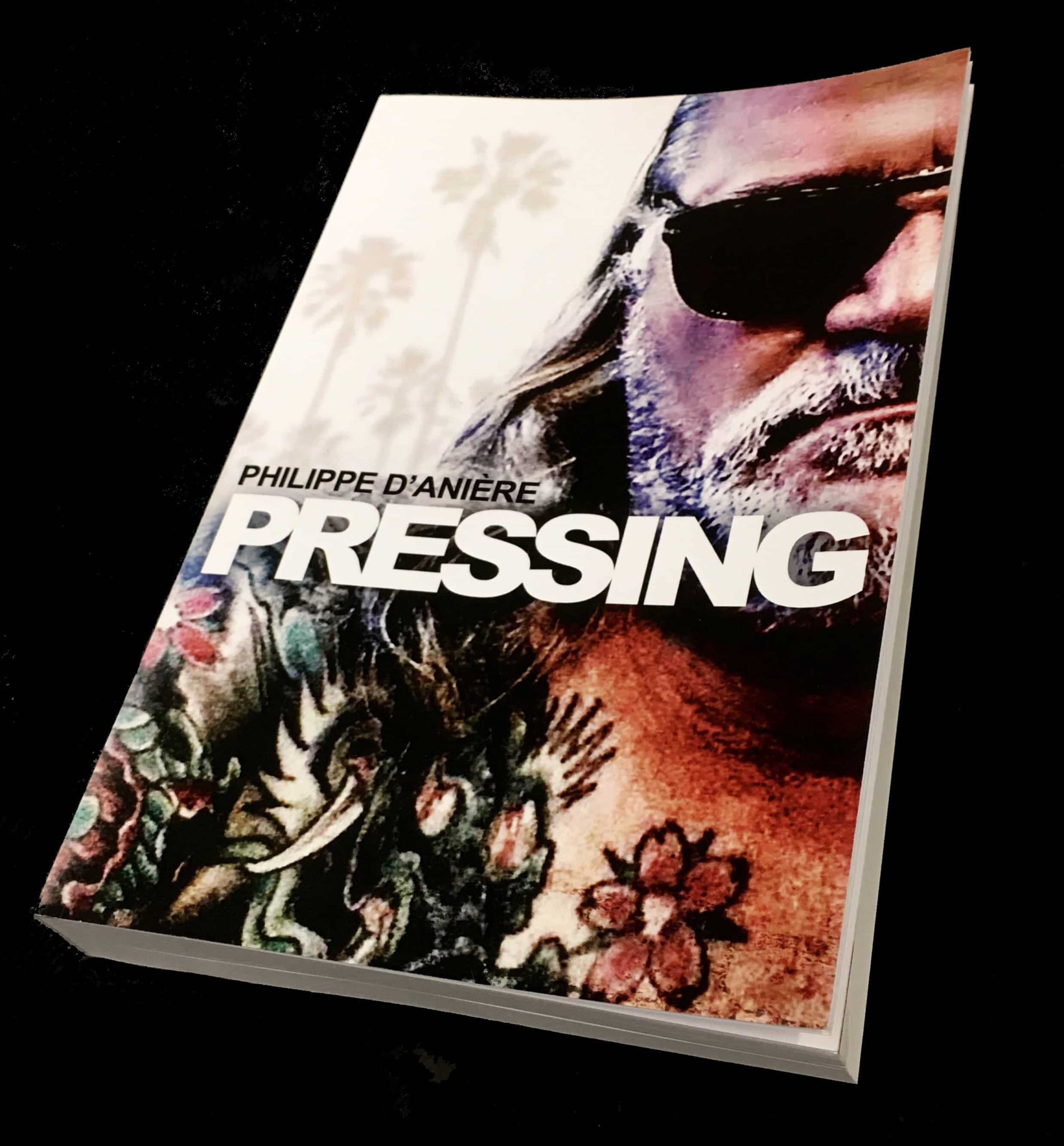Plongée dans la France de la toute fin des années 70, les années Giscard : période des grands bouleversements sociétaux et d’un certain sentiment de modernité, entre libéralisation du divorce et éclatement de l’ORTF. Pourtant, la jeunesse s’ennuie et se réfugie alors dans l’émergence de nouvelles scènes rock et new-wave. Parmi les groupes qui s’imposent : Téléphone, Starshooter ou Bijou.
C’est la nouvelle vague, plastique et fluo et Skaï
Super dégaine spéciale, électricité en pagaille
C’est la nouvelle vague, sans paradis artificiels
Sans illusions superficielles, sans mémoire…
Starshooter, 1979
Mais la nouvelle vague, cette année-là, reste essentiellement celle des musiciens du groupe Téléphone, qui en ce début de l’année 1979, enregistrent à Londres leur 2ème album, « Crache Ton Venin ». Les textes réalistes abordent de front les thèmes de société, entre menace atomique (« La Bombe Humaine »), révolte et conflits familiaux des adolescents. Porté par une pochette conçue par le photographe Jean-Baptiste Mondino, l’album consacre le groupe, trois ans à peine après son tout premier concert. Même si, en marge de cette nouvelle scène rock, d’autres courants musicaux sont alors en gestation.
[youtube id= »rah-s-hJwTQ » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
« C’est pour essayer de penser à autre chose, parce que c’est tellement triste, tout ce qui arrive, qu’il faut bien s’étourdir. Sortir le plus possible, sortir toute la nuit, aller boire, aller danser. Avant de mourir, il faut prendre du plaisir et jouir de l’instant présent. » (Alain Pacadis sur le plateau d’Apostrophes, 07/04/1978)
A l’image de l’étrange et provocateur Alain Pacadis, chroniqueur déglingué des nuits parisiennes, notamment pour le quotidien Libération, apparaissent alors les nouveaux punks, ces dandys urbains et sophistiqués qui se défoncent à l’héroïne, dorment le jour et arpentent la nuit les institutions festives qui s’ouvrent en cascade. Il y eut d’abord La Main Bleue, ouverte en 76 dans un ancien centre commercial de Montreuil, près de Paris. Initialement fréquentée par tous les Africains et les Antillais qui se faisaient refouler des boîtes parisiennes, La Main Bleue devient un lieu branché investi par les bourgeois bohèmes blancs de la capitale.
[youtube id= »ftRIbtCOzvQ » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
En mars 78, dans un ancien théâtre à l’Italienne situé près des Grands Boulevards ouvrait ensuite l’inévitable Palace, sous l’impulsion de Fabrice Emaer, devenant le comble des sociabilités « People », des vanités chics et délurées. Plus intimistes, les Bains-Douches sont inaugurés en décembre de la même année, Rue du Bourg l’Abbé, près du Marais, rachetés par deux antiquaires qui en confient la décoration à Philippe Starck. Le premier soir, deux-mille personnes se pointent et la Préfecture de Police, qui redoute des débordements, a posté huit cars de CRS de part et d’autre de la rue.
[youtube id= »cTvVWes4Bto » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
En l’espace de quelques mois, avec le concours actif des médias, Libération ou Actuel en tête, la danse en boîte de nuit, le « Clubbing », comme on l’appelle, devient l’horizon incontournable de la jeunesse urbaine française, ou du moins parisienne. Parmi les créateurs, les couturiers, les stars ou les vedettes de passage, on y croise aussi Gainsbourg et la jeune garde du rock français, comme les membres du groupe Bijou, qui en 1979, sortent sur leur deuxième album une reprise des « Papillons Noirs » gainsbouriens.
[youtube id= »JGHGzXXzCfU » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
« Les Papillons Noirs » signé Gainsbourg, que ce dernier avait enregistré en 1966 avec Michèle Arnaud, est repris en 1979 par le groupe Bijou, trio arty, mélange de rock dur et de romantisme, sur son album « Ok Carole ». En février 1980, le magazine Actuel intitule un article d’une formule efficace, qui allait devenir une appellation musicale, pour résumer l’époque : « Les jeunes gens modernes aiment leurs mamans ». Entre les Rennais de Marquis de Sade, Jacno ou Marie et Les Garçons, les groupes n’ont pas grand chose à voir entre eux, mais peu importe…
Associé à cette mouvance, le groupe parisien Edith Nylon, formé là encore par des lycéens de bonne famille autour de la chanteuse Mylène Khaski, enregistre son tout premier album en 1979, pendant les vacances scolaires. Mylène et sa chevelure de feu s’y autoproclamant « femme bionique, artères antistatiques, perruque de nylon, utérus en Téflon, seins gonflés silicone, lèvres glacées de chrome… Edith Nylon, c’est moi… ».
[youtube id= »JUHABIiDS8Q » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
« Edith Nylon » par le groupe du même nom, dont les paroles évoquent la société d’alors, le féminisme, mais aussi les périls futurs, comme les manipulations génétiques ou le transhumanisme, et dont la new-wave inspirera par la suite des groupes comme les Rita Mitsouko. Pour l’heure, ce changement de décennie est surtout marqué par le rock et l’émergence d’un nouveau groupe, Trust.
Formé en 1977 par deux mecs de banlieue parisienne, le chanteur Bernie Bonvoisin venu de Nanterre et le guitariste Norbert « Nono » Krief originaire des Mureaux, Trust, après avoir passé trois longues années dans l’ombre de Téléphone, connaît un immense succès à partir de 1980 avec la parution de son second album « Répression », dénonçant le sort de Jacques Mesrine dans la chanson « Le Mitard » ou encore l’ensemble du système, dont les dés sont pipés. Il s’en écoule plusieurs centaines de milliers d’exemplaires dès sa sortie.
[youtube id= »6NJ47t_ZLbM » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] French Connection (1978-1982) : Episode 01
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] French Connection (1978-1982) : Episode 02
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] French Connection (1978-1982) : Episode 03