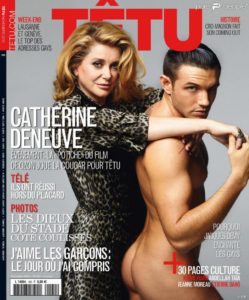On se sent toujours un peu ennuyé, voire même coupable, lorsqu’on a le sentiment d’être passé à côté d’un film qui croule sous une avalanche de dithyrambes… Mais c’est pourtant ce que j’ai ressenti avec « 120 Battements par Minute ».
Même si je fus un protagoniste de cette période, ou plutôt un figurant, je ne me suis pas retrouvé dans cette description qui se veut factuelle d’une époque, avec les événements qui s’y rattachent. Je n’ai jamais été ni activiste ni séropo, ou quoi que ce soit qui pourrait s’assimiler à l’histoire des personnages du film « 120 Battements Par Minute » de Robin Campillo. J’y retrouve cependant tel ou tel trait de caractère que j’avais noté dans le comportement de ceux que j’ai pu croiser à l’époque, pris dans leurs combats.
Je vivais pourtant à Paris et je jouissais d’une vie de jeune gay tout ce qu’il y a de plus lambda, sans avoir été confronté une seule fois à une situation vraiment douloureuse. Je me protégeais, et même si je cotoyais ou couchais avec des séropositifs, ces derniers n’évoquaient jamais leur drame intime. On savait la période dure pour ceux qui avaient contracté le HIV, mais néanmoins floue car tout était encore bien nébuleux au sujet de ce virus.
C’était l’avènement de la House et du Garage, et les boites de nuit gay étaient à cette époque paradoxalement d’incroyables temples païens où la danse constituait un exutoire, une communion, et où l’on allait d’abord pour danser avant de draguer. En ce sens, les scènes de clubbing dans le film sont extrêmement belles et comptent parmi les plus réussies.
Alors, même si le film de Robin Campillo décrit avec force détails le fonctionnement d’Act Up, les enjeux de l’époque, et tous ces personnages inspirés de la réalité, il nous manque pourtant quelque chose. Sans doute une hauteur, une ampleur… Les trois histoires présentées dans le film s’imbriquent mal. Elles se mélangent, se superposent mais interagissent difficilement entre elles. Du fait d’un budget restreint, d’un cadrage trop serré et d’un nombre limité de décors, le film finit par être étouffant, suffoquant. Peut-être était-ce une volonté artistique du réalisateur, mais les scènes d’intervention, les coups d’éclat, les manifestations manquent de force et de hargne. Elles sont trop « cheap » et sonnent faux.
En voulant sans doute coller aussi à une stricte réalité et ne pas tomber dans un misérabilisme flamboyant façon « Les Nuits Fauves » ou certains des films de Patrice Chereau (« L’homme Blessé », « Ceux Qui M’aime Prendront Le Train »…), 120 Battements prend le parti-pris d’un naturalisme « Pialesque » sans savoir où couper. On se retrouve ainsi avec des scènes étirées qui éclipsent certaines autres, plus courtes mais pourtant plus réussies. On ne s’attache que difficilement aux personnages, mis à part Nathan, une sorte d’être lumineux et bienveillant. Quant aux autres, ils sont surtout des stéréotypes que l’on a tous déjà côtoyés dans les milieux gay que l’on pouvait fréquenter à l’époque. Personnellement, ces individus m’agaçaient de par leur hargne, leurs rapports conflictuels et l’arrogance affichée comme seul moyen de communication.
Avec si peu d’empathie et cette morgue comme seule alternative pour expliquer les enjeux, on se demande où réside l’intérêt du film aujourd’hui et surtout à qui il s’adresse, finalement… Aux gays ayant vécu cette période, comme une piqure de rappel ? A un jeune public qui ne connaîtrait pas cette époque symboliquement forte du militantisme en France ? A un public qui voudrait en savoir plus sur la communauté LGBT ? D’autant que cela retrace l’histoire d’Act Up, quand tout restait encore à faire. Depuis, heureusement, et sans doute en grande partie grâce à eux, des progrès considérables ont été mis en oeuvre pour le traitement des malades.
Au-delà de la dimension historique, didactique, je m’attendais malgré tout à être secoué, galvanisé, en regardant un film puissant et électrique. Je pensais aller voir un morceau brut d’énergie pure, une ode à la vie. Une expérience sensitive et bouleversante… On me dira que le combat est donc toujours d’actualité, certes, mais je me penche ici uniquement sur l’expérience cinématographique et non pas sur les idées qu’elle défend. Et en tant qu’oeuvre qui voudrait s’adresser à un large public, je crains que beaucoup restent sur le bas côté et n’entendent rien à ce 120 Battements qui exprime plus le sentiment de mort que l’espoir ou la lumière.
La fin est pesante, interminable et inutilement arrache-larme, et tout ce qu’avait tenté d’éviter le réalisateur durant le métrage, à savoir ce pathos omniprésent, nous explose ici à la figure de manière maladroite et crispante. Le générique final enfonce le dernier clou de ce cercueil qu’est « 120 Battements Par Minute » et notre coeur, quant à lui, s’est arrêté de battre…
[youtube id= »q4Jgg4uUVqI » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]