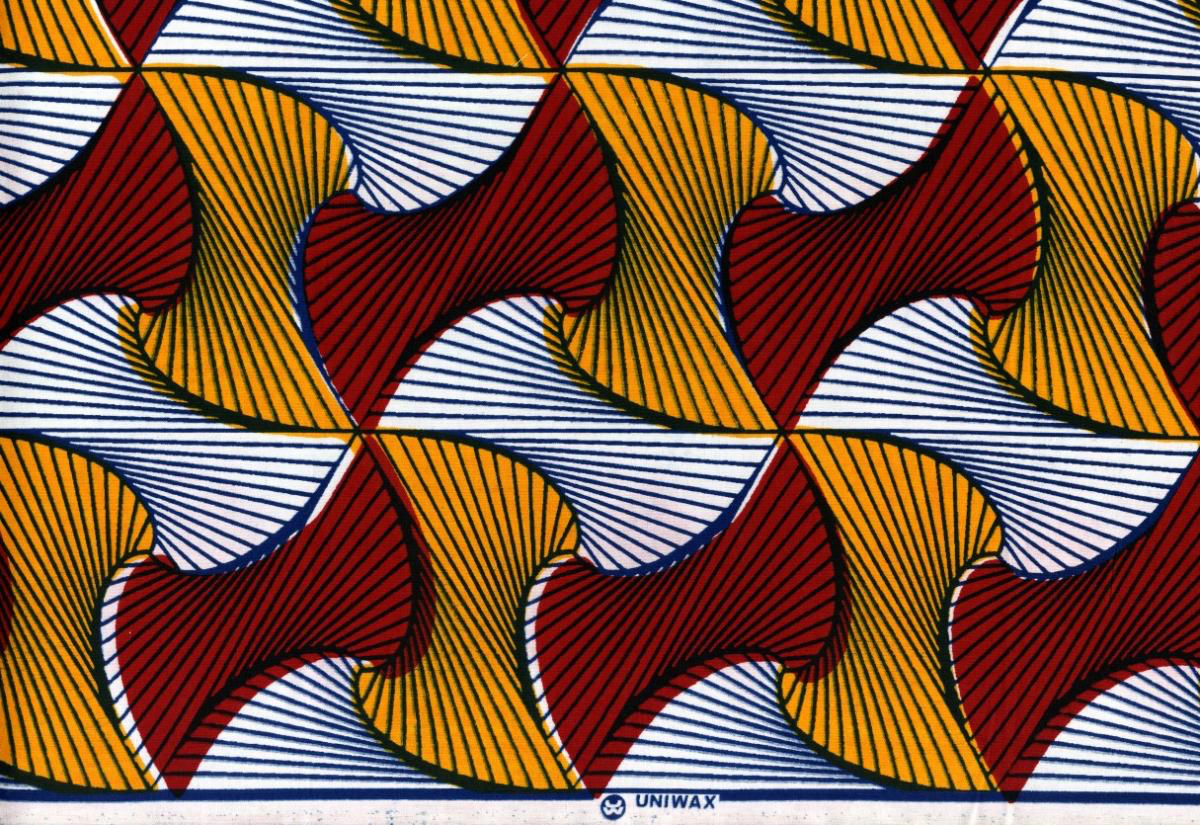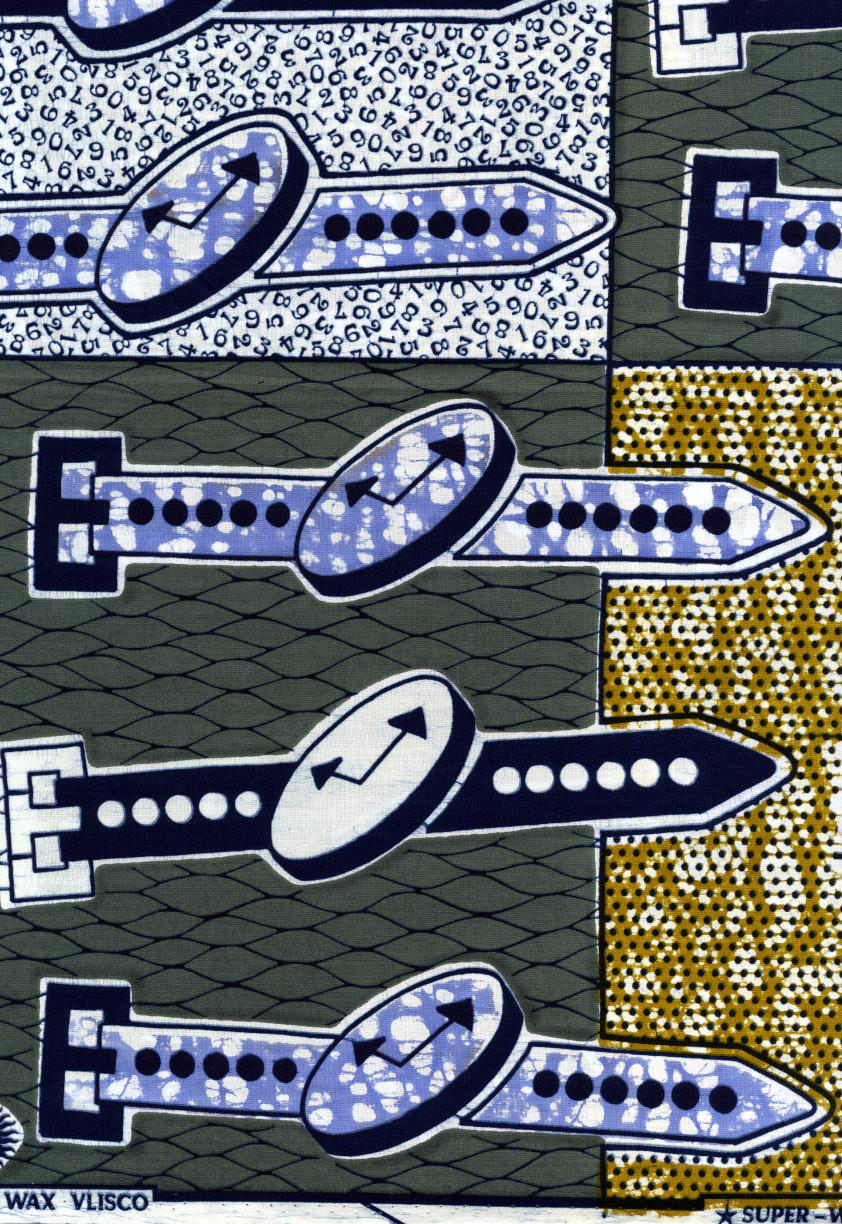Dans ma série de billets d’humeur devenue culte, « Hubert a des p*bip*ains de problèmes dans la vie », je souhaitais aborder aujourd’hui : ceux qui vivent des réseaux sociaux.
Ah, s’esbaudir de ce monde actuel qui n’en finit plus de nous épater et de nous faire rêver… Andy Warhol a dit un jour « A l’avenir, chacun aura son quart d’heure de célébrité mondiale ». S’agirait-il de l’ultime représentation de nos vanités, où vont se conjuguer talent pour le néant, savoir-faire du vide et accessoirement délire mégalomaniaque à tendance schizophrénique ? Voici venu le temps des Influenceuses, des YouTubeurs, des rires et des chants. Avec Internet, c’est tous les jours le printemps. C’est l’univers joyeux des ados heureux, des débiles gentils, oui… oui, c’est un paradis…
Depuis l’avènement de ce que l’on appelle aujourd’hui « La Toile » et l’émergence de toutes ces nouvelles manières de communiquer, avec l’arrivée des smartphones et de leur capacité en perpétuelle évolution, pléthore d’égos ont pu enfin enfler en toute liberté, sans se voir écartés, bâillonnés, censurés. De façon exponentielle, on a vu fleurir comme narcisses au printemps (métaphore consensuelle, plutôt que d’avoir à évoquer des boutons blancs sur le visage puis sur tout le corps, avec du pue et des asticots en prime…), de parfaits inconnus hier qui, du jour au lendemain, ont envahi ces territoires virtuels.
Les Youtubeur(ses), les Influenceur(ses), se sont donc auto-proclamés un beau matin, à leur réveil, détenteurs de la simple et pure vérité. Ils seraient le fer de lance, l’étendard de toute une génération en parlant uniquement… D’eux, juste d’eux… D’elles, d’eux, ou encore de leur point de vue, Moi, Je… Je, moi… Moi-Je.
Alors bien-sûr, on peut concevoir différents angles d’attaque pour aborder le « MOI-JE », comme les secrets de beauté, de minceur, le domaine de la mode, le bon vieux coup de gueule sur n’importe quel sujet dont on ignore à peu près tout, des crottes de caniches sur les trottoirs à la dernière collaboration de la marque H&M avec un célèbre styliste. Des critiques de cinéma ou de jeux vidéo, des apprentis-comiques, des divers complotistes aux geeks en tout genre… Une faune sans limite peut désormais s’exprimer sans avoir à demander ni conseil ni autorisation. Se côtoient ainsi l’à peu près comme plus souvent le pire. De Norman à Soral, choisis ton camp, camarade…
Grâce au nombre de vues de leurs vidéos, les plus suivis vont toucher des émoluments directement de la publicité, qui est venue se coller comme la vérole sur le bas-clergé à cette manne inopinée. Une nouvelle façon de gagner sa vie qui crée tous les jours des vocations dans ce domaine.
Mais encore faut-il avoir alors quelque chose de vraiment pertinent à déclamer aux autres simples mortels restés dans l’ombre. Les Grecs comme les Romains avaient bien l’Agora ; un lieu purement démocratique où l’on pouvait venir exprimer ce que l’on voulait, mais à visage découvert.
Je ne parlerais donc pas de tous ceux restés dans l’anonymat feutré, au chaud, qui à chaque seconde rebondissent sur l’actualité ou sur tout ce qui peut défiler sous leurs yeux, avec comme unique but de se défouler et d’afficher leur morgue, leur frustration, leur appétence à la méchanceté et à la bêtise. Les commentaires zélés, qui à base d’émoticons et d’injures, réduisent la parole et le sens du mot débat au rang de celui du plus pathétique des Facebook Lives.
Pour ce qui est des Influenceuses, elles aussi sorties de nulle part, mais qui grâce au concours des réseaux sociaux (Instagram, Youtube, Facebook, Twitter…), apparaissent tous les jours, telles de futiles speakerines ou des évangélistes galvanisés par la forme de leur nombril, squattant les interfaces pour répandre leur érudition de « Moi-Je ».
Sur le principe d’une téléboutique achat 2.0, les Influenceuses vantent les mérites de telle crème à se tartiner sur la tronche, du rouge hyper-rouge gloss à tendance poupouf, et divers autres produits de beauté, en n’oubliant surtout pas de bien mettre en avant la marque qui les sponsorise. Se déclinent ainsi sur le même principe, chaussures, sacs à main, chatons broyés au Magimix pour en faire des masques pour la peau, recettes de cuisine…
Sans aucune expérience, aucune légitimité, toutes ces chères petites têtes à claques revendiquent de façon schizophrénique le fait d’être en mesure de parler à leur génération, car elles en font partie intégrante, tout en flottant à des kilomètres au-dessus, parce que sinon elle n’auraient pas atteint un tel stade de notoriété. Si au tout début, l’entreprise pouvait paraître amusante, ludique, honnête, voire même intéressante, il y a aujourd’hui des litres de lait pour le corps et de parfums rances qui ont coulé sous les ponts…
[youtube id= »0sd4ieJvgdw » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Toutes récupérées par des marques prestigieuses et des sponsors, ces Denise Fabre du net ne font plus que rabâcher sur un ton monocorde ce que le marketing leur a donné (ou plutôt offert) à promouvoir. Et c’est sans compter sur les dizaines de milliers de followers qui justifient chaque jour l’utilité de ces petites VRP en herbe des produits Avon (vendus à l’époque en porte à porte), au prix d’une terrible hypertrophie du pouce droit…
Croulant sous les cadeaux, les invitations aux fashion weeks (pour les plus hype d’entre elles) ou les séjours dans les hôtels les plus prestigieux, ces influenceuses sont devenues les nouvelles icônes de notre époque, qui déclenchent de véritables scènes de guerre à chaque apparition publique. De l’hystérie collective, des hurlements, des évanouissements et des pipis dans la culotte comme s’il en pleuvait…
… Sans avoir produit le moindre album de musique, écrit le moindre livre, réalisé le plus petit film ou la moindre série TV… Non. Juste un tutoriel, une webcam dans une chambre pour parler d’un dentifrice génial, de la housse protectrice à oreilles de panda pour téléphone ou encore du gel au wasabi pour les fesses. De bien mauvaises langues ajouteraient que la plupart de ces petites écervelées ultra-connectées gonfleraient le nombre de leurs fans en les achetant à des sociétés basées en Chine, spécialisées dans ce domaine.
Il se trouve que les « Suiveurs » qui nous servent de gosses ont bien souvent le même âge que leur gourou, entre 13 et 25 ans en moyenne. Une grande partie sont d’ailleurs des adolescents qui à priori n’ont pas les ressources suffisantes pour se payer les articles que promeuvent leurs idoles. Eh oui, nous ne vivons pas forcément une période des plus opulentes… Face à ce constat, certaines marques seraient d’ailleurs déjà en train de rétro-pédaler. On aurait ainsi dernièrement vu durant des fashion weeks des Influenceuses se faire refouler des shows. Il en résulte retour à la triste réalité, eau dans le gaz, indigestion de paillettes, humiliation, frustration, ricanements, pleurs… VDM, quoi…
Et évidemment, nous n’avons ici abordé que le cas de ces Influenceuses qui vantent les mérites de tel ou tel produit, mais qui ont eu l’occasion de l’essayer, qui se sont tout de même documentées ; bref, qui ont un peu bûché le sujet… Car il y a le degré encore inférieur, une sorte d’infini abyssal empli de vide et constellé de fautes de Français…
Et puis il y a les blogueuses qui ne proposent en pâture rien de plus que leur propre personne. C’est possible ? Oui, bien-sûr. Pour cela, il faudra tout de même posséder au moins un joli petit minois de poupée maquillée comme une voiture volée. Le plus souvent mineures, voici des lolitas qui ne font que nous exposer leur quotidien d’adolescentes incomprises tellement qu’elles sont belles de trois-quarts, tellement qu’elles arborent bien le duck face, tellement qu’elles sont fortes en selfie. Elles peuvent parfois pousser la chansonnette, glousser comme des dindes ou raconter des inepties. Tout ça pour dire, ça fout quand même les jetons.
Voilà, on en est là…
Une autre mouvance rencontre également un incroyable succès, érigée en modèle à suivre par des milliers de petites gonzesses et de petits jean-foutre, dans la continuité des émissions « Anges de Marseille » et autres joyeusetés télévisuelles pas du tout vulgaires et vraiment très très, mais alors très enrichissantes.
Pour cette catégorie-ci, c’est évidemment à la télé-réalité que l’on pense, vous vous souvenez, quand un jour une petite quiche, sans autre attribut que deux magnifiques lobes cervicaux portés hauts comme un étendard et maniant le couteau comme personne, a prononcé cette sentence propulsée depuis au pinacle de la langue de Molière : « Non mais allo quoi… ! ». Bon, la quiche en question, même avec son araignée au plafond, est devenue célèbre et accessoirement millionnaire ; et le but ultime à atteindre pour celles et ceux qui ne peuvent supporter leur existence que par ce prisme déformant et criard. Etrange renversement des valeurs et d’un syncrétisme jusqu’à présent fragile mais qui fonctionnait. Peut-on en rire plutôt que d’en pleurer ? Ok, mais en se bouchant le nez…
Enfin pour terminer, permettons-nous tout de même de faire un grand écart trivial, et relativiser à défaut de juger, à l’aune d’un monde uniformisé et devenu tartignole. D’un côté, nous avons les sapeurs-pompiers qui sacrifient leur vie aux autres, avec abnégation et sans aucune reconnaissance ni considération en retour. Bon, ne grossissons pas le trait démesurément non plus ; dans certaines banlieues, on leur renvoie quand même des frigos, certes, sur le coin de la tronche depuis les toits…
Et de l’autre côté, toutes ces créatures bi-dimensionnelles à la réalité aléatoire, mi-humaines, mi-photoshopées, qui se voient offrir des fortunes, de la gloire et tout l’amour de foules finalement pas si sentimentales, qui ont enfoui aux tréfonds d’elles-mêmes leurs dieux originels, leurs rêves et leurs espoirs, pour les remplacer par ces ersatz gonflés à l’hélium. Etre coûte que coûte connu ne serait-ce qu’une minute, reconnu, célébré comme les héros naguère, juste pour un sourire de l’autre, qui pourtant ne signifie plus rien. Ô insondable tristesse…
Mais vous n’êtes pas obligés de me croire…