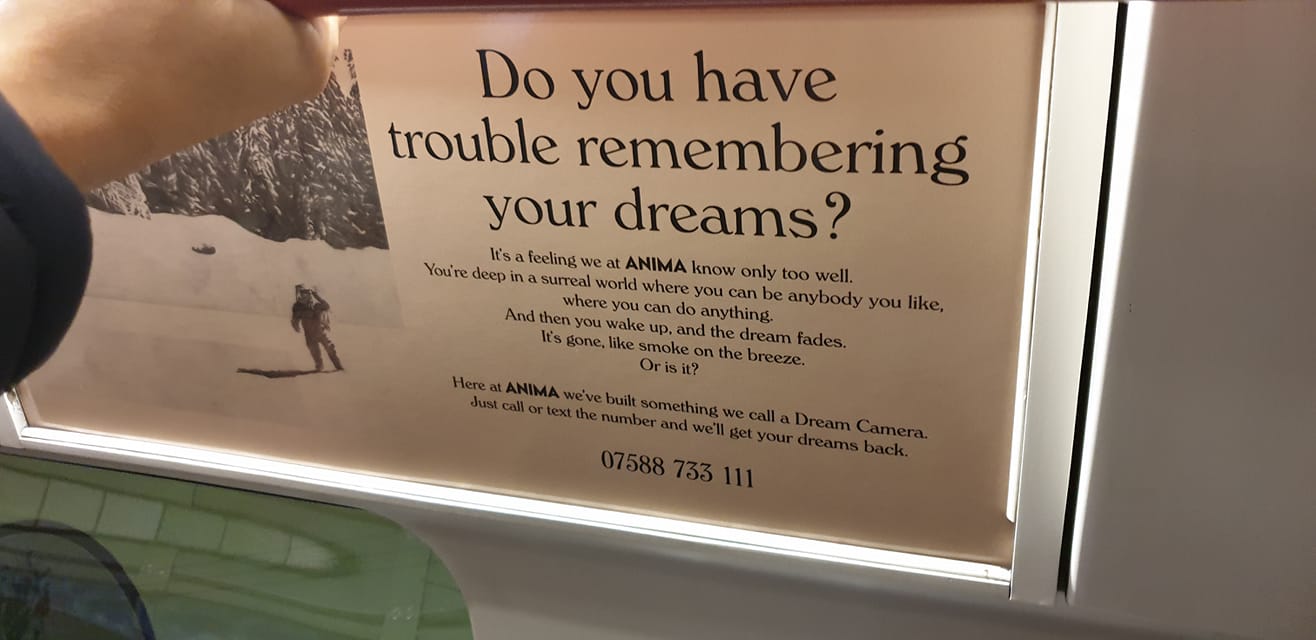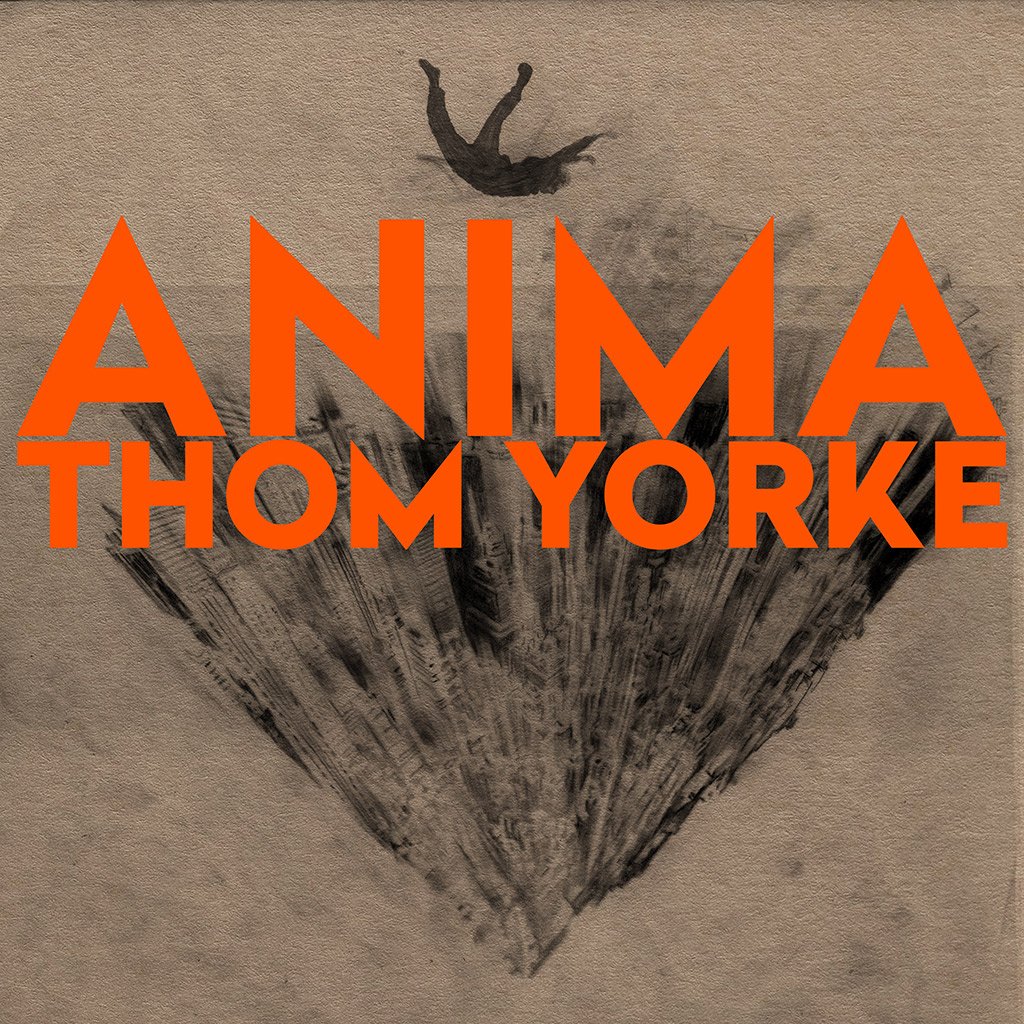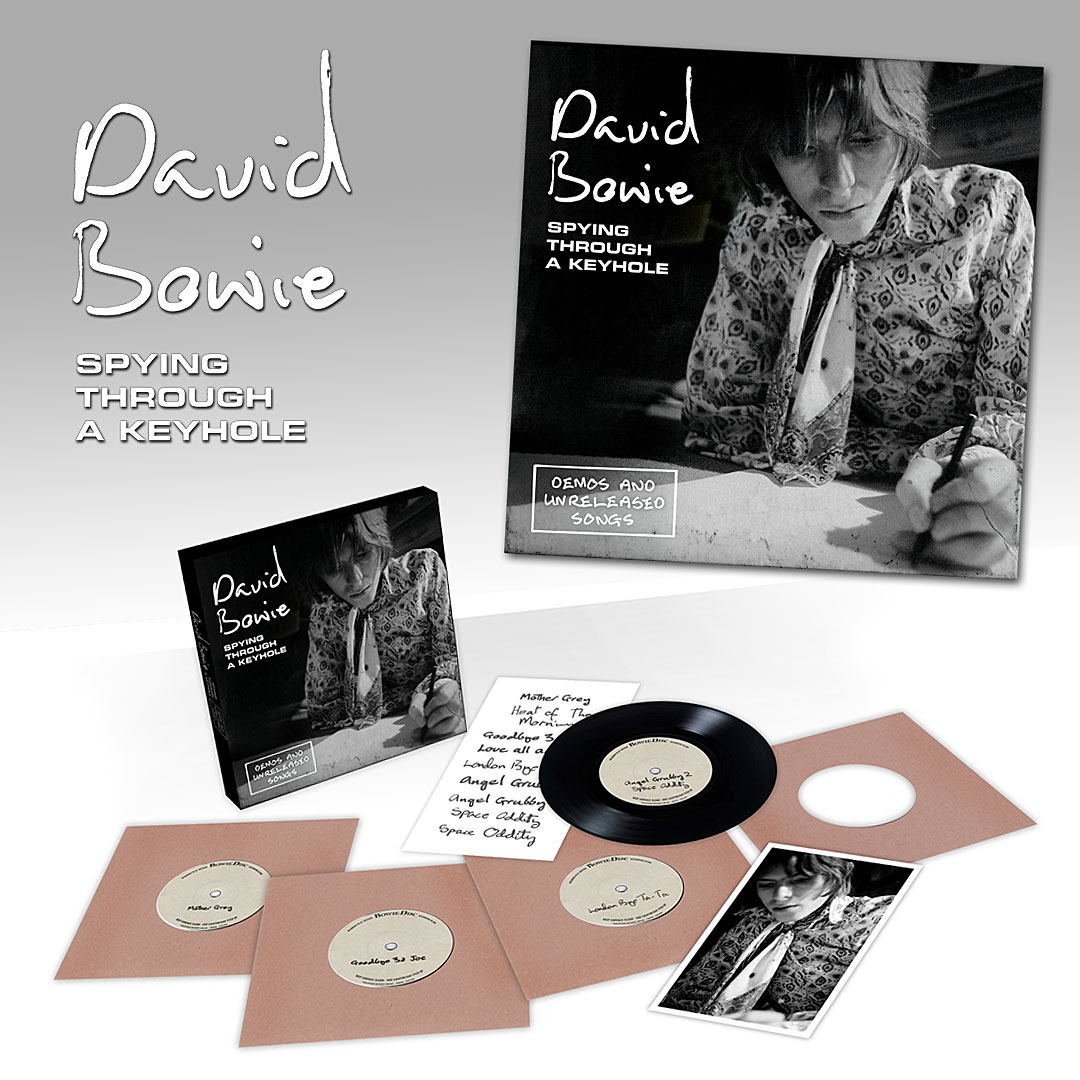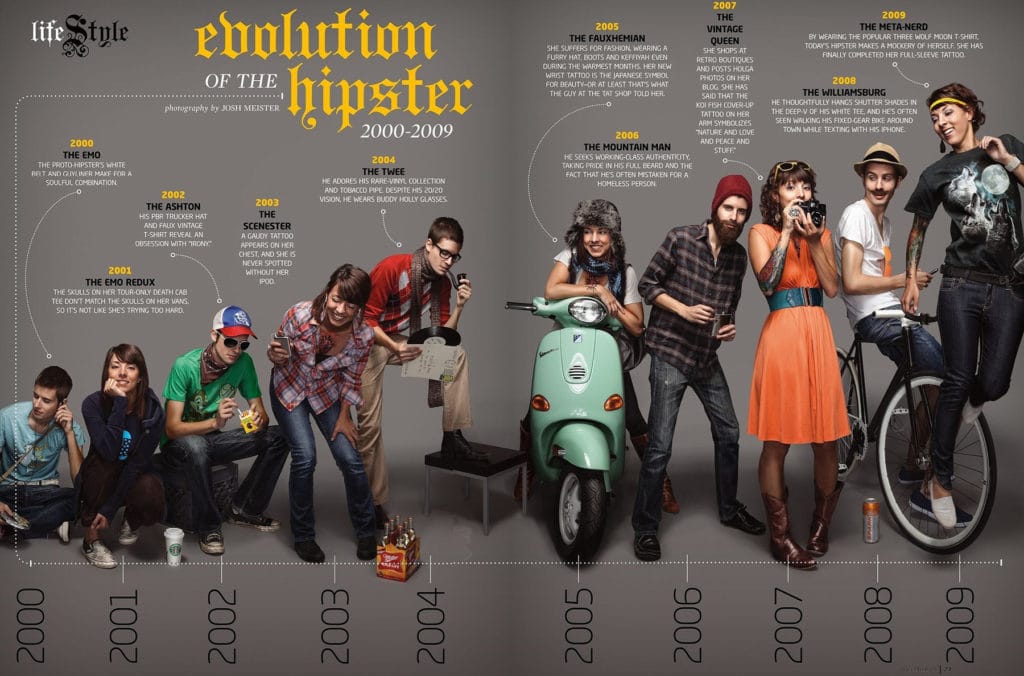« Indiana Jones & Les Aventuriers de l’Arche Perdue » sort en 1981. Spielberg, Lucas, John Williams, Harrison Ford, comme un quarté gagnant, une martingale… Exactement ce dont rêvait un public avide de ce nouveau cinéma que propose Hollywood depuis 1977 avec « Star Wars », et qui portera un coup fatal à ce que l’on appelait Le Nouvel Hollywood.
Avec « Les Dents de la Mer » en 1975 (titre original « Jaws »), Steven Spielberg entérine un cinéma qui se veut plus adulte, dépressif et sombre. Voici donc venu le temps de ce qu’on allait désormais appeler les « Blockbusters »… Car il faut bien reconnaître qu’à partir de ce film, les compteurs du box office américain et mondial allaient sacrément s’affoler. Mais c’est probablement la Saga « Indiana Jones » qui va le plus contribuer à propulser le réalisateur et producteur au rang de cinéaste le plus rentable de l’histoire du cinéma.
C’est George Lucas qui apporte ce projet sur un plateau à son ami Steven Spielberg. Lucas est depuis sa plus tendre enfance un fan de ces séries télévisées appelées « Serials », et suite au triomphe de la « Guerre des Etoiles », il voudrait créer une nouvelle franchise de ce type. De son côté, Steven Spielberg vient d’essuyer un refus pour acheter les droits d’adaptation de la bande dessinée « Tintin ». En outre, il rêve également de réaliser un épisode de James Bond mais là encore, fin de non-recevoir de la famille Broccoli…
Pour Spielberg, frustré et amer suite à ces deux refus consécutifs, la proposition de Lucas tombe à point nommé et pourrait constituer un beau lot de consolation… D’autant que Spielberg vient pour la première fois de sa courte carrière de mordre la poussière avec le film « 1941 », qui est un flop retentissant. Le tandem va ainsi concocter une relecture du serial et du cinéma à l’ancienne en y injectant de la vitesse, des nazis, de la magie et le savoir-faire inimitable du réalisateur de « Duel ». C’est ainsi que dès sa sortie en 1981, « Indiana Jones & Les Aventuriers de l’Arche Perdue » devient le film d’aventure ultime par excellence.
[youtube id= »RvXJqRml_Jo » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Son triomphe absolu au box-office appelle donc une suite. Mais Spielberg traîne la patte… Il n’aime pas particulièrement le concept de la franchise, et le principe de devoir revenir sur ses œuvres, surtout s’il considère avoir tout donné dès le premier essai, tant en terme de spectacle que d’émotion. Entretemps, en 1982, sort ce qui ne devait être qu’un petit film intimiste tourné relativement vite et qui deviendra contre toute attente son plus gros succès : « E.T., l’Extra-Terrestre ».
Pourtant, « Indiana Jones et le Temple Maudit », qui sort en 1984, sera aussi un énorme succès, malgré le ton plus cynique et désabusé de l’histoire. L’ambiance plus sombre et anxiogène peut surprendre un temps mais parvient à donner au film une certaine patine et un statut d’œuvre culte, avec ses scènes de gore totalement décomplexées, tout droit inspirées de deux films de genre et d’aventure de Fritz Lang (« Le Tombeau Hindou » et « Le Tigre du Bengale »), en plus glauque encore. En tout cas, ce « Temple Maudit » constitue un bel exemple de cinéma borderline qui contrebalance avec le premier volet, extrêmement tenu.
[youtube id= »OdV5jWs676k » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Pour des tas de raisons qui vont probablement du contractuel aux desiderata de George Lucas, un nouvel Indy voit le jour et sort en 1989. Un troisième épisode, « Indiana Jones et la Dernière Croisade », censé être d’ailleurs le dernier, qui vient un peu tardivement et n’a déjà plus le bon parfum, ni dans l’énergie ni dans l’envie, du plaisir de cinéma. On a plutôt affaire à un film à la limite du remake du premier volet, dans lequel Spielger a remplacé l’Arche par le Saint Graal…
Les nazis y font leur grand retour et on y retrouve à peu de choses près les mêmes scènes, poursuites et péripéties incluses. Personne ne semble y croire, même pas John Williams… Le film va cependant pas trop mal marcher, mais son succès ne repose plus que sur de la pure nostalgie.
[youtube id= »7h6BUqhBMV4″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
En 2008, presque vingt ans après le premier opus, sort en grande pompe, en ouverture du Festival de Cannes, « Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal »… A l’annonce de ce 4ème volet, nous pouvions raisonnablement être quelque peu dubitatifs, mais en même temps, force était de reconnaître que cette bonne vieille fibre nostalgique titillait encore notre curiosité malsaine…
Voir un Indiana Jones vieillissant, accompagné cette fois-ci de son fils dans cette nouvelle aventure. Allez, pourquoi pas… Cet ultime volet pouvait laisser présager quelques belles et surtout inédites idées dans le scénario. Sachant qu’avec le chemin parcouru par Spielberg depuis « Les Dents de la Mer » et les films qu’il avait enchaînés depuis, on pouvait s’attendre à un vrai concentré d’aventure, d’humour, d’ironie, un mélange de références et de gros morceaux de bravoure. Mais le résultat fût bien pire que tout ce que l’on aurait pu imaginer…
Le spectacle auquel on assiste devient vite dérangeant, tant Spielberg, Lucas, Williams, Ford et les autres, ont de toute évidence renoncé dès les premières minutes à cette entreprise. Mais le doigt déjà bien pris dans l’engrenage infernal, ils vont devoir aller jusqu’au bout… Car ce dernier volet d’Indiana Jones est une longue agonie sinistre. Les scènes dites d’action sont tellement boursouflées, recouvertes d’effets numériques pour masquer tant bien que mal l’effondrement interminable de l’ensemble, qu’elles n’ont plus rien de cohérent.
Catastrophe paroxysmique du film, la scène dans la jungle, lors de la fuite des trois protagonistes qui se font finalement rattraper très vite par la méchante, est à l’image du reste de ce bien piteux Royaume du Crâne de Cristal. Tournée dans un décor minable, on assiste médusé à un échange entre Harrison Ford, qui tente de sauver les meubles, et Karen Allen, toute momifiée, fronçant les sourcils et levant les bras au ciel… Un spectacle pathétique et vexant pour tous les fans, qui ne voient en ce dernier volet qu’une sombre histoire de contrat arrivant à échéance et la nécessité absolue d’achever la bête agonisante. Bien curieuse façon pour Spielberg de remercier son public…
[youtube id= »09SOPcC-brU » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
… Et pour les plus masochistes, rien n’est encore perdu car même au fond du trou et de la boue jusqu’à la taille, l’entreprise de démolition Lucas, Spielberg & Co creuse encore à la recherche d’un hypothétique filon encore inexploité à ce jour, en annonçant pour 2021 un Indiana Jones 5 ! Alors, elle est pas belle la vie ?