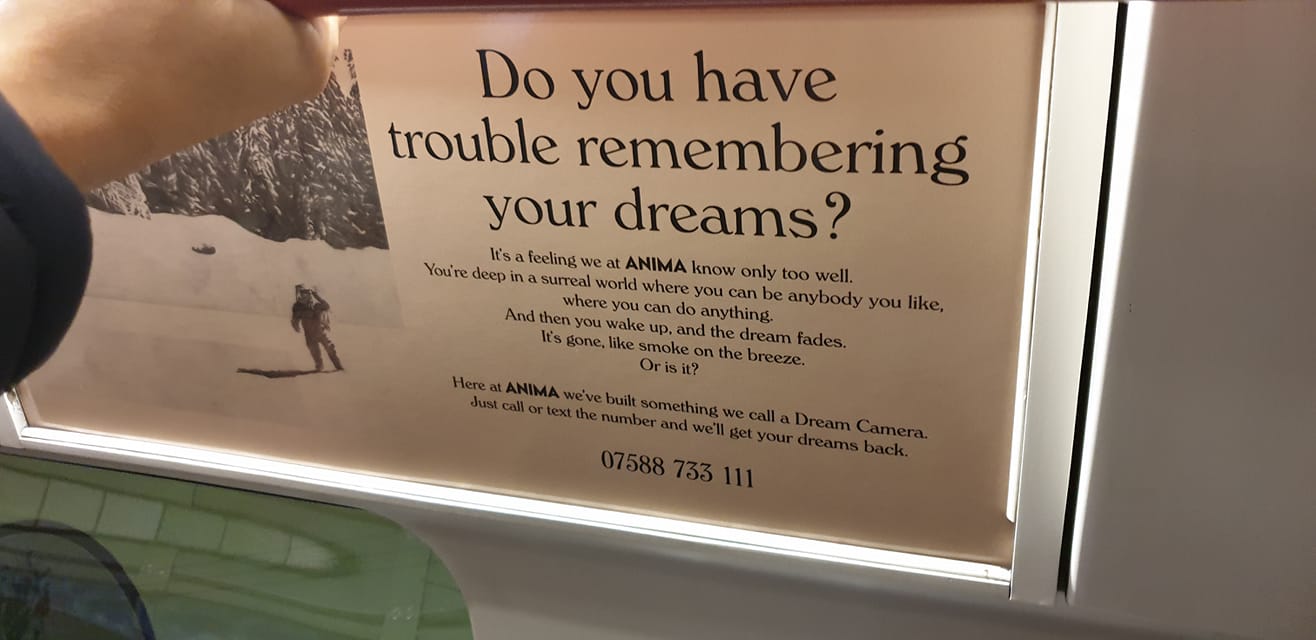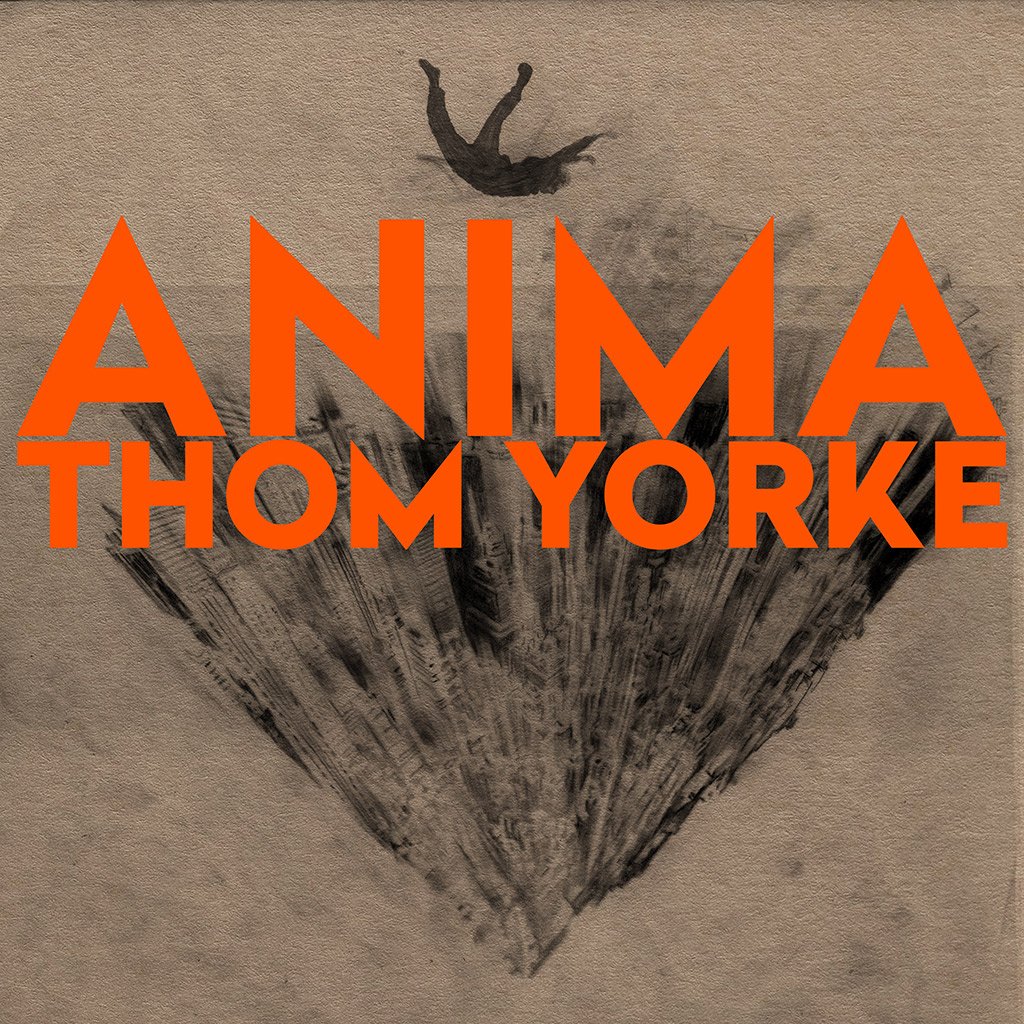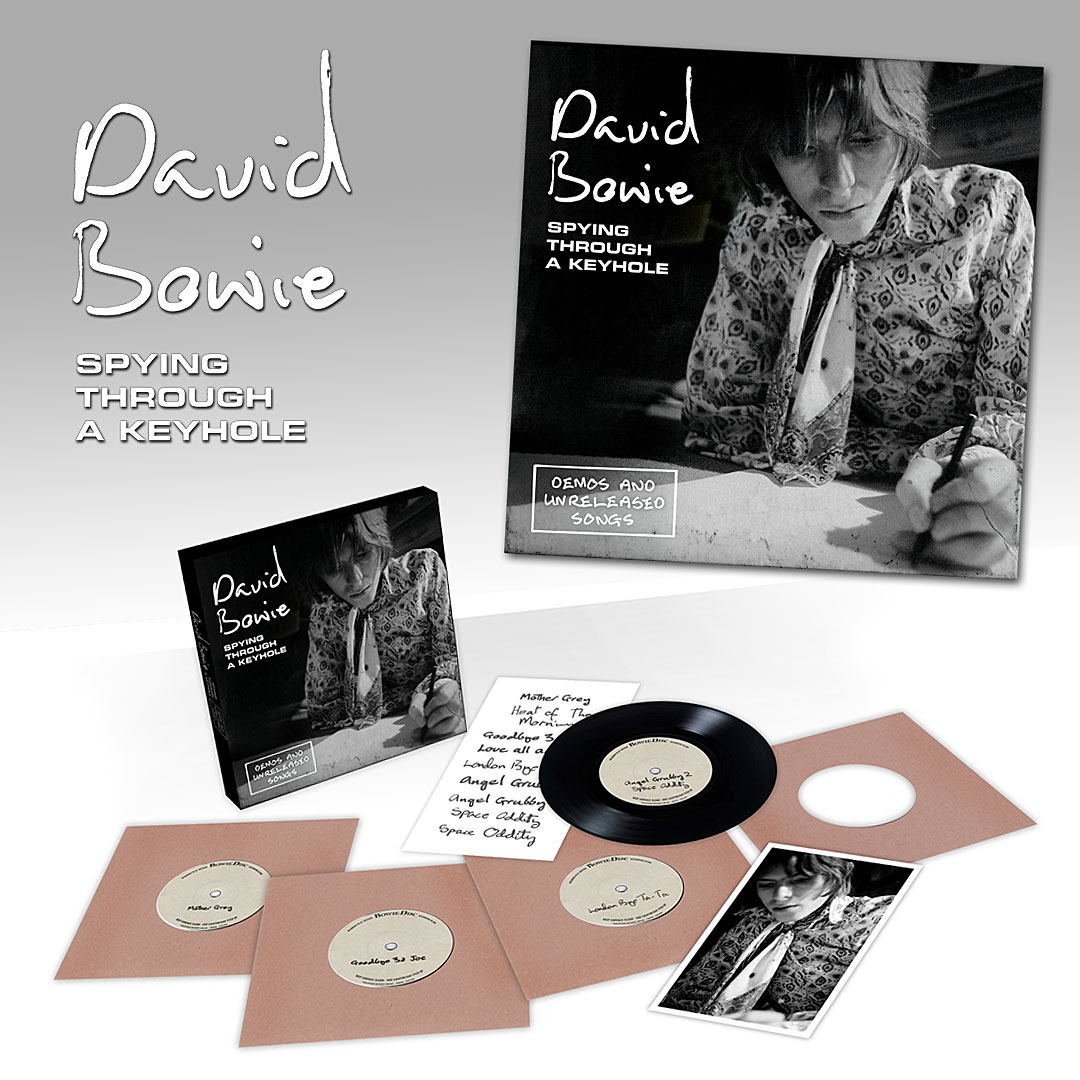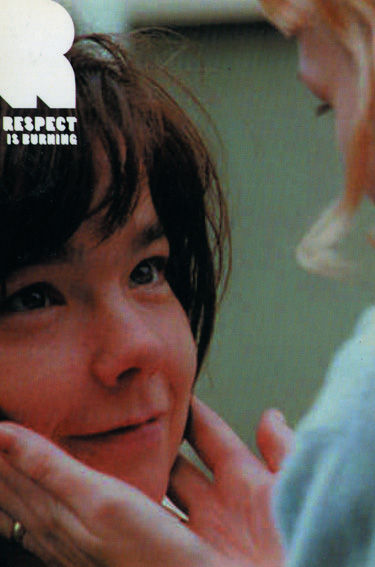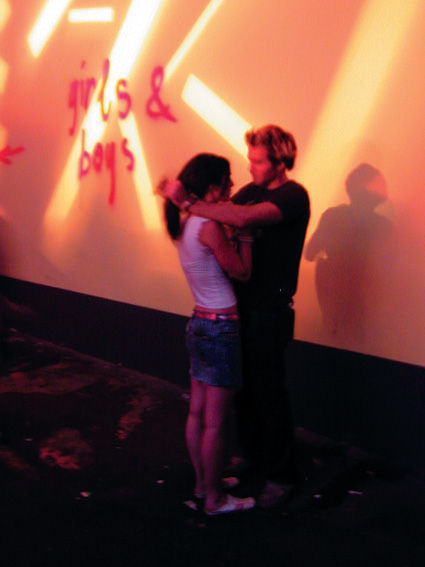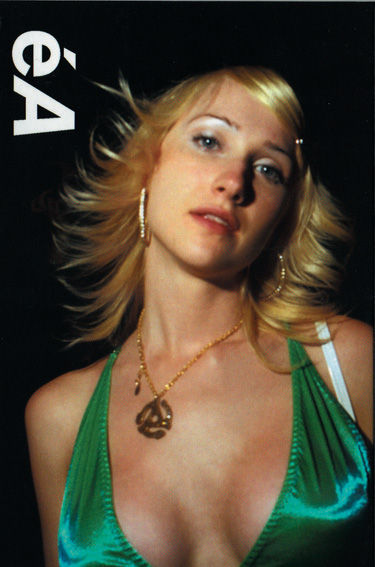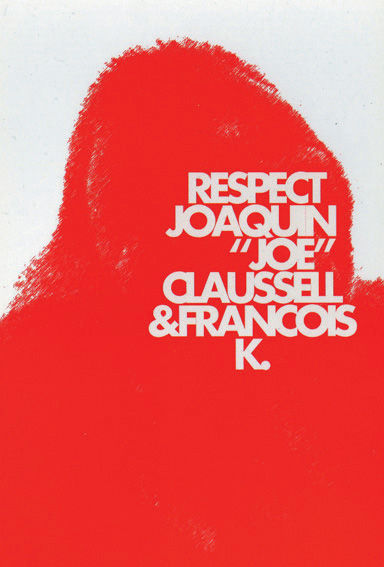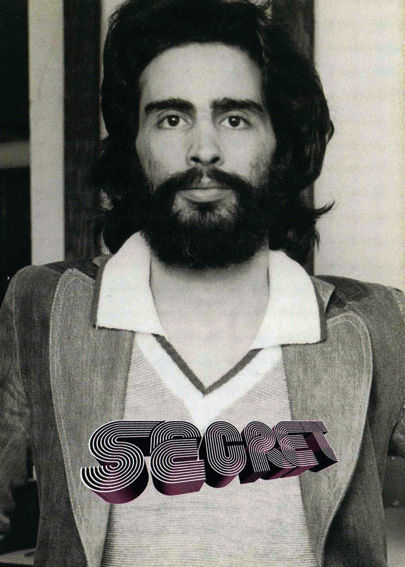Le 03 août 1979, AC/DC sortait son sixième album studio, « Highway to Hell ». Ce jour-là, tout fan inconditionnel du groupe australien s’est probablement rué au magasin de disques le plus proche, est ensuite rentré chez lui à la hâte, a posé le vinyle sur sa platine, non sans une certaine excitation, et les premiers accords du morceau éponyme qui ouvre l’album se sont instillés dans son esprit pour toujours. Et il y a fort à parier que cette même scène se soit reproduite partout dans le monde ce vendredi 03 août…
Car quarante ans plus tard, force est de constater que lorsque nous faisons le compte, rares sont les albums qui évoquent quelque chose à toutes les générations qui se sont succédées depuis leur sortie. Rares sont aussi les albums dont tout le monde connaît les premiers accords, identifiables en une seule seconde, et dont la pochette est presque aussi célèbre que les morceaux qui y sont gravés. Mais ce qui est sûr, c’est que parmi ces albums figure forcément « Highway to Hell ».
Parfaite symbiose
Le 27 juillet 1979, il y a donc quarante ans, le groupe de hard rock australien sortait son magnum opus, d’abord chez lui en Australie puis le 03 août partout dans le monde. L’album qui allait mettre tout le monde d’accord : des fanatiques de punk bien senti aux traditionalistes du rock ‘n’ roll pur et dur, en passant par les métalleux pro-Black Sabbath et les familles biberonnées à la pop britannique. Car « Highway to Hell », c’est l’album qui va définitivement propulser AC/DC au rang d’icône du rock.
[youtube id= »6EWqTym2cQU » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Quand « Highway to Hell » paraît, les Australiens ont déjà plusieurs albums à leur actif, et tous ont connu un retentissement plus ou moins important en Australie comme à l’international. Ils se distinguent invariablement par des rythmes lourds, des accords de guitare rythmique imposants, grattés par la cheville ouvrière du groupe, Malcolm Young. Son frère Angus arrache quant à lui de sa fameuse Gibson SG des chorus démoniaques, virevoltant lorsque la voix de l’extravagant chanteur Bon Scott ne s’empare pas de tout l’espace sonore. Les chansons d’AC/DC sont la définition même de la symbiose d’un groupe, dont aucun des membres n’aurait pu exister sans les autres…
« AC/DC, c’est de la musique rock ’n’ roll. Rien de plus, rien de moins. Peut-être jouée un peu plus fort, mais il n’y a aucune autre différence… » (Angus Young)
Avec des chansons comme « It’s a Long Way to the Top », « T.N.T. », « Let There Be Rock », « Whole Lotta Rosie » ou « Riff Raff », AC/DC s’est peu à peu imposé comme le groupe maître du rock qui tache, tirant le meilleur parti de l’héritage de Led Zeppelin mixé à une passion prononcée pour le blues aux racines prolixes. Certains classent même Angus et sa bande dans la case heavy metal, aux côtés de Black Sabbath et Judas Priest. Ce que le guitariste réfute : « C’est de la musique rock ‘n’ roll. Rien de plus, rien de moins. C’est peut-être un peu plus fort, mais il n’y a aucune autre différence ».
De géant australien à légende internationale
Du rock ‘n’ roll pourtant unique, particulièrement identifiable. Et en partie grâce à « Highway to Hell », qui cristallise en 1979 toutes les attentes qui entouraient AC/DC. L’album fait ainsi passer le groupe du statut de géant australien à celui de légende internationale, capable de remplir des stades immenses, quel que soit le pays où il se produit. On se souviendra évidemment de certains shows démesurés, comme au stade de River Plate à Buenos Aires en 2009 ou encore au Stade de France la même année. Mais le concert qui marquera les esprits pour l’éternité est celui du 09 décembre 1979 au Pavillon de Paris, qui servira de base au documentaire musical « Let There Be Rock » réalisé par Eric Dionysius et Eric Mistler, sorti sur grand écran en 1980, et qui restera à l’affiche de quelques cinémas parisiens pendant des années…
[youtube id= »JGftIcp2SC0″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
La recette de « Highway to Hell » repose en partie sur sa production. Robert « Mutt » Lange est imposé pour produire l’album, et lui donne une sonorité moins brute, plus accessible à la bande FM. Laissant les influences blues au « Some Girls » des Rolling Stones, les membres du groupe s’ingénient à écrire des refrains en forme d’hymnes puissants, assimilables par une foule gigantesque.
C’est avec cette stratégie en tête que naissent des tubes. « Highway to Hell » en premier lieu, la chanson ultime du groupe, qui fixe sur bande toute l’ambition de ce disque monstre. Les parties de guitare semblant mener une course effrénée contre la batterie, la voix d’orfèvre de Bon Scott et son refrain plus qu’iconique en font un objet d’adoration pour tout amateur de rock.
Usine à tubes
Et si la chanson-titre est la plus célèbre, le reste de l’album n’a pas à rougir. « Girls Got Rhythm » ne peut que faire s’agiter une longue chevelure de métalleux. « Walk All Over You » calme le jeu sur son lourd refrain pour mieux projeter son énergie sur des couplets diaboliques. « If You Want Blood (You Got It) » offre peut-être le riff de guitare le plus typique d’AC/DC. Si on y ajoute « Shot Down in Flames » ou encore « Night Prowler », le disque ressemble plus à une crasseuse usine à tubes qu’à un album de rock.
[youtube id= »l482T0yNkeo » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Et à l’écoute des mécaniques de cette usine, il est aisé de comprendre en quoi « Highway to Hell » a pu devenir un objet sacré du rock. En quelques albums, AC/DC est passé d’un hard rock costaud aux influences blues à un hard rock démentiel, taillé pour enflammer (plus ou moins littéralement) les foules.
Chant du cygne involontaire
Mais cet album ne limite pas son statut culte à sa seule qualité intrinsèque. Son histoire a aussi son rôle à jouer. Le 19 février 1980, après une soirée trop alcoolisée, la voix emblématique du chanteur Bon Scott s’éteint définitivement. Il avait 33 ans, et laisse derrière lui un public orphelin et un groupe au bord de la rupture. « Highway to Hell » restera son chant du cygne involontaire.
En hommage à son chanteur charismatique, et avec le petit nouveau Brian Johnson derrière le micro, AC/DC publiera en juillet 1980 « Back in Black », qui deviendra d’ailleurs le deuxième album le plus vendu de tous les temps derrière « Thriller » de Michael Jackson sorti en 1982. Et si quelques titres de « Back in Black » résonnent encore dans les têtes des rockers des années 80, comme « Hells Bells » ou « Shook Me All Night Long », les riffs simples mais ravageurs de « Highway to Hell » devraient garder encore longtemps la première place dans leurs coeurs. Et lui permettre de rester l’Album d’AC/DC, avec un grand A…
Article de Thomas Hermans (FranceInfo Culture) et Christophe Mayet (Instant City)