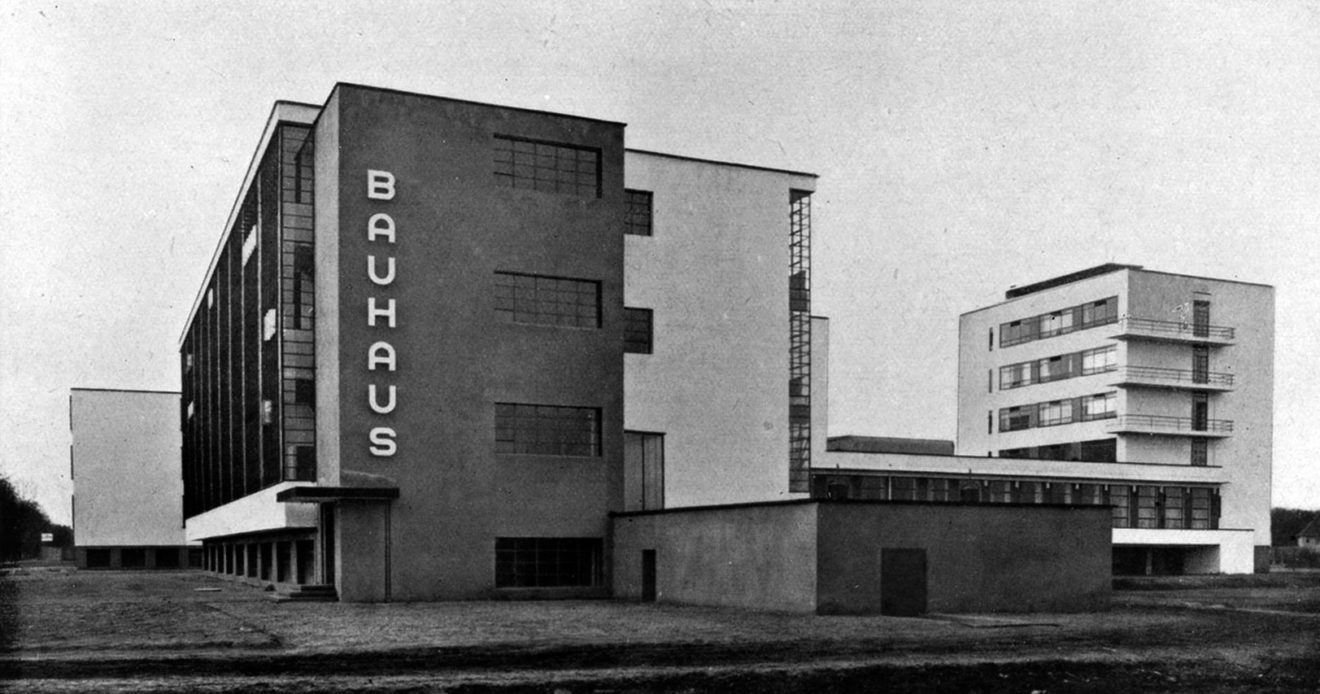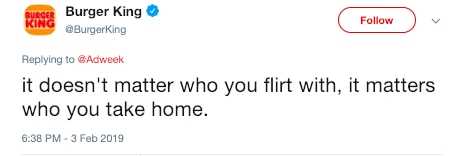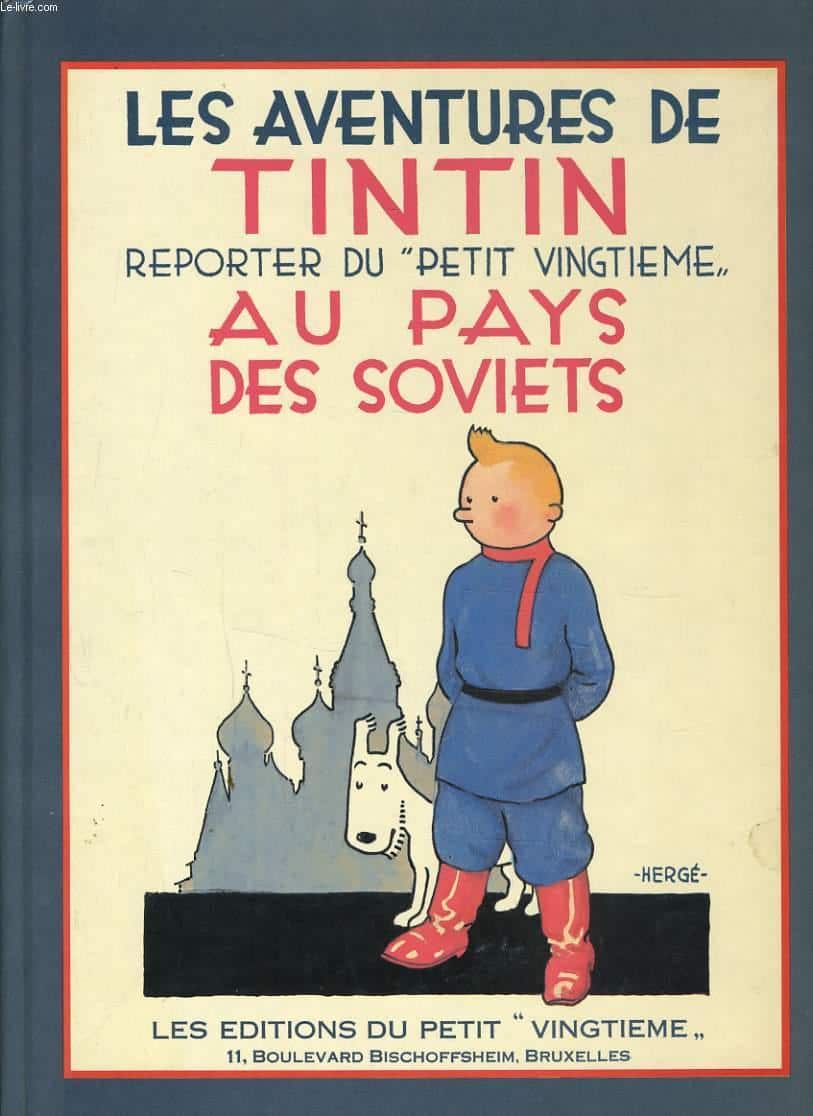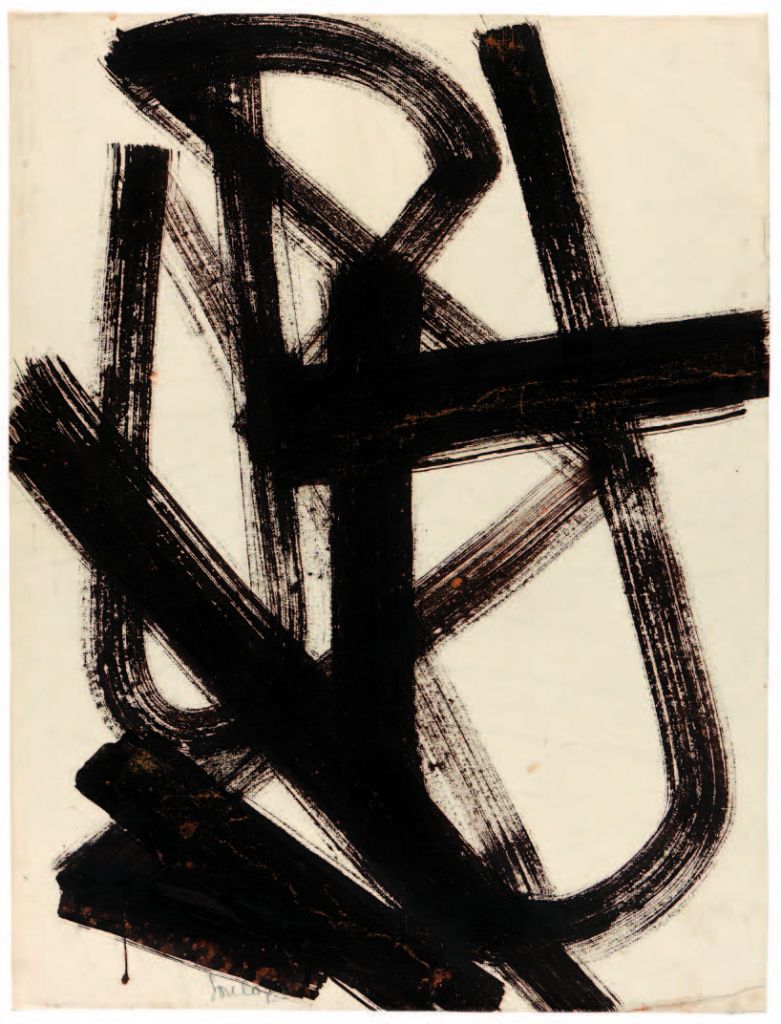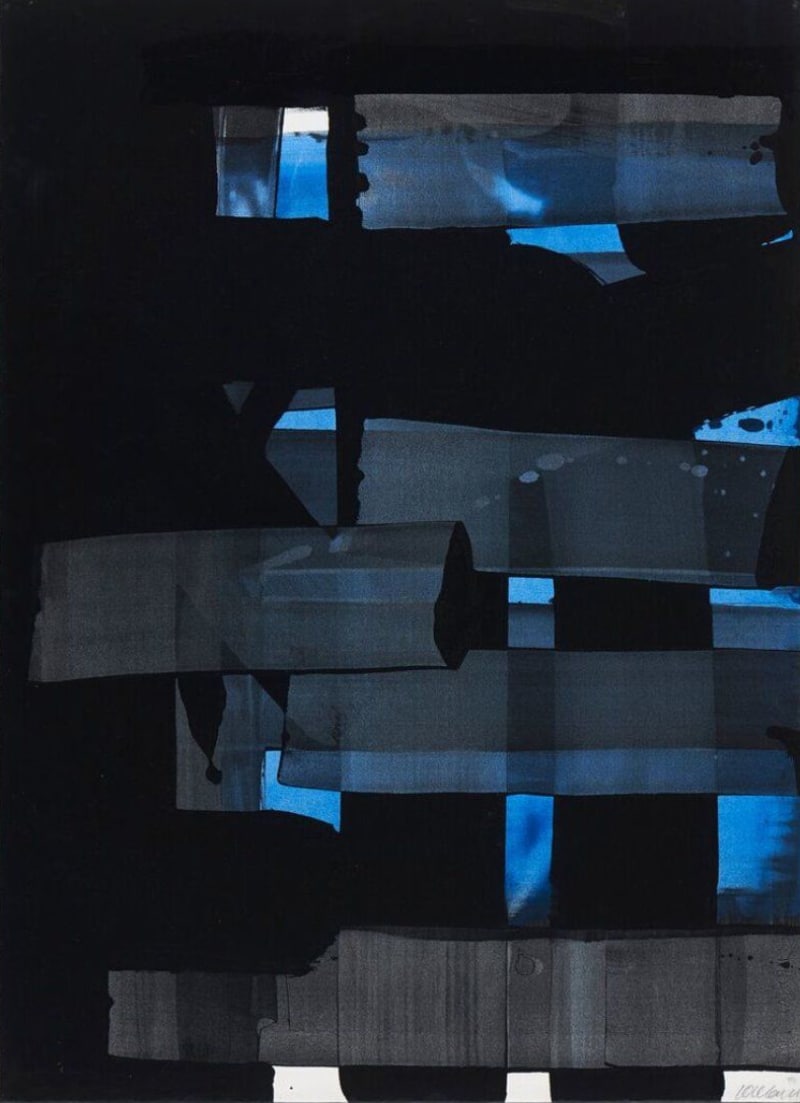A l’occasion de la Fashion Week de Paris qui se tient actuellement, remémorons-nous avec délectation un titre de Prince de 2007, « Chelsea Rodgers », qui parle de mode, mais pas seulement…
Peu d’artistes ont assez de crédit dans le monde de la mode pour pouvoir se permettre de prendre littéralement possession d’un défilé de la London Fashion Week pour en faire l’arrière-plan d’un de leurs clips. C’est pourtant ce que fit Prince en 2007, lorsqu’il tourna le clip vidéo de son titre « Chelsea Rodgers » extrait de l’album « Planet Earth » sorti la même année. Il y raconte l’histoire d’une bien mystérieuse ancienne model devenue une « hippie du 21ème siècle ».
Les lyrics de la chanson se voulaient en profond décalage avec les paillettes et le glamour de l’univers de la mode, dans lequel Prince s’immerge pourtant pour les besoins du clip, alors qu’il fait dire à Chelsea qu’elle souhaite quitter le mannequinat et partir en quête de plus de spiritualité. Ces paroles reflètent cette même quête chez Prince à cette époque, dans sa foi, avec les Témoins de Jehovah, comme dans sa tentative de mieux comprendre sa propre spiritualité et éprouver ses croyances, avec des références au végétarisme ou au renoncement à toute célébration d’anniversaire ou de fête.
« The day that we stop counting, we live as long as a tree », chante-t-il ainsi, « Go ahead Chelsea, teach me! »
A model
Used to be a role model
I don’t know
Come on Chelsea
I dunno
Come on
Ah, go ahead now Chelsea! Go ahead now!
Uh, this for Jersey right here
Go ahead now
Chelsea Rodgers was a model
Thought she really rocked the road, yes she did
Kept her tears up in a bottle
Poured them out to save her soul
Ask her what she liked the most
She said, she liked to talk to Jimi’s ghost
Fantasy, her friends boast (This girl is fly)
Chelsea’s fly, like coast to coast
Hollywood or Times Square
If the party’s fly, my girl is there
Purple’s on and bounce in her hair
Twenty first Century hippy, Chelsea don’t care
Chelsea Rodgers was a model
Thought she really rocked the road, yes she did
Kept her tears up in a bottle
Poured them out to save her soul
Try to catch her if you can (Come on now together)
You never see her with my man (A brother got to jump n the water)
He must be baptized, according to the master plan
‘Fore she give up the good thing
Go ahead Chelsea (Go ahead Chelsea)
No cut diamonds, and designer shoes (Uh, no-no!)
Because she’s too original from her head down to her feet
(Rehab) (If you want to) (just don’t mean no me)
Chelsea don’t eat no meat, still got butt like a leather seat
Go ahead Chelsea! (Go ahead Chelsea!)
Chelsea Rodgers was a model
Thought she really rocked the road, yes she did
Kept her tears up in a bottle
Poured them out to save her soul
Go ahead Chelsea!
(Speak on that horn)
Come on
Next to her they just a fool
Chelsea read more books than a few
Moses was a Pharoah in the eighteenth Dynasty
And Rome was chilling in Carthage in 33 BC
And the day that we stop counting, we live as long as a tree
Go ahead Chelsea, teach me! Go ahead Chelsea
Make a promise to your higher self, get you nothing, fame and wealth
You don’t be chasing nobodies ghost
Of everything, make the most (Come on!)
Chelsea Rodgers was a model
Thought she really rocked the road, yes she did
Kept her tears up in a bottle
Poured them out to save her soul
Chelsea Rodgers was a model
Thought she really rocked the road, yes she did
Kept her tears up in a bottle
Poured them out to save her soul
Paroles : Prince Rogers Nelson
© Universal Music Publishing Group
[youtube id= »GlQxfixy4rc » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]