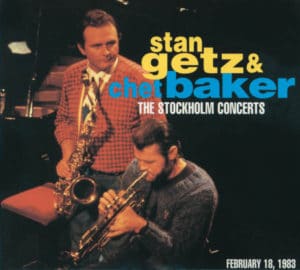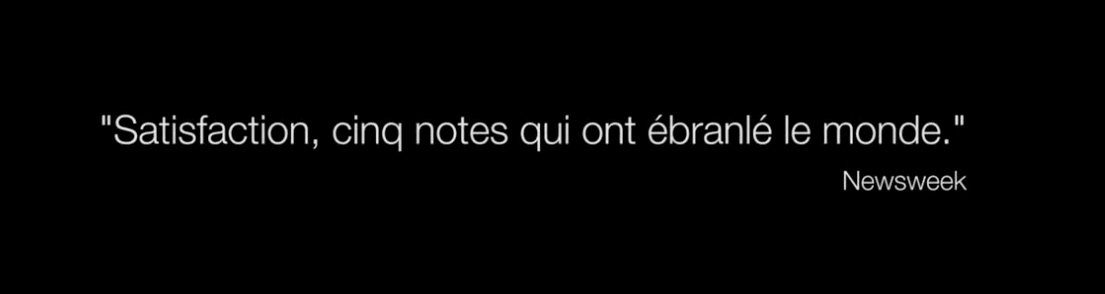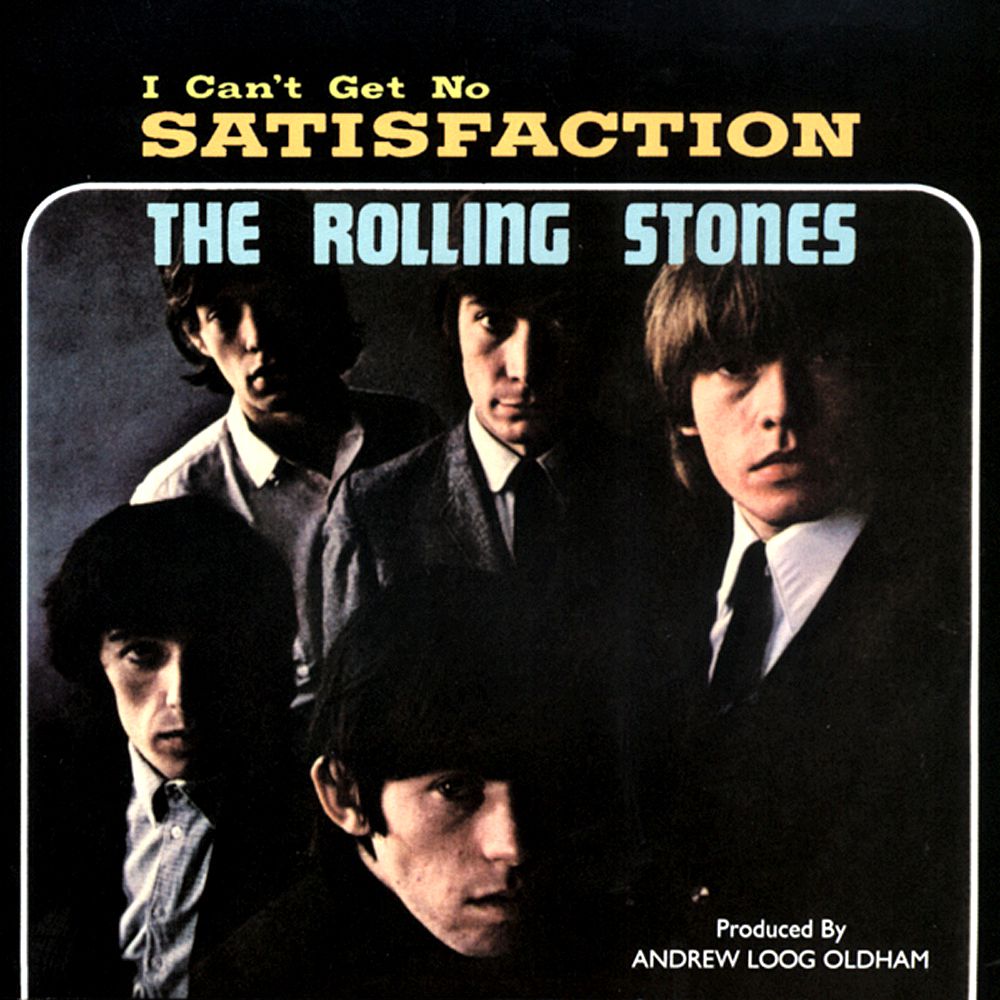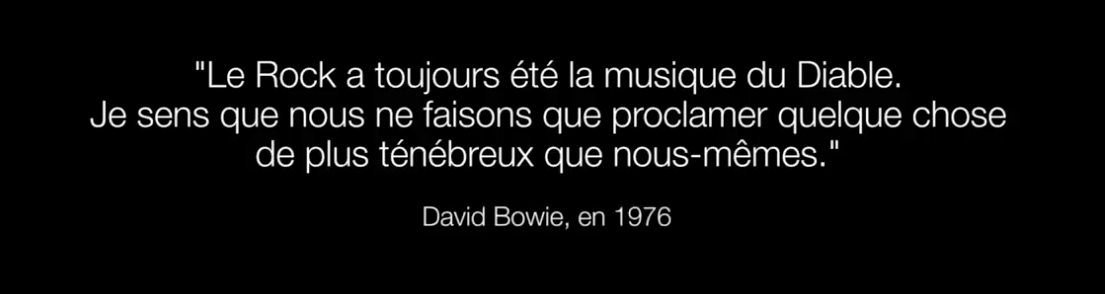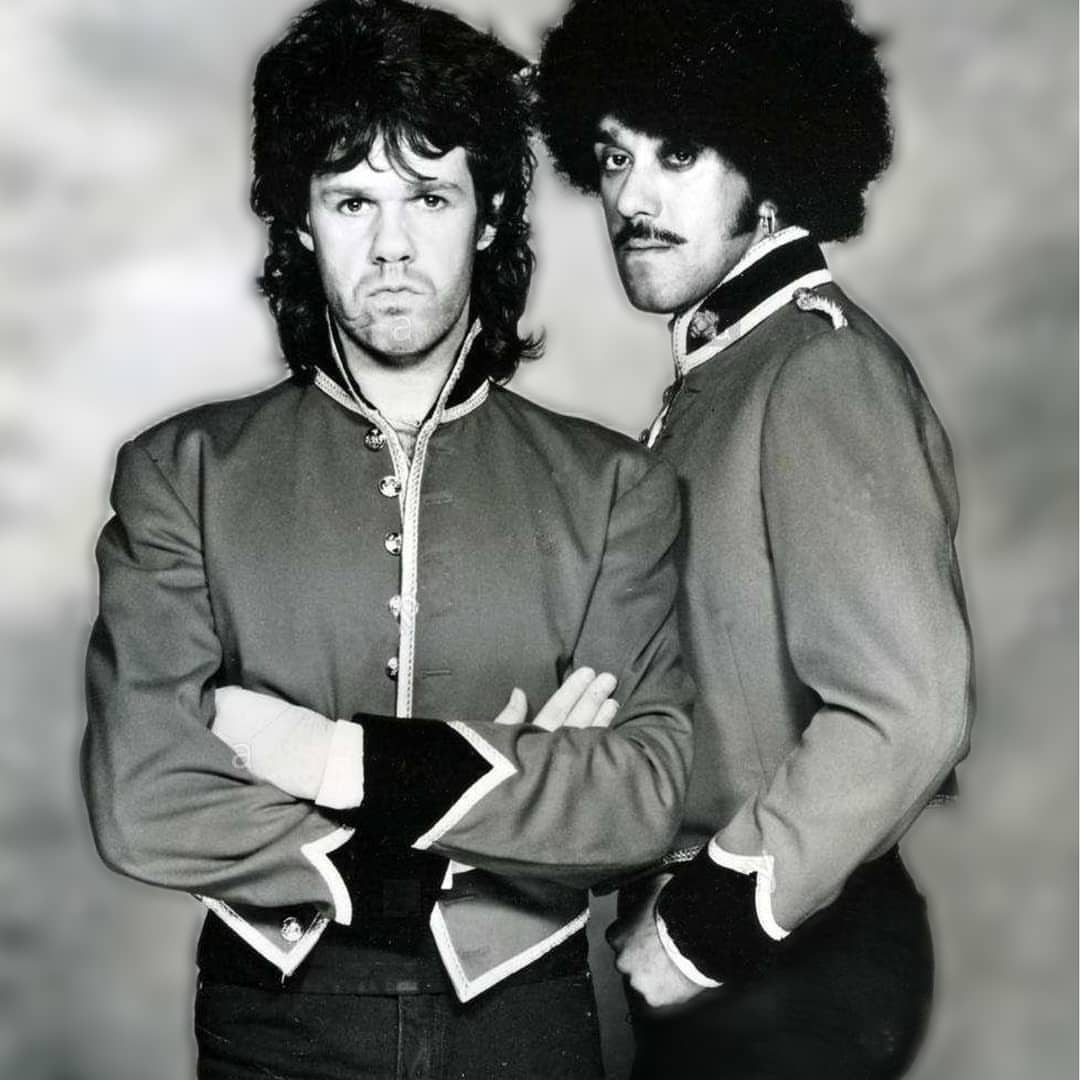Alors que sort au cinéma le remake du « Dumbo » de Walt Disney réalisé par Tim Burton, voici l’histoire de Jumbo, éléphant star et martyr du cirque, qui contribua à l’inspirer.
Le seul éléphant d’Afrique arrivé en Europe
Jumbo naît en 1860 en Abyssinie. Sa mère est tuée devant lui par des chasseurs soudanais. L’éléphanteau décharné est acheté par un marchand d’animaux, qui l’expédie par bateau en Europe. Aucun autre éléphant n’ayant survécu à cette traversée, il est alors le seul éléphant d’Afrique en Europe. D’abord vendu à une ménagerie ambulante allemande, il échoue à la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. En 1865, le zoo de Londres le rachète, en mauvaise santé.
La star de l’aristocratie britannique
Différent des éléphants indiens présents alors en Angleterre, il crée un engouement inédit. Il est alors prénommé « Jumbo ». Gavé de friandises, il est très populaire auprès de la haute société londonienne. Pendant 16 ans, sous la houlette de son gardien Matthew Scott, il promène des milliers d’enfants, parmi lesquels, paraît-il, Winston Churchill, Theodore Roosevelt ou les enfants de la reine Victoria.
Adolescent, il atteint près de 4 m de haut. « Jumbo » désigne alors tout ce qui est de grande dimension. À l’âge de la maturité sexuelle, Jumbo est de plus en plus difficile à contrôler. Il est maltraité pour le rendre plus docile. Il souffre de claustrophobie et est attaqué par les rats. Ses défenses sont tronquées car il se jette contre les murs.
Son gardien l’assomme avec du scotch et un tonneau de bière par jour. Le surintendant du zoo craint pour la sécurité des visiteurs. Il envisage même de l’abattre.
« Il est incroyablement intelligent, de bonne humeur et docile ; en même temps, il m’a donné ainsi qu’à tous ceux qui ont eu affaire à lui, des troubles d’anxiété » explique alors Abraham Bartlett, surintendant du zoo.
En 1882, le scandale éclate : le zoo vend Jumbo pour une somme dérisoire à un directeur de cirque américain. Se mobilisent alors 100.000 pétitionnaires s’opposant à son départ, le personnel du zoo, les médias britanniques, des écoliers, le Parlement, et même la Reine Victoria. Rien n’y fait…
[arve url= »https://www.dailymotion.com/video/x74sh1g » align= »center » title= »Jumbo, éléphant star et martyr du cirque » description= »Jumbo » maxwidth= »900″ /]
Le cauchemar américain
Terrifié, enchaîné et enfermé dans une caisse, Jumbo hurle à la mort pendant les deux semaines de traversée, sauf quand il est imbibé de bière ou de champagne. Arrivé à New York, il intègre le « Greatest Show on Earth », qui sillonne l’Amérique avec ses 80 wagons. Un wagon spécial lui est d’ailleurs réservé, le « Jumbo’s Palace Car ». Il est l’attraction phare et sa renommée est mondiale. Grâce à lui, Barnum crée le spectacle de cirque le plus lucratif de tous les temps, avec 20 millions de spectateurs.
En 1883, la santé de Jumbo décline, le cirque est dans le collimateur de la Société américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux (ASPCA). Jumbo meurt le 15 septembre, heurté par un train au Canada. Les circonstances réelles de sa mort sont controversées. Barnum soutient que Jumbo s’est précipité devant le train pour sauver héroïquement un jeune éléphant. Cet « accident » aurait en fait été mis en scène pour éviter les investigations sur ses maltraitances, tout en planifiant une sortie spectaculaire.
Le squelette de Jumbo circule alors lucrativement durant deux ans avec le cirque, avant d’être donné au Musée d’Histoire Naturelle de New York. Son cœur est vendu à une université en 1889, et son corps reconstitué avec sa peau naturalisée échoue dans les collections de l’université Tufts (Massachusets), dont il devient la mascotte. En 1975, seule sa queue réchappe à un incendie. Ses cendres sont conservées dans un bocal. Son culte y est toujours vivace. En 1985, une statue grandeur nature est érigée au Canada pour commémorer le centenaire de sa mort. On ne compte plus les objets dérivés de Jumbo, les histoires, films, livres ou chansons qui lui sont consacrés.
Article de Camille Renard pour France Culture
[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] « Siribeddi : mémoires d’un éléphant », de J. Lermont. Un ouvrage que l’on peut lire en ligne sur le site de la BnF, Gallica.
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] « La vraie histoire de Jumbo », sur le blog Les Yeux de la Girafe.
[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] « Les millions de Barnum : amuseur des peuples ». Une autobiographie adaptée de l’américain par Jehan Soudan publiée en 1899 et en ligne sur Gallica.