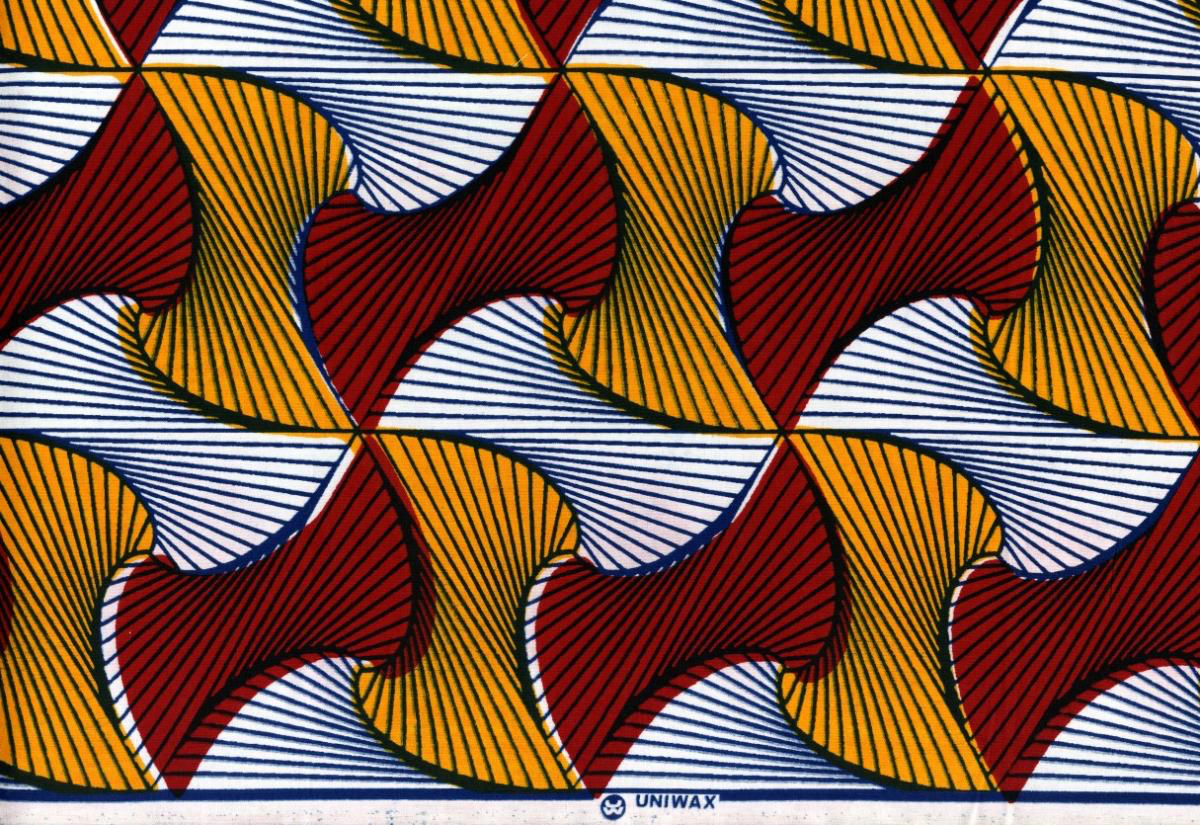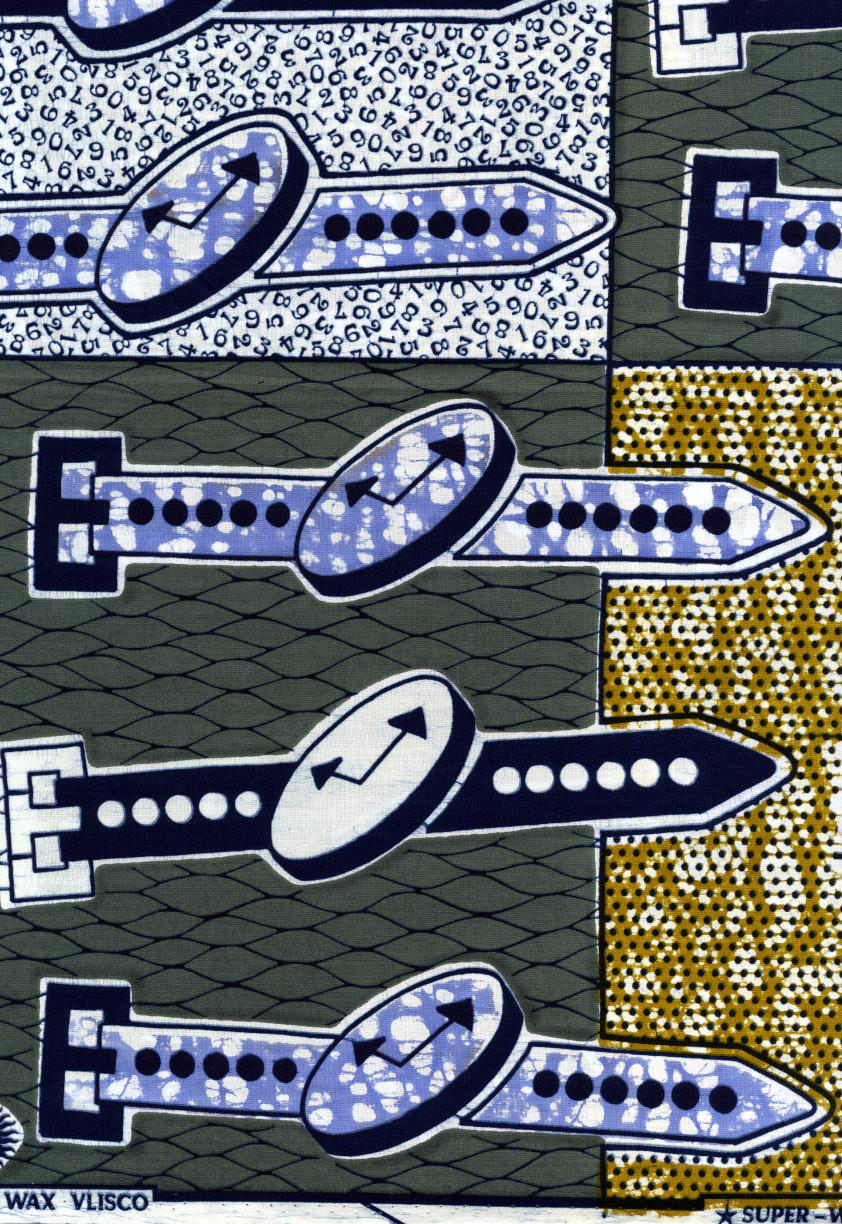C’est en 1979 que surgit dans les salles sombres des cinémas du monde entier « Alien, le Huitième Passager ». L’affiche du film montre un gros œuf qui se fendille par le dessous et d’où émerge une lumière verdâtre. On se souviendra aussi d’une phrase laconique qui accompagnait l’événement : « dans l’espace, personne ne vous entend crier ».
Par son approche inédite du film d’horreur, qui mélange thriller et science fiction, « Home Invasion » et Lovecraft, « Alien, le Huitième Passager » de Ridley Scott va surprendre puis terroriser des millions de spectateurs. Ce public fraîchement habitué à l’univers de « Star Wars » pensait naïvement que dans l’espace, c’était forcément plus cool… Sur la terre ferme, on avait certes déjà eu droit à « Massacre à la Tronçonneuse » puis à « L’Exorciste » qui campaient sacrément le décor ; dans l’eau, aux « Dents De La Mer » et dans la forêt, à « Délivrance ». Des films qui avaient imposé leurs initiales au genre et qui restent gravés à tout jamais dans l’inconscient collectif… En revanche, dans l’espace, on avait plutôt affaire aux bases et aux vaisseaux spatiaux, aux pistolasers ou aux bons sentiments.
Mais ça, c’était avant…
La lumière s’éteint. Le film commence. La musique de Jerry Goldsmith propose, sur la base de quelques notes de cuivres, un thème aussi doux qu’inquiétant pour accompagner les premières images de l’espace infini, des étoiles, des planètes, puis des bâtonnets se regroupent au centre de l’écran pour finir par former le mot « Alien »…
[arve url= »https://www.dailymotion.com/video/xgiud1″ align= »center » description= »« Alien, le Huitième Passager » de Ridley Scott (1979) » maxwidth= »900″ /]
Le vaisseau cargo Nostromo rentre sur terre. A son bord, l’équipage se trouve en cryo-sommeil. Alors qu’il passe non loin d’une planète inconnue, les ordinateurs captent un signal de détresse. Tout le monde est alors réveillé et décide d’organiser une mission de sauvetage. Ceux qui se rendent sur le lieu découvrent l’épave d’un gigantesque vaisseau spatial à la forme étrange. Après une petite visite à l’intérieur, l’un des protagonistes, plus curieux que les autres, tombe sur de gros œufs de Pâques.
Pourtant, ce qui en sortira ensuite ne ressemble pas vraiment à un lapin en chocolat mais plutôt à une grosse bestiole repoussante, croisement improbable entre une araignée et une paire de testicules. Le gloumoute qui surgit telle une mauvaise blague va se ficher sur le visage du malheureux membre d’équipage qui en prenait soin, après avoir préalablement brûlé la visière du casque de sa combinaison spatiale. Dans la salle de cinéma, tout le monde est calmé…
Le public va par la suite assister, médusé, à une autre scène qui restera probablement dans les annales comme l’une des visions les plus traumatiques du cinéma. Le truc en forme de main posé sur le visage de sa victime a visiblement eu le temps de pondre quelque chose dans son corps, mais personne ne s’en doute encore. Alors que l’homme placé en quarantaine, après avoir sombré dans le coma, reprend conscience sans la chose sur son visage, qui est retrouvé morte et toute desséchée, on est rassuré et déjà prêt à replonger dans un sommeil profond afin de continuer son voyage.
Lors d’un dernier déjeuner où tout l’équipage est présent, avant de retourner dormir, tout avait pourtant bien commencé mais la digestion de la salade de pomme de terre va s’avérer plus difficile que prévue… La salle, cette fois-ci sidérée, va assister à l’éclatement de l’intérieur du ventre du pauvre type, qui aurait mieux fait ce jour-là de rester chez lui. Une nouvelle créature, à l’apparence cette fois d’un cornichon à mâchoires, lui sort du bide, salut tout le monde puis part à toute vitesse se cacher dans les recoins sombres du vaisseau spatial.
[youtube id= »AdBu6VAESeI » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Avec ces deux scènes électrochocs, « Alien, le Huitième Passager » rentre instantanément dans le registre des standards de l’horreur, comme ses glorieux aînés cités précédemment. On avait peur sur terre, dans les campagnes, dans les villes, dans les océans et on aura désormais peur aussi dans l’espace. La suite de ce film est une course poursuite dans les méandres du vaisseau, au cours de laquelle on assiste, impuissant, à l’élimination méthodique de tout l’équipage par le fameux cornichon à mâchoires qui entre-temps sera devenu assez balèze…
Pour la petite histoire cinéphilique, au risque de paraître tatillon, il faut savoir que les deux scénaristes du film, Dan O’Bannon et Ronald Shusett, avaient quelque peu repompé l’intrigue d’un film de Mario Bava datant de 1965, « La Planète Des Vampires », dans lequel il était également question d’un vaisseau spatial qui recevait un S.O.S. provenant d’une planète inconnue. L’équipage qui s’était rendu sur les lieux s’apercevait trop tard qu’il ne s’agissait pas d’un appel au secours mais plutôt d’une mise en garde. Voilà pour la petite séquence sodomie de mouche…
Mais reprenons…
[youtube id= »zQFuUeXyACw » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
« Alien » premier du nom va donc propulser le jeune réalisateur britannique Ridley Scott en orbite. Avec ce seul succès à son actif, ce réalisateur venu de la publicité, qui n’avait produit auparavant qu’un seul film, « Les Duellistes », va désormais avoir toute la latitude requise à entreprendre ce qu’il souhaite. Il se lance ainsi dans son projet suivant, tiré d’une nouvelle de Philip K.Dick intitulée « Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? », et rebaptisé pour l’occasion « Blade Runner ».
Aujourd’hui encore, « Alien, le Huitième Passager » est l’exemple parfait de ce que la conjonction entre plusieurs talents peut engendrer de plus créatif, depuis la direction artistique jusqu’à la réalisation, en passant par la musique, les visuels et bien-sûr le casting. La jeune actrice Sigourney Weaver qui campe le personnage du lieutenant Ripley va d’ailleurs devenir une marque de fabrique du film hollywoodien. La femme forte et intelligente, celle qui aura toujours le dernier mot…
Mais la véritable vedette du premier volet de la saga « Alien » est bien évidemment le monstre lui-même. Dans un film qui se voulait hyper-réaliste, il était inenvisageable d’y exposer une créature issue d’un bestiaire déjà vu mille fois. Il fallait donc trouver un nouveau concept de xénomorphe qui aurait sa propre logique, un passif, une mythologie et qui soit plausible dans la réalité.
C’est en Suisse que fût finalement déniché celui qui donnera naissance à la créature légendaire et pas très sympa : L.G. Giguer, un artiste peintre et sculpteur, aux visions cauchemardesques à base d’hommes et de femmes bio-mécaniques, dans lesquelles s’entrelacent et se fondent organismes, phallus, vagins, totems et diverses ornementations ; de parfaites illustrations pour agrémenter un univers Lovecraftien à souhait… Il crée ainsi pour les besoins du film le monstre insectoïde et bio-mécanique parfait. Une créature aussi élégante que répugnante…
Malgré l’énorme profit que génère le premier opus de la future saga « Alien », La Fox ne va malheureusement pas pouvoir prévoir une suite de sitôt, d’abord parce que Ridley Scott ne souhaite pas revenir dessus. Il a son autre projet qui lui tient à cœur. Même si le potentiel est pourtant énorme, Il faudra attendre sept ans pour que sorte au cinéma une suite intitulée sobrement « Aliens ».
C’est donc en 1986, sous l’impulsion de James Cameron qui vient de casser la baraque avec son « Terminator » que cette suite voit enfin le jour. Le futur réalisateur du succès hors norme « Avatar » ne prend pas les choses à la légère. Après le thriller spatial claustrophobe qu’avait réalisé son prédécesseur, Cameron voit les choses en bien plus grand. Car quitte à revenir sur cette histoire de monstre dans l’espace, autant y aller à fond…
Le « S » rajouté au titre donne d’ailleurs le ton. Il n’y a plus un mais désormais plusieurs centaines de xénomorphes à combattre, et quoi de mieux pour tenter d’anéantir ces cancrelats géants que de leur envoyer les Marines. Mais James Cameron n’est pas non plus un bourrin à la Michael Bay (« Transformers », « Armageddon »), il saura jouer sur différents tableaux et différentes échelles.
Ripley (Sigourney Weaver) reprend du service et c’est évidemment elle qui aura le dernier mot à la fin. Non mais ! D’une femme forte et courageuse dans le premier opus, elle devient, sous la houlette du nouveau réalisateur, une combattante aussi dangereuse que tout un régiment de militaires endurcis. Cameron va pousser les curseurs très loin et offre un film furieusement guerrier. Il enchaîne les scènes d’anthologie, avec un duel final mano a mano entre Ripley et la reine des Aliens absolument homérique.
Si la version de James Cameron perd certes en mystère, nuance et stylisation, elle y gagne en revanche nettement sur l’aspect spectacle à grande échelle et générosité en scènes d’action en tous genres. « Aliens » sera de nouveau un beau succès, même si les critiques ne goûtent pas totalement sa tonalité jugée trop belliqueuse. Et beaucoup lui préféreront finalement les atours méta de son illustre prédécesseur.
Orgasmique…
[youtube id= »gaJFi3LiFOQ » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Il faudra encore attendre six ans pour que la Fox trouve le nouveau réalisateur capable de continuer à entretenir le mythe « Alien ». C’est au tour du jeune David Fincher, issu du clip et de la publicité, de s’essayer à renouveler la franchise. L’idée est maintenant évidente… Il s’agit de changer de ton à chaque nouvel opus, avec comme seul fil rouge, le ou les xénomorphes et le personnage de Ripley.
Pour ce troisième épisode tout aussi sobrement intitulé « Alien 3 », l’expérience va virer au cauchemar pour le réalisateur. En effet, Fincher, malgré son peu d’expérience en matière de réalisation, montre une appétence pour les idées originales et visionnaires. Ce qui n’est pas du goût du studio qui l’a engagé et qui voyait en lui seulement un bon faiseur surnommé à Hollywood « Yesman ». David Fincher, quant à lui, a une idée bien précise de la façon dont il compte aborder ce troisième chapitre.
Après la furie martiale et XXL de James Cameron, le futur réalisateur de « Seven » souhaite aller dans une toute autre direction. Plusieurs versions du scénario vont être d’abord proposées, avec des concepts assez fous tels que cette option dans laquelle l’histoire se déroule sur une planète forestière habitée par des moines dépourvus d’armes et qui devraient combattre les monstres par d’autres moyens. David Fincher verrait en effet assez une rencontre entre Alien et une ambiance moyenâgeuse. Difficile à faire avaler aux executives de la Fox, en tout cas…
Finalement, alors que le tournage commence sans que le scénario ne soit achevé, Fincher convainc en partie le studio de le laisser tourner ce qu’il a en tête. L’histoire va se situer dans un pénitencier à l’autre bout de la galaxie, dans lequel les anciens prisonniers vivent tels des moines et se servent du lieu comme d’un purgatoire, là même où ils ont trouvé la foi en créant une religion nouvelle issue du christianisme. C’est avec l’arrivée de Ripley dans sa navette, qui se crashe non loin de la communauté, que les ennuis vont commencer. Ayant fait vœu de chasteté, tous ces hommes ne sont pas forcément enclins à accueillir une femme, et encore moins lorsque celle-ci amène avec elle un de ces fameux œufs.
Le film est aux antipodes tant du premier que du second chapitre de la Saga « Alien ». David Fincher propose une œuvre gothique et austère, mâtinée de références bibliques. En affichant le parti pris de pas faire figurer la moindre arme à feu dans le film, il crée un univers complètement inédit et offre au monstre une nouvelle lecture à la série. Ultime provocation, il tue Ripley qui portait elle aussi un Alien en elle et qui se sacrifie en se jetant dans une cuve de plomb en fusion, dans un final christique du plus bel effet, le tout illustré par le magnifique score d’Elliot Goldenthal.
Cependant, à sa sortie, « Alien 3 » divise aussi bien le public que la critique. Les plus enthousiastes y voit un superbe objet sombre et fascinant, quand les plus fervents adeptes du premier volet le trouve trop éloigné du concept originel. Ce sera aussi le film de la saga qui marchera le moins bien en salle, car trop particulier, mais qui au fil des années deviendra culte. « Alien 3 » est censé clôre la saga en une trilogie aussi hétérogène que captivante…
[youtube id= »KUTaNMJJBa8″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Pourtant, en 1997 sort en salle un nouvel épisode de la Saga, « Alien, La Résurrection »…
Depuis « Alien, le Huitième Passager », l’actrice Sigourney Weaver a pris beaucoup de poids à Hollywood. Non pas qu’elle ait considérablement grossi en se gavant de pizza et de banana split, mais plutôt qu’elle est devenue absolument incontournable. C’est aujourd’hui elle qui a le pouvoir de choisir les projets dans lesquels elle souhaite s’investir. Et ce sera le cas pour la mise en chantier d’un nouvel « Alien ». N’ayant pas été très convaincue par son sort à la fin d’« Alien 3 », elle décide de remettre le couvert et de faire revenir d’une manière ou d’une autre l’increvable Ripley.
Co-productrice cette fois-ci, la Danna Barrett de « Ghostbusters » va s’enquérir elle-même du prochain réalisateur. Et son choix se portera sur un Français, Jean-Pierre Jeunet, le co-auteur de « Delicatessen » et de « La Cité des Enfants Perdus ». L’actrice-productrice aime son univers particulier et décalé et pense que cela collera parfaitement à cette renaissance.
« Alien, La Résurrection », malgré une indéniable bonne volonté et des idées intéressantes, se soldera par un semi-échec au box office. Paradoxalement, le film n’a ni l’ampleur d’« Aliens », ni le côté mystérieux d’« Alien 3 » et comparé à « Alien, le Huitième Passager », ne fait plus peur du tout…
En tentant d’injecter dans ce 4ème opus de l’humour et de la distanciation, le futur architecte du « Fabuleux Destin d’Amélie Poulain » a réduit à néant toute forme d’intensité et de rythme. Le film relève parfois presque plus du pastiche que d’un simple premier degré. Et si « Alien, La Résurrection » peut toutefois séduire grâce à des trouvailles stylistiques et des idées intéressantes en exploitant la mythologie d’origine, jamais il n’offre le spectacle fort et intense que l’on était en droit d’attendre.
C’est d’ailleurs l’un des films de la saga qui vieillira le plus mal et le revoir le ferait paraître assez anecdotique comparé à ses ainés.
Cette tétralogie se clôt donc cette fois-ci bel et bien, sur un film bancal et embarrassant.
[youtube id= »LFN4NtioY8Q » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Nous n’allons pas nous étendre sur les deux tentatives avortées que furent « Alien vs Predator » (2004) et « Alien vs Predator: Requiem » (2007) pour des raisons d’éthique personnelle. En effet, ces deux « œuvres palimpsestes » qui, comme leurs titres l’indiquent, voient des Xénomorphes affronter des Predators, n’avaient comme unique but que de faire plaisir à une nouvelle génération plus sevrée aux jeux vidéo qu’au cinéma.
On a longtemps cru que cette fois-ci le sort en était jeté et que la Fox laisserait tranquille une bonne fois pour toutes le xénomorphe le plus mignon de la galaxie. Pourtant, c’est bien le papa d’Alien en personne qui revient à la charge. Ridley Scott décide de réactiver la franchise, lui qui ne voulait plus en entendre parler, pour des raisons qui auraient curieusement un lien avec le décès de son frère réalisateur, Tony Scott.
En 2012 sort donc en salle « Prometheus ». Le réalisateur de « Gladiator » va proposer cette fois-ci un prequel à son propre film sorti en 1979.
A noter qu’à la même époque, le réalisateur sud-africain Neil Blomkamp (« District 9 ») travaille aussi sur un projet « Alien » qui aurait été, s’il avait vu le jour, une suite directe au « Aliens » de James Cameron, avec encore et toujours Sigourney Weaver dans le rôle de Ripley. Un reboot, en quelque sorte, qui aurait ainsi passé à la trappe tant la version de David Ficher que celle de Pierre Jeunet. Le projet était sur le point d’être lancé par la Fox. Des visuels comme le scénario était prêts et le film allait rentrer en pré-production…
Sauf que ce vieux briscard de Scott coiffe tout le monde au poteau, en faisant valoir son ascendant sur l’œuvre complète, dont il devait toujours avoir les droits, balaie d’un revers de la main tout le travail déjà effectué par Blompkamp et son équipe pour imposer sa propre version. Tout est réuni pour qu’il pose alors sur la table avec autorité cette nouvelle histoire révisionniste-créationniste sur la genèse des xénomorphes et par la même occasion la nôtre aussi.
Si l’on ne tient pas compte de l’énorme attente générée par ce nouveau volet de la Saga, entretenue de part et d’autre par une pluie de vidéos virales sur internet, de sites en tous genres, de forums et autres bandes annonces plus tapageuses les unes que les autres, il faut aujourd’hui considérer ce volet supplémentaire réalisé par Ridley Scott simplement comme ce qu’il est, au fond, à savoir un film peu cohérent dans l’ensemble de la série et au rendu bien inférieur à la somme de fantasmes et de croyances créés en amont de sa sortie.
D’ailleurs, cette méthode de communication, cette forme de stratégie publicitaire employée afin de provoquer une attente et susciter une envie, n’est pas dénuée de risque et peut fortement desservir une oeuvre, car elle embarque tous ceux et celles qui attendent le film à l’aune de leur propre psyché. Chacun se construit son propre film, sa propre histoire, avec les fragments et les quelques éléments mis à sa disposition… Forcément, les attentes seront immenses et impossibles à combler.
Pour « Prometheus », les images ou visuels lâchés au compte-gouttes dans l’année qui précéda sa sortie étaient à chaque fois alléchants. Les infos suggéraient beaucoup de mystère, de trouvailles démentes, le tout assorti d’une intrigue révolutionnaire.
Ridley Scott est avant tout un créateur de l’image et de la forme. Ce n’est pas le scénario qui chez lui est le plus important, c’est le support qui prédomine. Ses films totems que sont « Alien », « Blade Runner » ou encore « Legend » sont devenus des oeuvres références, surtout pour ce qu’ils véhiculent comme force picturale. L’histoire en soi part d’une idée forte et l’intrigue est à chaque fois simple et directe. C’est pour cela que ces films étaient réussis : ils étaient évidents. Le sens du détail, par lequel chaque objet avait une histoire. Jusqu’aux costumes et décors, pour signifier que le monde qui nous était dépeint était tangible.
« Prometheus », qui devait d’abord s’intituler « Paradise », se revendiquait comme une sorte de nouveau « 2001, l’Odyssée de l’Espace » ; une nouvelle référence ultime qui viendrait remettre les pendules à l’heure en matière de SF pure et dure. Cette énorme production de 150 millions de dollars, opulente et fière, nous fut livrée sur un char de Ben-Hur, au son des trompettes et hautbois… Pour qu’il n’en sorte finalement qu’un ridicule petit « pouet », tant l’intrigue est indigente…
[youtube id= »Oxv5SP3sags » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Le film tente d’occuper plusieurs registres à la fois, dont celui qui renoue avec le premier « Alien » ; l’horreur viscérale, la peur, l’angoisse. « Prometheus », tel un mille-feuilles indigeste, superpose plusieurs couches de lignes directrices. On essaye de suivre tout cela jusqu’à la fin, sans jamais avoir réellement tout compris et surtout sans pouvoir appréhender où cela va nous mener. Au final, le film s’avère totalement nébuleux. Quant aux nombreux protagonistes, ils sont traités comme des personnages de sitcom, avec un petit détail simpliste pour définir tel ou tel caractère.
Le scénario est à ce titre l’un des plus mauvais scripts agencés et structurés pour ce genre de productions, qui ait pu être proposé depuis bien longtemps. On a finalement l’impression de voir en « Prometheus » la somme des longs-métrages de SF parmi les plus médiocres de ces dernières années, entre « Supernova », « Event Horizon » ou encore « Sunshine ». Chacun de ces films présentait pourtant des pitchs intéressants empruntés à la littérature SF, avec des auteurs comme Isaac Asimov, Arthur C. Clarke ou Philip K.Dick, mais du fait de nombreux problèmes de production et de respect des délais, ils avaient dû se débarrasser en route de pas mal d’éléments pour en arriver finalement à une seule et unique intrigue convenue, à savoir des courses-poursuites entre héros et méchants dans des couloirs exigus, ou encore cet intenable compte à rebours avant que tout ne nous pète à la gueule…
« Prometheus » nous promettait des merveilles et nous n’avons eu en retour qu’un début beaucoup trop long et ennuyeux ; « Prometheus » laissait augurer des révélations à nous en laisser bouche bée et nous avons trop vite sombré dans de banales scènes d’horreurs et d’effets spectaculaires obligés. Nous finissons par perdre pied en oubliant les tenants de l’histoire, ses enjeux. Quant au scénario, il est tellement mal fichu dans ses ressorts et l’interaction entre les protagonistes, que l’on a du mal à comprendre le ton réel du film. Le score de Marc Streitenfeld est à ce titre à la hauteur de ce qu’est le film ; une musique fade, sans profondeur, sans caractère ni identité.
Au final, ce pénultième volet en date de la Saga « Alien » réalisé par Ridley Scott n’est ni viscéral, ni effrayant, ni sujet à réflexion, ni même étonnant. Il recèle néanmoins des images sublimes et des tableaux somptueux, à la manière d’un luxueux artbook à l’éloge de tous ceux qui ont contribué à son élaboration. Mais en tant que film, en tant qu’oeuvre, « Prometheus » est un produit sans âme et sans conviction. Un oeuf sans jaune…
[youtube id= »o_rfh8wBnGE » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]
Et Ridley Scott va encore enfoncer le clou et tenter de boucler la boucle, puisqu’il souhaitait réaliser une trilogie en 1979, avant de ne plus vouloir finalement réaliser une trilogie… Vous me suivez ? Avec « Alien: Covenant » sorti en 2017, il emploie de nouveau les mêmes méthodes de communication que pour « Prometheus », avec fausses publicités sur Youtube, teasers, etc… pour faire exister son film comme un univers plein et cohérent et surtout générer la même attente chez le public.
Avec cet ultime opus, on ne touche même plus le fond, mais on creuse… En l’espace de deux films, Scott aura réussi à saborder complètement son œuvre matricielle, comme un dernier bras d’honneur à tous les fans de cette mythologie. En voulant apporter des réponses à ce qui faisait justement le mystère et l’étrangeté des épisodes originels, le réalisateur enterre la saga « Alien » une bonne fois pour toutes, pour l’éternité…
Comme le chante Dominique A : « on ne souhaite pas la mort des gens, ce n’est jamais assez méchant ». Espèrons juste qu’après la disparition de Ridley Scott, un réalisateur plus inspiré et passionné pourra surgir de l’éternité et saura ressusciter notre monstre préféré et son si beau sourire de cornichon géant à double mâchoire…